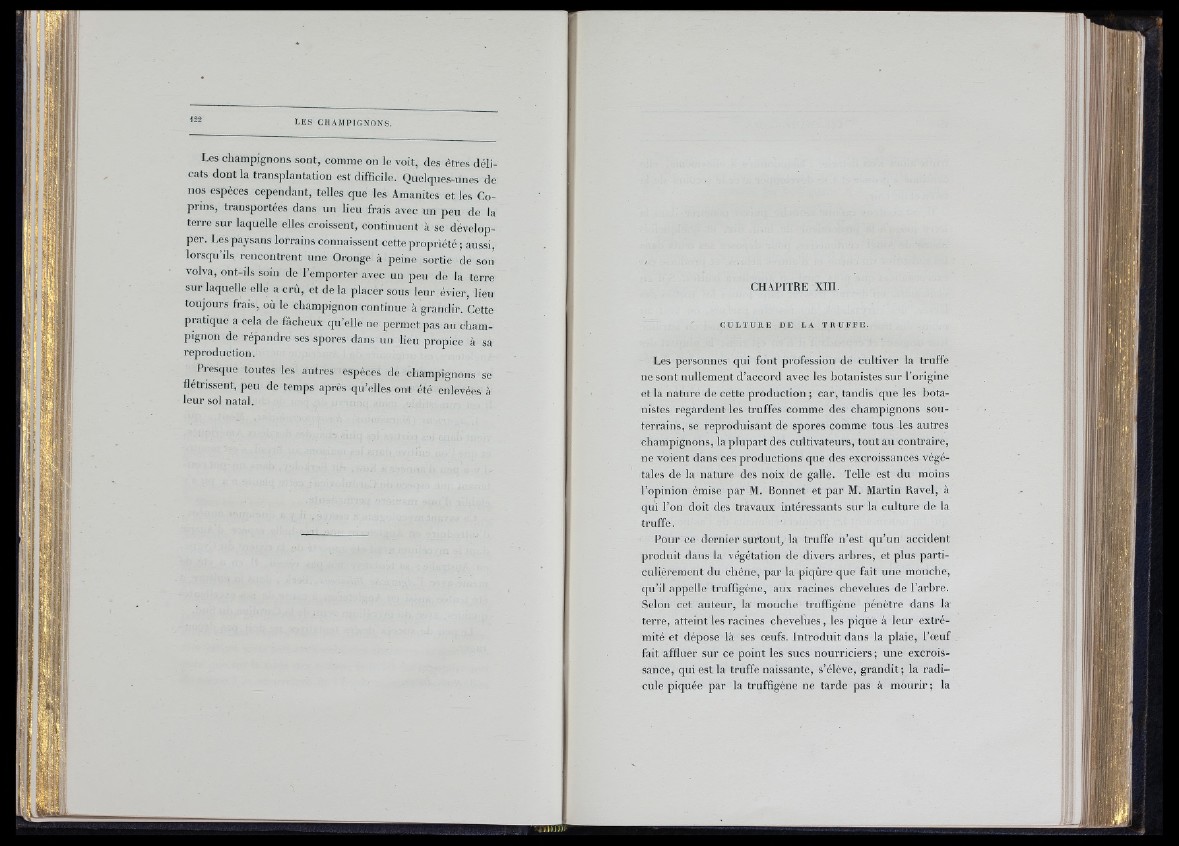
LES CHAMPIGNONS.
Les champignons sont, comme on le voit, des êtres délicats
dont la transplantation est difficile. Quelques-unes de
nos espèces cependant, telles que les .Amanites et les C oprins,
transportées dans un lieu frais avec un peu de la
terre sur laquelle elles croissent, continuent à se développer.
Les paysans lorrains connaissent cette propriété ; aussi,
lorsqu’ds rencontrent une Oronge à peine sortie de son
volva, ont-ils soin de l ’emporter avec un peu de la terre
sur laquelle elle a c rû, et de la placer sous leur évier, lieu
toujours frais, où le cliampignou continue à grandir. Cette
pratique a cela de fâcheux q u ’elle ne permet pas au champignon
de répandre ses spores dans nn lieu propice à sa
reproduction.
Presque toutes les autres espèces de cliampignons se
flétrissent, peu de temps après q u ’elles ont été enlevées à
leur sol natal.
et la nature de cette production ; car, tandis que les botanistes
regardent les truffes comme des champignons souterrains,
se reproduisant de spores comme tous les autres
champignons, la plupart des cultivateurs, tout .au contraire,
ne voient dans ces productions que des excroissances végétales
de la nature des noix de galle. Telle est du moins
l ’opinion émise par M. Bonnet et par M. Martin Ravel, à
qui l ’on doit des travaux intéressants sur la culture de la
truffe.
Pour ce dernier surtout, la truffe n ’est q u ’un accident
produit dans la végétation de divers arbres, et plus particulièrement
du chêne, par la piqûre que fait une mouche,
q u ’il appelle truffigène, aux racines chevelues de l ’arhre.
Selon cet auteur, la mouche truffigène pénètre dans la
terre, atteint les racines ch e v e lu e s , les pique à leur extrémité
et dépose là ses oeufs. Introduit dans la plaie, l ’oeuf
fait affluer sur ce point les sucs nourriciers; une excroissance,
qui est la truffe naissante, s’élève, grandit; la radicule
piquée par la truffigène ne tarde pas à mourir ; la