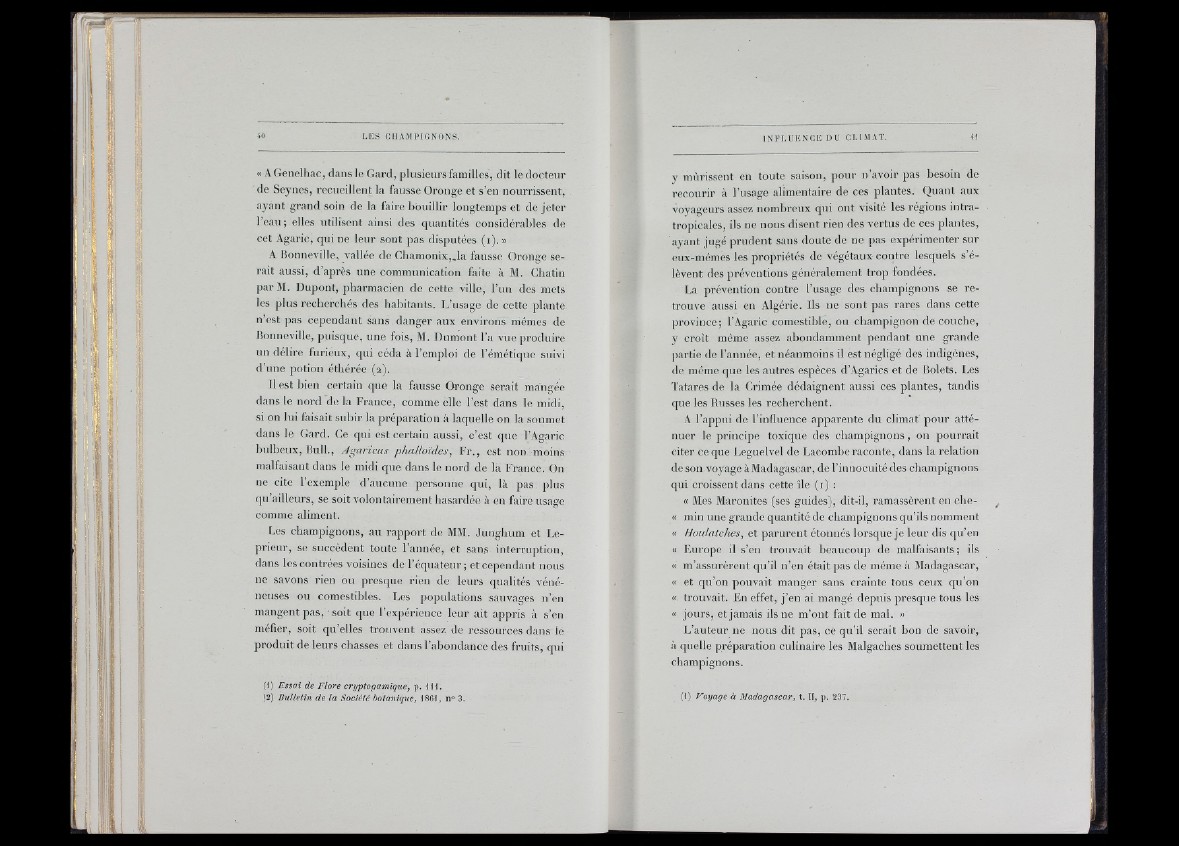
« AGenelliac, dans le Gard, plusieurs familles, dit le docteur
'de Seyiies, recueillent la fausse Oronge et s’en nourrissent,
ayant grand soin de la faire bouillir longtemps et de jeter
l ’e au ; elles utilisent ainsi des quantités considérables do
cet Agaric, qui ne leur sout pas disputées ( i) . »
A Bonneville, vallée de Chamonix,.la fausse Oronge serait
aussi, d ’après une communication faite à M. Chatin
pa rM . Dupont, pharmacien de cette ville, l ’un des mets
les pins recherchés des habitants. L ’usage de cette plante
n’est pas cependant sans , danger aux environs mêmes de
lionneville, puisque, une fois, M. Dnmont l ’;i vue produire
un délire furieux, qui céda à l ’emploi de l ’émétique suivi
d ’une potion éthérée (2).
11 est bien certain que la fausse Oronge serait mangée
dans le nord de la France, comme elle l ’est dans le midi,
si on lui faisait subir la préparation à laquelle on la soumet
dans le Gard. Ce qui est certain aussi, c ’est que l ’Agaric
liulbeiix, Bull., Agaricus phaiio'ides, F r ., est non moins
malfaisant dans le midi que dans le nord de la France. On
ne cite l ’exemple d ’ancune personne qui, là pas plus
q u ’ailleurs, se soit volontairement hasardée à en faire usage
comme aliment.
Les champignons, au rapport de MM. Junghum et Le-
prieur, se succèdent tonte l ’année, et sans interruption,
dans les contrées voisines de l ’équatenr; et cependant nous
ne savons rien on presque rien de leurs qualités vénéneuses
ou comestibles. Les populations sauvages n ’en
mangent pas, • soit que l ’expérience leur ait appris à s ’en
méfier, soit q u ’elles trouvent assez de ressources dans le
produit de leurs chasses et dans l ’abondance des fruits, qui
(1) E s sa i de Flore c ryp to g amiq u e, p.
(2) ¡hiHetin de la Société botanique, I8ÍH, n» 3.
y mûrissent en toute saison, poui' n ’avoir pas besoin de
recourir à l ’usage alimentaire do ces plantes. Quant aux
voyageurs assez nombreux qui ont visité les régions intra-
tropicales, ils ne nous disent rien des vertus de ces plantes,
ayant jugé prudent sans doute de ne pas expérimenter sur
eux-mêmes les propriétés de végétaux contre lesquels s’élèvent
des préventions généralement trop fondées.
La prévention contre l’usage dos champignons se retrouve
aussi en Algérie. Ils ne sont pas rares dans cette
|)i-ovince; l ’Agaric comestible, ou champignon d é cou ch é ,
y croit même assez abondamment pendant une grande
partie de l ’année, et néanmoins il est négligé des indigènes,
de même que les autres espèces d ’Agarics et de Bolets. I.es
Tatares de la Crimée dédaignent aussi ces plantes, tandis
que les Russes les recherchent.
A l ’appui do l ’influence apparente du climat pour atténuer
le principe toxique des champignons, on pourrait
citer ce que Leguelvel de Lacombe raconte, dans la relation
de son voyage à M adagascar, de rinnocuité des champignons
qui croissent dans cette île ( i) :
« iMes Maronites (ses guides), dit-il, ramassèrent en che-
« min une grande quantité de champignons q u ’ils nomment
« ilouiatches, et parurent étonnés lorsque je leur dis qu’en
« Europe il s’en trouvait beaucoup de malfaisants; ils
« m’assurèrent q u ’il n ’en était pas de même à Madagascar,
« et qu’on pouvait manger sans crainte tous ceux q u ’ou
« trouvait. En effet, j ’en ai mangé depuis presque tous les
« jours, et jamais ils ne m’ont fait de mal. »
L ’auteur ne nous dit pas, ce q u ’il serait bon de savoir,
à quelle préparation culinaire les Malgaches soumettent les
champignons.
(1) Voyage à Ma d a g a sca r, t. II, [). 237.