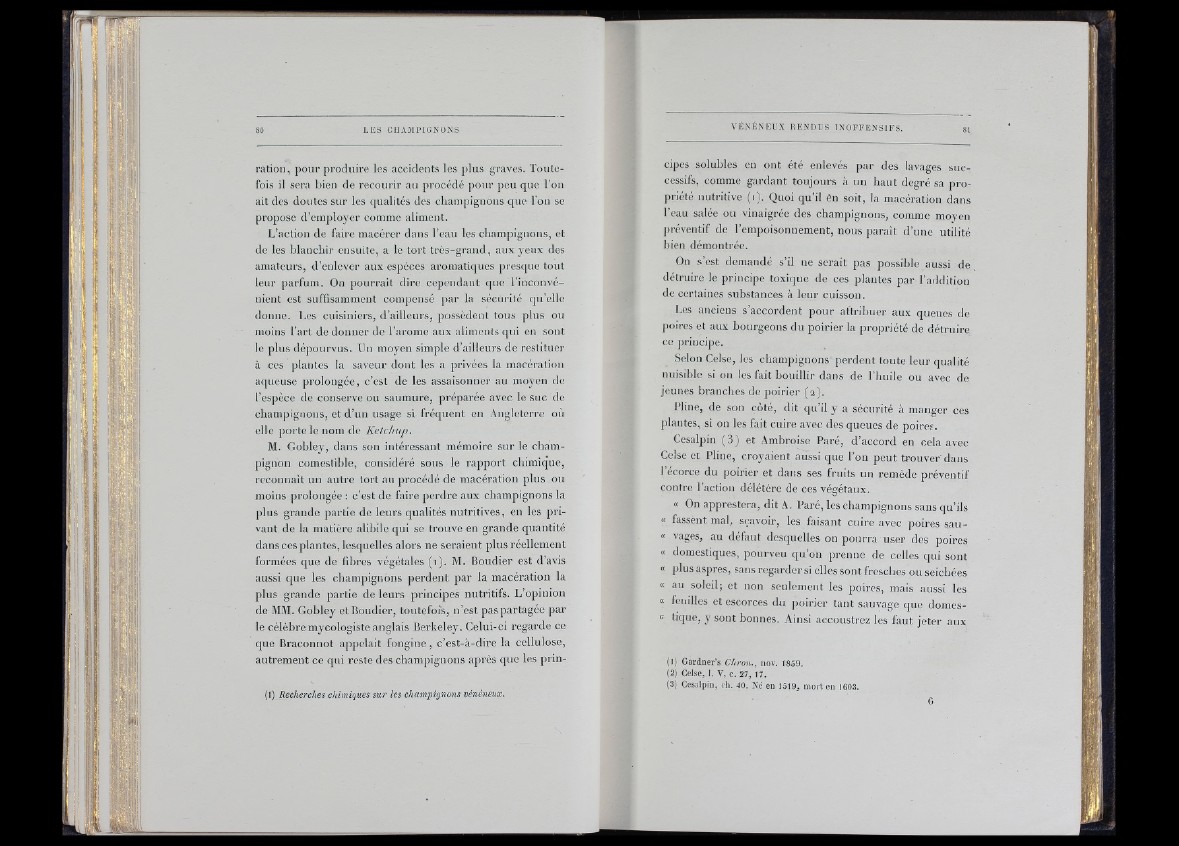
LES CHAMPlGNÜiNS
ration, pour produire les accidents les plus graves. Toutefois
il sera bien de recourir au procédé pour peu que l ’on
ait des doutes sur les qualités des cbampignous que Tou se
propose d ’employer comme aliment.
L ’action de faire macérer dans l ’eau les champiguons, et
de les blanclnr ensuite, a le tort très -grau d, aux yeux des
amateurs, d ’enlever aux espèces aromatiques pi-estjue tout
leur parfum, ü u pourrait dire cependant que l ’inconvénient
est suffisamment compensé jiar la sécurité q u ’elle
donne. Les cuisiniers, d ’a illeurs, possèdent tous plus ou
moins l’art de donner de l ’arome aux aliments qui en sont
le plus dépourvus. Lu moyen simple d ’ailleurs de restituer
à CCS piaules la saveur dont les a privées la macération
aqueuse prolongée, c ’est de les assaisonner au moyen de
l’espèce de conserve ou saumure, préparée avec le suc de
champignons, et d ’uu usage si fréquent en Angleterre où
elle porte le nom de Kelchup.
M. G obley, dans son intéressant mémoire sur le champignon
comestible, considéré sous le rapport chimique,
reconnaît un autre tort au procédé de macération plus ou
moins prolongée : c ’est de faire perdre aux champignons la
pins grande partie de leurs qualités nutritives, en les privant
de la matière alihile qui se trouve en grande quantité
dans CCS plantes, lesquelles alors ne seraient plus réellement
formées que de fibres végétales ( i ) . M. Boudier est d ’avis
aussi que les champignons perdent par la macération la
plus grande partie de leurs principes nutritifs. L ’opinion
de MM. Gobley et Boudier, toutefois, n ’est pas partagée par
le célèbre mycologiste anglais Berkeley. Celui-ci regarde ce
cjue Braconnot appelait fo n g iu e , c ’est-à-dire la cellulose,
autrement ce qui reste des champignons après que les prin-
(1) Recherches chimiques s u r les champ ig n o n s vénéneux.
VÉ.NÉNEUX RENDES INOFFENSIFS.
cipcs solubles en ont été enlevés par des lavages successifs,
comme gardant toujours à un haut degré sa p ro priété
nutritive (i). Quoi q u ’il èn soit, la macération dans
l ’eau salée ou vinaigrée des champignons, comme moyen
jji'éventif de l ’empoisonnement, nous parait d ’une utilité
bien démontrée.
On s’est demandé s ’il ne serait pas possible aussi de
détruire le principe toxique de ces plantes par l ’addition
de certaines substances à leur cuisson.
Les anciens s ’accordent pour attribuer aux queues de
poires et aux bourgeons du poirier la propriété de détruire
ce principe.
Selon Celse, les champignons ])crdent toute leur qualité
nuisible si on les fait bouillir dans de l ’huile ou avec de
jeunes branches de poirier (2).
Pline, de son côté, dit q u ’il y a sécurité à manger ces
plantes, si on les fait cuire avec des queues de poires.
Cesalpiu ( 3 ) et Ambroise Paré, d ’accord en cela avec
Celse et Pline, croyaient aussi que l ’on peut trouver dans
l ’écorce du poirier et dans ses fruits un remède préventif
contre l ’action délétère de ces végétaux.
« On apprestera, dit A. Paré, les champignons sans q u ’ils
« fassent mal, sçavoir, les faisant cuire avec poires sau-
« vages, au défaut desquelles ou pourra user des poires
« domestiques, pourveu q u ’on prenne de celles qui sont
« plus aspres, sans regardersi elles sout frcsches ou seichées
« au soled; et non seulement les poires, mais aussi les
« feuilles et escorces du poirier tant sauvage que domes-
<•• tique, y sout bonnes. Ainsi accoustrez les faut jeter aux
(1) Gardner’s Chron., iiov. 1859.
(2) Celse, i. V, e. 27, 17.
(3) Cesalpin, ch. 40. Ké en 1519, mort en 1603.