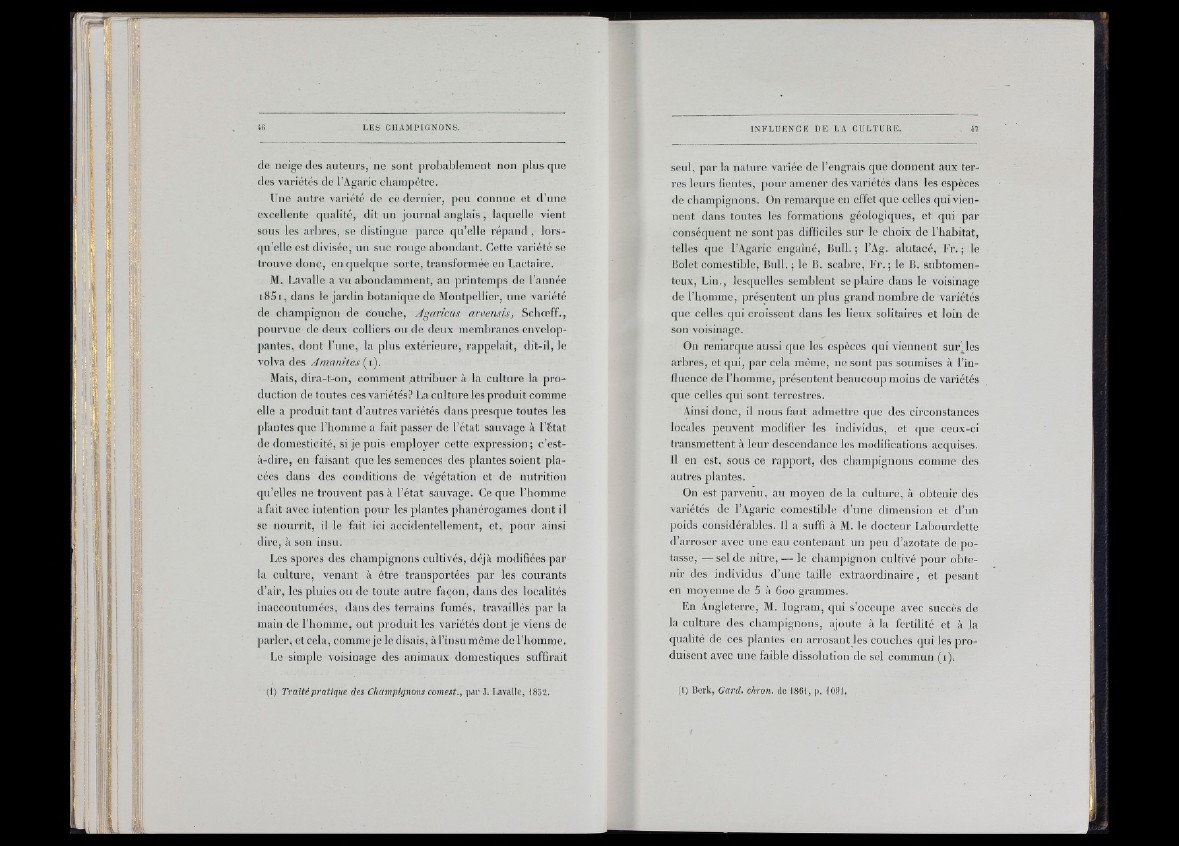
i II
! ÜL
de neige des niitenrs, ne sont proliablement non plus que
des variétés de l ’Agaric champêtre.
Une antre variété de ce dernier, peu connue et d ’une
excellente qualité, dit un journal anglais , laquelle vient
sous les arltrcs, se distingue parce q u ’elle rép an d , lorsq
u ’elle est divisée, un sue rouge abondant. Cette variété se
trouve donc, en quelque sorte, transformée en T.aetaire.
M. Lavallc a vu abondamment, an printemps de l ’année
i 8 5 i , dans le jardin botaniqiic de Alontpelher, une variété
de champignon de couche, Agaricus arvensis, S chæff.,
pourvue de deux colliers ou de deux membranes enveloppantes,
dont l ’une, la plus extérieure, rappelait, dit-il, le
volva des Amanites ( i) .
Mais, dira-t-on, comment attribuer à la culture la p roduction
de toutes ces variétés? La culture les produit comme
elle a produit tant d ’autres variétés dans presque toutes les
plantes que l ’homme a fait passer de l ’état sauvage à l ’état
de domesticité, si je puis employer cette expression ; c ’est-
à-dire, eu faisant que les semences des plantes soient placées
dans des conditions de végétation et de nutrition
qu ’elles ne trouvent pas à l ’état sauvage. Ce que l ’homme
a fait avec intention pour les plantes phanérogames dont il
se nourrit, il le fait ici accidentellement, et, pour ainsi
dire, à son insu.
Les spores des champignons cultivés, déjà modifiées par
la culture, venant à être transportées par les courants
d ’air, les pluies ou de toute autre façon, dans des localités
inaccoutuniéos, dans des terrains fumés, travaillés par la
main de l ’homme, ont produit les variétés dont je viens de
parler, etcela , comme je le disais, àTinsumême d e l ’homme.
Le simple voisinage des animaux domestiques suffirait
(1) T ra ité p ra tiq u e des Champignons comest., par J. I.avalle, 1832.
seul, par la nature variée de l ’engrais que donnent aux terres
leurs fientes, pour amener des variétés dans les espèces
de champignons. On remarque en effet que celles qui viennent
dans toutes les formations géologiques, et qui par
conséquent ne sont pas difficiles sur le choix de l ’habitat,
telles <|ue l ’Agaric eiigainé. Bull. ; l ’Ag. alutacé, Fr. ; le
Bolet comestible. Bull. ; le B. scabrc, Fr. ; le B. subtomen-
toux. Lin., Icsquo'lles semblent se plaire dans le voisinage
de l ’homme, présentent uu plus grand nombre de variétés
que celles qui croissent dans les lieux solitaires et loin de
sou voisinage.
Ou remarque aussi que les espèces qui viennent surjjes
arbres, et qui, par cela même, ne .sont pas soumises à l ’influence
de l’homme, présentent beaucoup moins de variétés
que celles qui sont terrestres.
Ainsi donc, il nous faut admettre ([ue des circonstances
locales peuvent modifier les individus, et que ceux-ci
transmettent à leur descendance les modifications acquises.
Il eu est, sous ce rapport, des champignons comme des
autres plantes.
Ou est parvenu, au moyen de la culture, à obtenir des
variétés de l ’Agaric comestible d ’une dimension et d ’un
poids considérables. Il a suffi à M. le docteur Labourdette
d ’arroser avec une eau contenant un peu d ’azotate de potasse,
— sel de nitre, — le champignon cultivé pour obtenir
des individus d ’nnc taille extraord inaire , et pesant
eu moyenne de 5 à 6oo grammes.
En Angleterre, M. Ingram, qui s ’occupe avec succès de
la culture des champignons, ajoute à la fertilité et à la
qualité de ces plantes eu arrosant les couches qui les p ro duisent
avec une faible dissolution de sel commun ( i).
(I) lîerk, G a rd , chron. de 186), p. fODl.