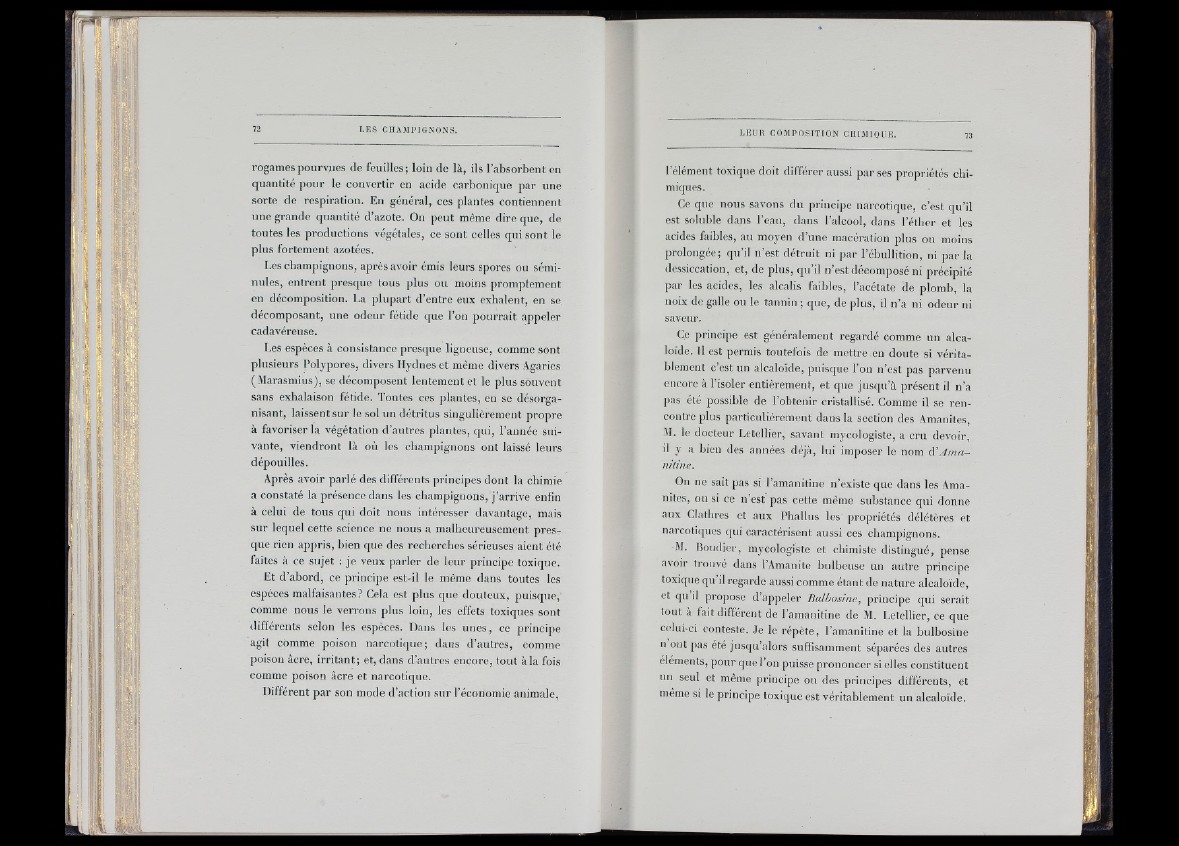
L E S C H A M P I G N O N S . L E U R C O M P O S I T I O N C H I M I Q U E . 73
rogamespourvues de feuilles; loin de là, ils l ’absorbent en
quantité pour le convertir en acide carbonique par une
sorte de respiration. En général, ces plantes contiennent
une grande quantité d ’azote. On peut même dire que, de
toutes les productions végétales, ce sont celles qui sont le
plus fortement azotées.
Les champignons, après avoir émis leurs spores ou sémi-
nules, entrent presque tous plus ou moins promptement
en décomposition. La plupart d ’entre eux exhalent, en se
décomposant, une odeur fétide que l ’on pourrait appeler
cadavéreuse.
Les espèces à consistance presque ligneuse, comme sont
plusieurs Polypores, divers Hydnes et même divers .Agarics
(Marasmius), se décomposent lentement et le plus souvent
sans exhalaison fétide. Toutes ces plantes, en se désorganisant,
laissent sur le sol un détritus singulièrement propre
à favoriser la végétation d ’autres plantes, qui, l ’année suivante,
viendront là où les champignons ont laissé leurs
dépouilles.
Après avoir parlé des différents principes dont la chimie
a constaté la présence dans les champignons, j ’arrive enfin
à celui de tous qui doit nous intéresser davantage, mais
sur lequel cette science ne nous a malheureusement presque
rien appris, bien que des recherches sérieuses aient été
faites à ce sujet : je veux parler de leur principe toxique.
Et d ’abord, co principe est-il le même dans tontes les
espèces malfaisantes? Cela est plus que douteux, puisque,'
comme nous le verrons plus loin, les effets toxiques sont
différents selon les espèces. Dans les u n e s , ce principe
agit comme poison narcotique; dans d ’autres, comme
poison âcre, irritant; et, dans d’autres encore, tout à la fois
comme poison âcre et narcotique.
Différent par son mode d ’action sur l ’économie animale,
l ’élément toxique doit différer aussi par ses propriétés chimiques.
Ce que nous savons du principe narcotique, c ’est q u ’il
est soluble daus l ’eau, dans l ’alcool, dans l ’éther et les
acides faibles, au moyen d ’une macération plus ou moins
prolongée; q u ’il n ’est détruit ni par l ’ébullition, ni par la
dessiccation, et, do plus, q u ’il n’est décomposé ni précipité
par les acides, les alcalis faibles, l’acétate de plomb, la
noix de galle ou le tannin ; que, de plus, il n ’a ni odeur ni
saveur.
Ce principe est généralement regardé comme un alcaloïde.
Il est permis toutefois de mettre en doute si véritablement
c ’est un alcalo'ide, puisque l ’on n ’est pas parvenu
encore à l’isoler entièrement, et que jusqu ’à présent il n ’a
pas été possible de l ’obtenir cristallisé. Comme il se rencontre
plus particnlièrement dans la section des Amanites,
AI. le docteur Letellier, savant mycologiste, a cru devoir,
il y a bien des années déjà, lui imposer le nom A'Amn-
niline.
On ne sait pas si l ’amanitine n ’existe que dans les Amanites,
ou si ce n ’est pas cette même substance qui donne
aux Clathres et aux Phallus les propriétés délétères et
narcotiques qui caractérisent aussi ces champignons.
AI. lîoudier, mycologiste et chimiste distingué, pense
avoir trouvé dans l’Amanite bulbeuse un autre principe
toxique q u ’il regarde aussi comme étant de nature alcaloïde,
et qu il propose d ’appeler Bulhosine, principe qui serait
tout à fait différent de l ’amanitine de M. Letellier, ce que
celui-ci conteste. Je le rép è te , l ’amanitine et la bulbosine
n ont pas été ju sq u ’alors suffisamment séparées des autres
éléments, pour que l ’on puisse prononcer si elles constituent
un seul et même principe ou des principes différents, et
même si le principe toxique est véritablement un alcaloïde.
r i t i