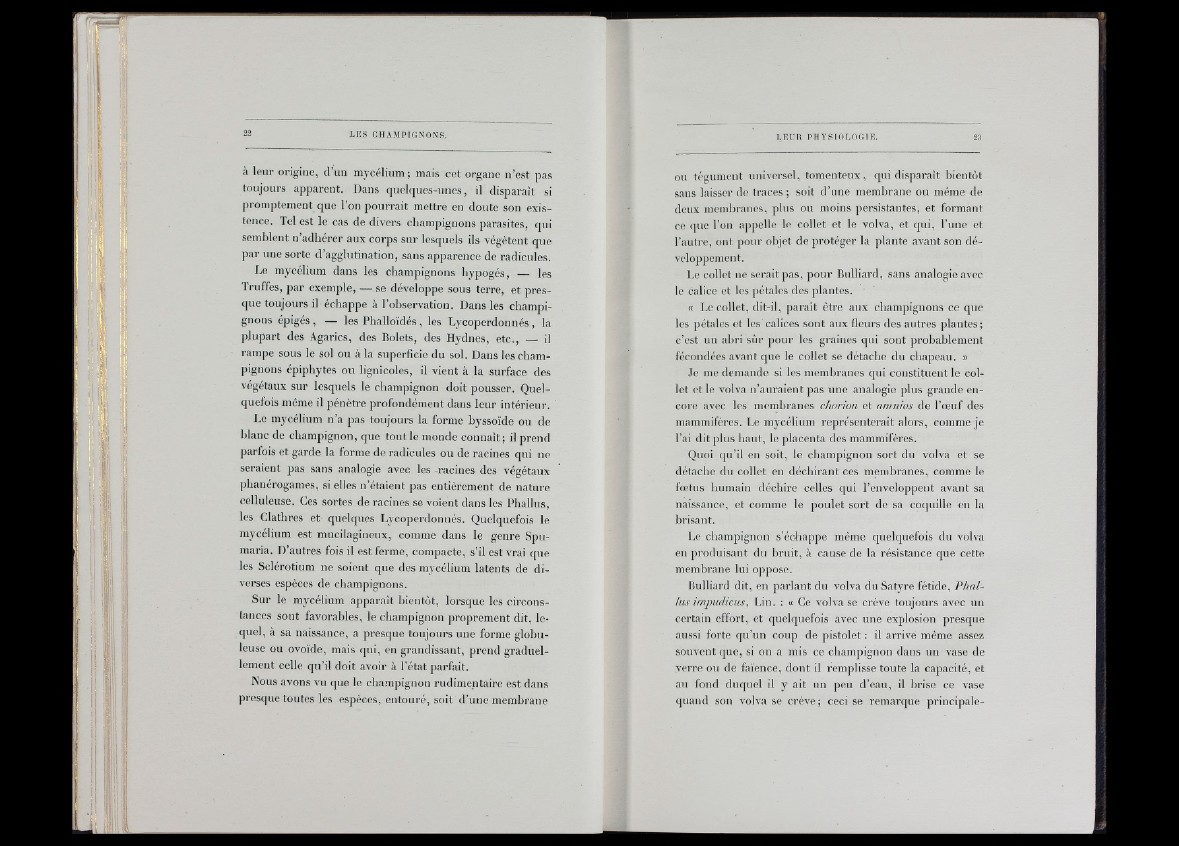
à leur origine, d ’un mycélium; mais cet organe n ’est pas
toujours apparent. Dans quelques-unes, il disparaît si
])romptement que l ’on pourrait mettre en doute son existence.
Tel est le cas de divers champignons parasites, qui
semblent n ’adhérer aux corps sur lesquels ils végètent que
par une sorte d ’agglutination, sans apparence de radicules.
Le mycélium dans les champignons hyp o gé s, — les
Truffes, par exemple, — se développe sous terre, et presque
toujours il échappe à l ’observation. Dans les champignons
épigés , — les P h alloïd é s, les L y cop e rd on n és, la
plupart des Agarics, des Bolets, des Hydnes, etc ., — il
rampe sons le sol ou à la superficie du sol. Dans les champignons
épiphytes ou lignicoles, il vient à la surface des
végétaux sur lesquels le champignon doit pousser. Quelquefois
même il pénétre profondément dans leur intérieur.
Le mycélium n ’a pas toujours la forme byssoïde ou de
blanc de champignon, que tout le monde connaît; il prend
parfois et garde la forme de radicules ou de racines qui ne
seraient pas sans analogie avec les racines des végétaux
|jlianérogames, si elles n ’étaient pas entièrement de nature
celluleuse. Ces sortes de racines se voient dans les Phallus,
les Clathres et quelques Lycoperdonnés. Quelquefois le
mycélium est mucilagineux, comme dans le genre Spu-
maria. D ’autres fois il est ferme, compacte, s’il est vrai que
les Sclérotium ne soient que des mycélium latents de diverses
espèces de champignons.
Sur le mycélium apparaît bientôt, lorsque les circonstances
sont favorables, le champignon proprement dit, le quel,
à sa naissance, a presque toujours une forme globuleuse
ou ovoïde, mais qui, en grandissant, prend graduellement
celle q u ’il doit avoir à l ’état parfait.
Nous avons vu que le champignon rudimentaire est dans
presque toutes les espèces, entouré, soit d ’une membrane
ou tégument universel, tomenteux, qui disparaît bientôt
sans laisser de traces ; soit d ’une membrane ou même de
deux membranes, plus ou moins persistantes, et formant
ce (pie l ’on appelle le collet et le volva, et qui, l ’une et
l ’autre, ont pour objet de protéger la plante avant son développement.
Le collet ne serait pas, pour Bulliard, sans analogie avec
le calice et les pétales des plantes.
« Le collet, dit-il, paraît être aux champignons ce que
les pétales et les calices sont aux fleurs des autres plantes;
c ’est un abri sûr pour les graines qui sont probablement
fécondées avant que le collet se détache du chapeau. »
,1e me demande si les membranes qui constituent le collet
et le volva n ’auraient pas une analogie plus grande encore
avec les membranes chorion et amnios de l ’oeuf des
mammifères. Le mycélium représenterait alors, comme je
l ’ai dit plus haut, le placenta des mammifères.
Quoi qu’il en soit, le champignon sort du volva et se
détache du collet en déchirant ces membranes, comme le
foetus humain déchire celles qui l ’enveloppent avant sa
naissance, et comme le poulet sort de sa coquille eu la
brisant.
Le cliampignou s’écliappe même quelquefois du volva
eu produisant du bruit, à cause de la résistance que cette
membrane lui oppose.
Bulliard dit, en parlant du volva du Satyre fétide, P h a llus
impudicus, Lin. : k Ce volva se crève toujours avec un
certain effort, et quelquefois avec une explosion presque
aussi forte q u ’un coup de pistolet ; il arrive même assez
souvent que, si on a mis ce champignon dans un vase de
verre ou de faïence, dont il remplisse toute la capacité, et
au fond duquel il y ait un peu d ’eau, il brise ce vase
quand son volva se crève ; ceci se remarque principale