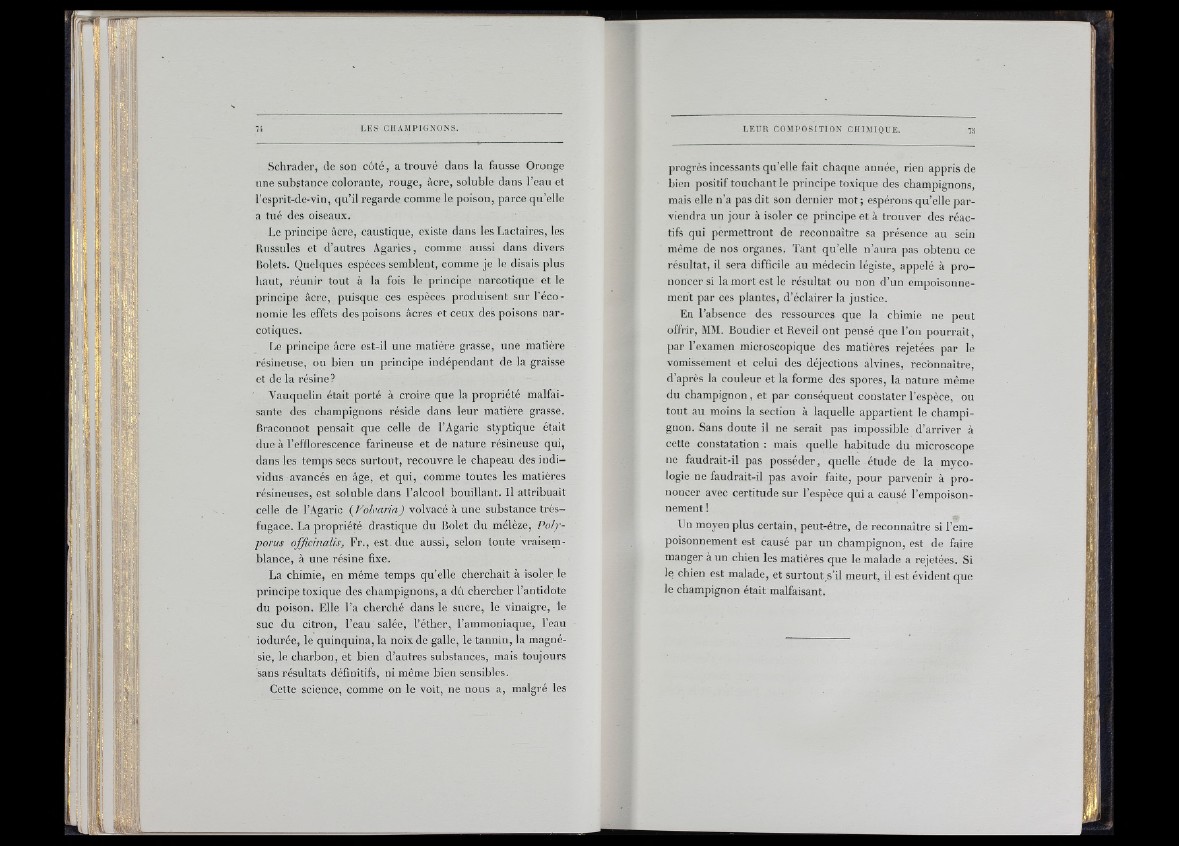
L E U R C O M P O S I T I O N C H I M I Q U E .
m
Schrader, de son c ô té , a trouvé dans la fausse Oronge
une substance colorante, rouge, âcre, soluble dans l ’eau et
l ’esprit-de-vin, q u ’il regarde comme le poison, parce q u ’elle
a tué des oiseaux.
Le principe âcre, caustique, existe dans les Lactaires, les
Russules et d ’autres Agarics, comme aussi dans divers
Bolets. Quelques espèces semblent, comme je le disais plus
haut, réunir tout à la fois le principe narcotique et le
principe âcre, puisque ces e,spèccs produisent sur l ’é c o nomie
les effets des poisons âcres et ceux des poisons narcotiques.
r.e principe âcre est-il une matière grasse, une matière
résineuse, ou bien un principe indépendant de la graisse
et de la résine?
Vauquelin était porté à croire que la propriété malfaisante
des champignons réside dans leur matière grasse.
Braconnot pensait que celle de l ’Agaric styptique était
due à l ’efflorescence farineuse et de nature résineuse qui,
dans les temps secs surtout, recouvre le chapeau des individus
avancés en âge, et qui, comme toutes les matières
résineuses, est soluble dans l ’alcool bouillant. Il attribuait
celle de l ’Agario (Folvaria) volvacé à une substance très -
fugace. La propriété drastique du Bolet du mélèze, Poly-
poriis officiiialis, Fr., est. due aussi, selon toute vraisemblance,
à une résine fixe.
La chimie, en même temps q u ’elle cherchait à isoler le
principe toxique des champignons, a dû chercher l ’antidote
du poison. Elle l ’a cherché dans le sucre, le vinaigre, le
suc du citron, l ’eau salée, l ’éther, l ’ammoniaque, l ’eau
iodurée, le quinquina, la noix de galle, le tannin, la magnésie,
le charbon, et bien d ’autres substances, mais toujours
sans résultats définitifs, ni même bien sensibles.
Cette science, comme on le voit, ne nous a, malgré les
progrès incessants q u ’elle fait chaque année, rien appris de
bien positif touchant le principe toxique des champignons,
mais elle n’a pas dit son dernier mot ; espérons q u ’elle parviendra
un jou r à isoler ce principe et à trouver des réactifs
qui permettront de reconnaitre sa présence au sein
même de nos organes. Tant q u ’e lle n ’aura pas obtenu ce
résultat, il sera difficile au médecin légiste, appelé à prononcer
si la mort est le résultat ou non d ’un empoisonnement
par ces plantes, d ’éclairer la justice.
En l ’absence des ressources que la chimie ne peut
offrir, ATM, Boudier et Reveil ont pensé que l ’on pourrait,
par l ’examen microscopique des matières rejetées par le
vomissement et celui des déjections alvines, reconnaître,
d ’après la couleur et la forme des spores, la nature même
du champignon , et par conséquent constater l ’espèce, ou
tout au moins la section à laquelle appartient le champignon.
Sans doute il ne serait pas impossible d ’arriver à
cette constatation : mais quelle habitude du microscope
lie faudrait-il pas posséder, quelle étude de la my cologie
ne faudrait-il pas avoir faite, pour parvenir à p rononcer
avec certitude sur l ’espèce qui a causé l ’empoisonnement
!
l;u moyen plus certain, peut-être, de reconnaître si l ’em-
poisonnenient est causé par un champignon, est de faire
manger à un chien les matières que le malade a rejetées. Si
le chien est malade, et surtout s’il meurt, il est évident que
le champignon était malfaisant.