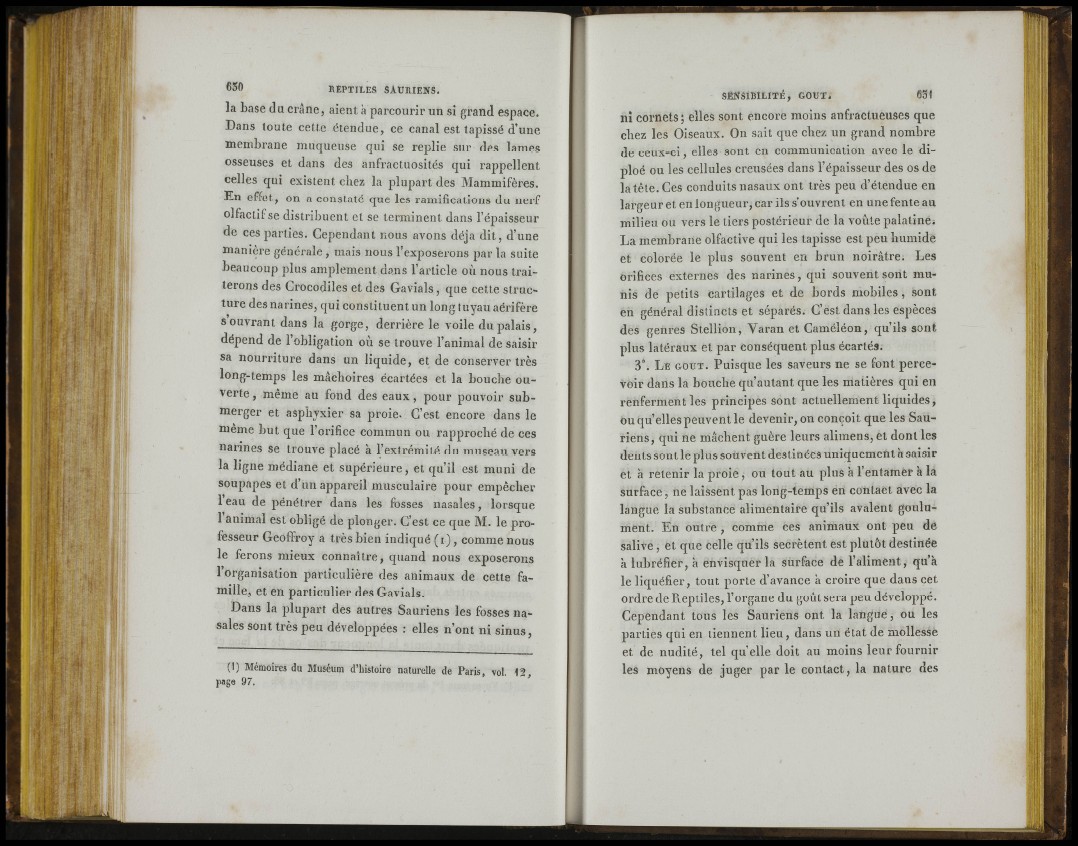
«JI <s I' (
' uli
1 " HI f Ji
f il
> Í ' • Ï Î i
650 REPTILES SAURIENS.
la base da crâne, aient à parcourir un si grand espace.
Dans toute cetfe étendue, ce canal est tapissé d'une
membrane muqueuse qui se replie sur des lames
osseuses et dans des anfractuosités qui rappellent
celles qui existent chez la plupart des Mammifères.
En effet, on a constaté que les ramifications du nerf
olfactif se distribuent et se terminent dans l'épaisseur
de ces parties. Cependant nous avons déjà dit, d'une
manière générale , mais nous l'exposerons par la suite
beaucoup plus amplement dans l'article où nous traiterons
des Crocodiles et des Gavials, que cette structure
des narines, qui constituent un long tuyau aérifère
s ouvrant dans la gorge, derrière le voile du palais,
dépend de l'obligation où se trouve l'animal de saisir
sa nourriture dans un liquide, et de conserver très
long-temps les mâchoires écartées et la bouclie ouverte
, même au fond des eaux, pour pouvoir submerger
et asphyxier sa proie. C'est encore dans le
même but que l'orifice commun ou rapproché de ces
narines se trouve placé à l'extrémité du museau vers
la ligne médiane et supérieure, et qu'il est muni de
soupapes et d'un appareil musculaire pour empêcher
l'eau de pénétrer dans les fosses nasales, lorsque
l'animal est obligé de plonger. C'est ce que M. le professeur
Geoffroy a très bien indiqué ( i ) , comme nous
le ferons mieux connaître, quand nous exposerons
l'organisation particulière des animaux de cette famille,
et en particulier des Gavials.
Dans la plupart des autres Sauriens les fosses nasales
sont très peu développées ; elles n'ont ni sinus,
(1) Mémoires du Muséum d'histoire naturelle de Paris, vol.
page 97.
SENSIBILITÉ, GOUT. 65 t
nî cornets ; elles sont encore moins anfractueuses que
chez les Oiseaux. On sait que chez un grand nombre
de ceux-ci, elles sont en communication avec le diploé
ou les cellules creusées dans l'épaisseur des os de
la tête. Ces conduits nasaux ont très peu d'étendue en
largeur et en longueur, car ils s'ouvrent en une fente au
milieu ou vers le tiers postérieur de la voûte palatine.
La membrane olfactive qui les tapisse est peu humide
et colorée le plus souvent en brun noirâtre. Les
orifices externes des narines, qui souvent sont munis
de petits cartilages et de bords mobiles , sont
en général distincts et séparés. C'est dans les espèces
des genres Stellion, Varan et Caméléon, qu'ils sont
plus latéraux et par conséquent plus écartés.
3°. L e GOUT. Puisque les saveurs ne se font percevoir
dans la bouche qu'autant que les matières qui en
renferment les principes sont actuellement liquides,
ou qu'elles peuvent le devenir, on conçoit que les Sauriens,
qui ne mâchent guère leurs alimens, et dont les
dents sont le plus souvent destinées uniquement à saisir
et à retenir la proie, ou tout au plus à l'entamer à la
surface, ne laissent pas long-temps en contact avec la
langue la substance alimentaire qu'ils avalent goulûment.
En outre , comme ces animaux ont peu de
salive , et que celle qu'ils secrètent est plutôt destinée
à lubréfier, à envisquer la surface de l'aliment, qu'à
le liquéfier, tout porte d'avance à croire que dans cet
ordre de Poeptiles, l'organe du goût sera peu dévelo^îpé.
Cependant tous les Sauriens ont la langue, ou les
parties qui en tiennent lieu, dans un état de mollesse
et de nudité, tel qu'elle doit au moins leur fournir
les moyens de juger par le contact, la nature des