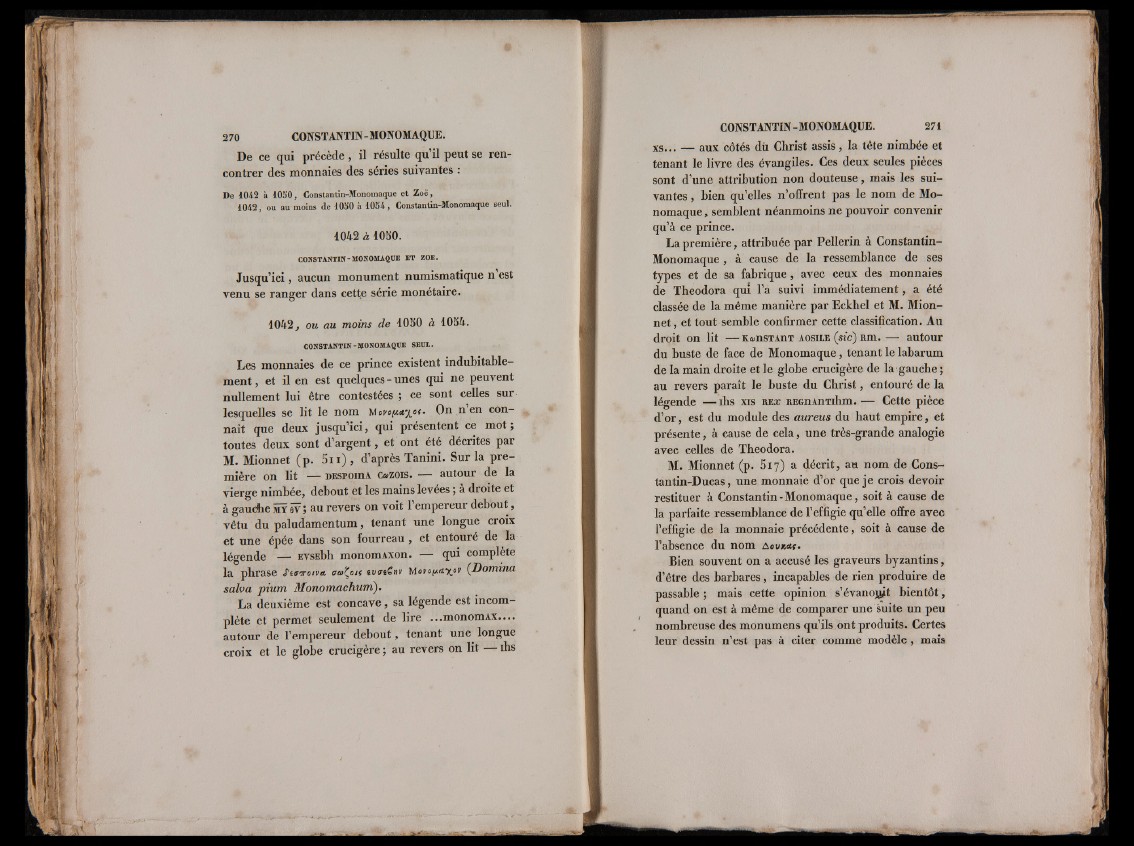
De ce qui précède, il résulte qu’il peut se rencontrer
des monnaies des séries suivantes :
D e 1 0 4 2 à 1 0 5 0 , C o n s ta n t in -M o n om a q u e e t Z o ë ,
1042, o u a u m o in s d e 1050 a 105 4 , C o n s ta n t in -M o n om a q u e s e u l.
1042 à 1050.
CONSTANTIN-MONOMAQUE ET ZOE.
Jusqu’ic i , aucun monument numismatique n est
venu se ranger dans cette série monétaire.
1042, ou au moins de 1050 à 1054.
CONSTANTIN-MONOMAQUE SEUL.
Les monnaies de ce prince existent indubitablement,
et il en est quelques-unes qui ne peuvent
nullement lui être contestées ; ce sont celles sur
lesquelles se lit le nom M On n en connaît
que deux jusqu’ici, qui présentent ce mot j
toutes deux sont d’argent, et ont été décrites par
M. Mionnet (p. 5 n ) , d’après Tanini. Sur la première
on lit — DESPOinA caizoïs. — autour de la
vierge nimbée, debout et les mains levées ; à droite et
à gauche mï üv S au revers on voit 1 empereur debout,
vêtu du paludamentum, tenant une longue croix
et une épée dans son fourreau, et entouré de la
légende — Evssbh monomAXon. — qui complète
la phrase S'ifirotva. oo^oif ivvtCnv Movo^tf^ov (Domina
salva pium Monomachum).
La deuxième est concave, sa légende est incomplète
et permet seulement de lire ...monomAX....
autour de l’empereur debout, tenant une longue
croix et le globe crucigère ; au revers on lit ihs
xs... — aux côtés dix Christ assis, la tête nimbée et
tenant le livre des évangiles. Ces deux seules pièces
sont d’une attribution non douteuse, mais les suivantes
, bien qu’elles n’offrent pas le nom de Monomaque
, semblent néanmoins ne pouvoir convenir
qu’à ce prince.
La première, attribuée par Pellerin à Constantin-
Monomaque, à cause de la ressemblance de ses
types et de sa fabrique, avec ceux des monnaies
de Theodora qui l’a suivi immédiatement, a été
classée de la même manière par Eckhel et M. Mionnet,
et tout semble confirmer cette classification. Au
droit on lit — KansTAnT aosile (sic) nm.— autour
du buste de face de Monomaque, tenant le labarum
de la main droite et le globe crucigère de la gauche ;
au revers paraît le buste du Christ, entouré de la
légende — ihs xis r e x REGnAnnhm. — Cette pièce
d’or, est du module des aureus du haut empire, et
présente, à cause de cela, une très-grande analogie
avec celles de Theodora.
M. Mionnet (p. 517) a décrit, aH nom de Cons-
tantin-Ducas, une monnaie d’or que je crois devoir
restituer à Constantin - Monomaque, soit à cause de
la parfaite ressemblance de l’effigie qu’elle offre avec
l’effigie de la monnaie précédente, soit à cause de
l’absence du nom aoi/jwî .
Bien souvent on a accusé les graveurs byzantins,
d’être des barbares, incapables de rien produire de
passable ; mais cette opinion s’évanoj^t bientôt,
quand on est à même de comparer une suite un peu
nombreuse des monumens qu’ils ont produits. Certes
leur dessin n’est pas à citer comme modèle, mais