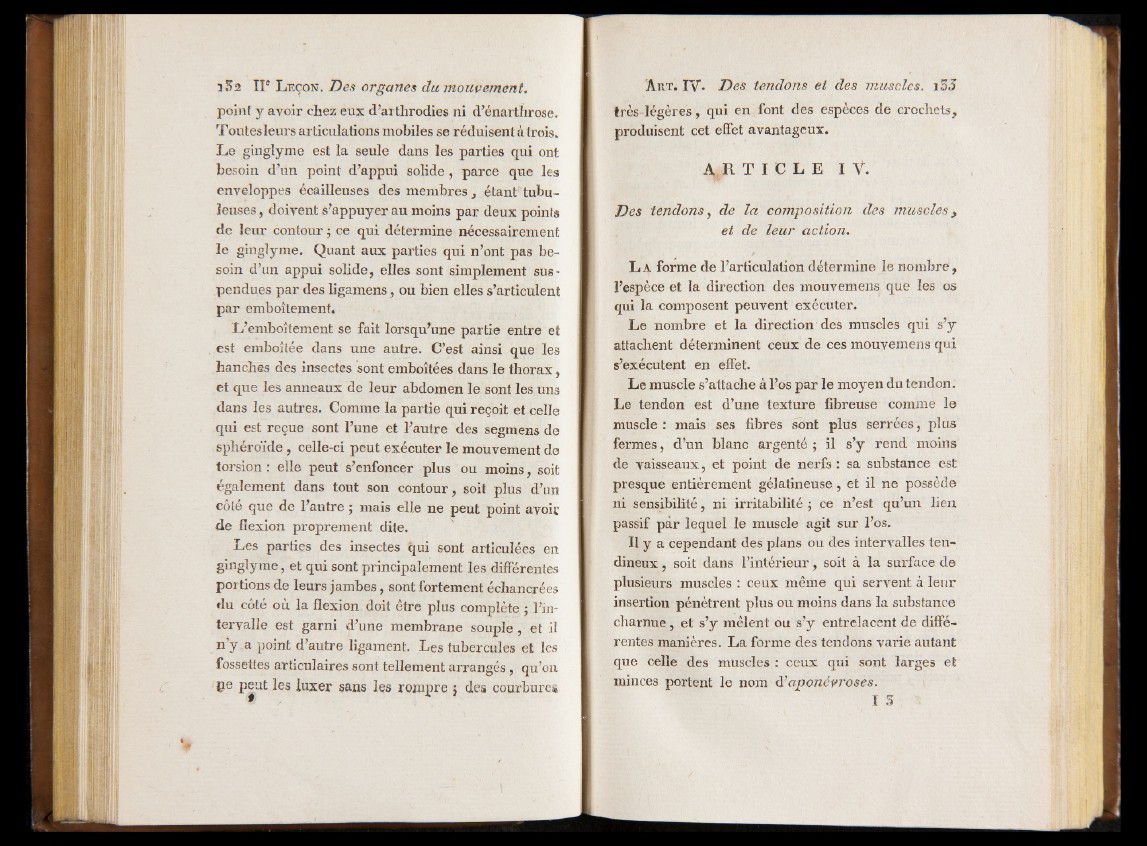
3 5a IIe L eçon. Des organes du mouvement.
point y avoir chez eux d’arthrodies ni d’énarthrose.
Toutes leurs articulations mobiles se réduisent à trois»
Le ginglyme est la seule dans les parties qui ont
besoin d’un point d’appui solide, parce que les
enveloppes écailleuses des membres, étant1 tubuleuses
, doivent s’appuyer au moins par deux points
de leur contour ; ce qui détermine nécessairement
le ginglyme. Quant aux parties qui n’ont pas besoin
d’un appui solide, elles sont simplement sus*
pendues par des ligamens, ou bien elles s’articulent
par emboîtement.
L ’emboîtement se fait lorsqu’une partie entre et
est emboîtée dans une autre. C’est ainsi que les
hanches des insectes sont emboîtées dans le thorax,
et que les anneaux de leur abdomen le sont les uns
dans les autres. Comme la partie qui reçoit et celle
qui est reçue sont l’une et l’autre des segmens de
sphéroïde, celle-ci peut exécuter le mouvement de
torsion : elle peut s’enfoncer plus ou moins, soit
également dans tout son contour, soit plus d’un
coté que de l ’autre ; mais elle ne peut point avoir
de flexion proprement dite.
Les parties des insectes qui sont articulées en
ginglyme, et qui sont principalement les differentes
portions de leurs jambes, sont fortement échancrées
du côté où la flexion doit être plus complète ; l’in-
teryalle est garni d’une membrane souple , et il
n y a point d’autre ligament. Les tubercules et les
fossettes articulaires sont tellement arrangés, qu’on
pe peut les luxer sans les rompre $ des courbures
très-légères, qui en font des espèces de crochets,
produisent cet effet avantageux.
A II T I C L E I V .
Des tendons y de la composition des muscles y
et de leur action.
L a forme de l’articulation détermine le nombre,
l’espèce et la direction des mouvemens que les os
qui la composent peuvent exécuter.
Le nombre et la direction des muscles qui s’y
attachent déterminent ceux de ces mouvemens qui
s’exécutent en effet.
Le muscle s’attache à l’os par le moyen du tendon.
Le tendon est d’une texture fibreuse comme le
muscle : mais ses fibres sont plus serrées, plus
fermes, d’un blanc argenté ; il s’y rend moins
de vaisseaux, et point de nerfs: sa substance est
presque entièrement gélatineuse, et il ne possède
ni sensibilité, ni irritabilité ; ce n’est qu’un lien
passif par lequel le muscle agit sur l’os.
Il y a cependant des plans ou des intervalles tendineux
, soit dans l’intérieur, soit à la surface de
plusieurs muscles : ceux même qui servent à leur
insertion pénètrent plus ou moins dans la substance
charnue, et s’y mêlent ou s’y entrelacent de différentes
manières. La forme des tendons varie autant
que celle des muscles : ceux qui sont larges et
minces portent le nom à’aponévroses. I 3