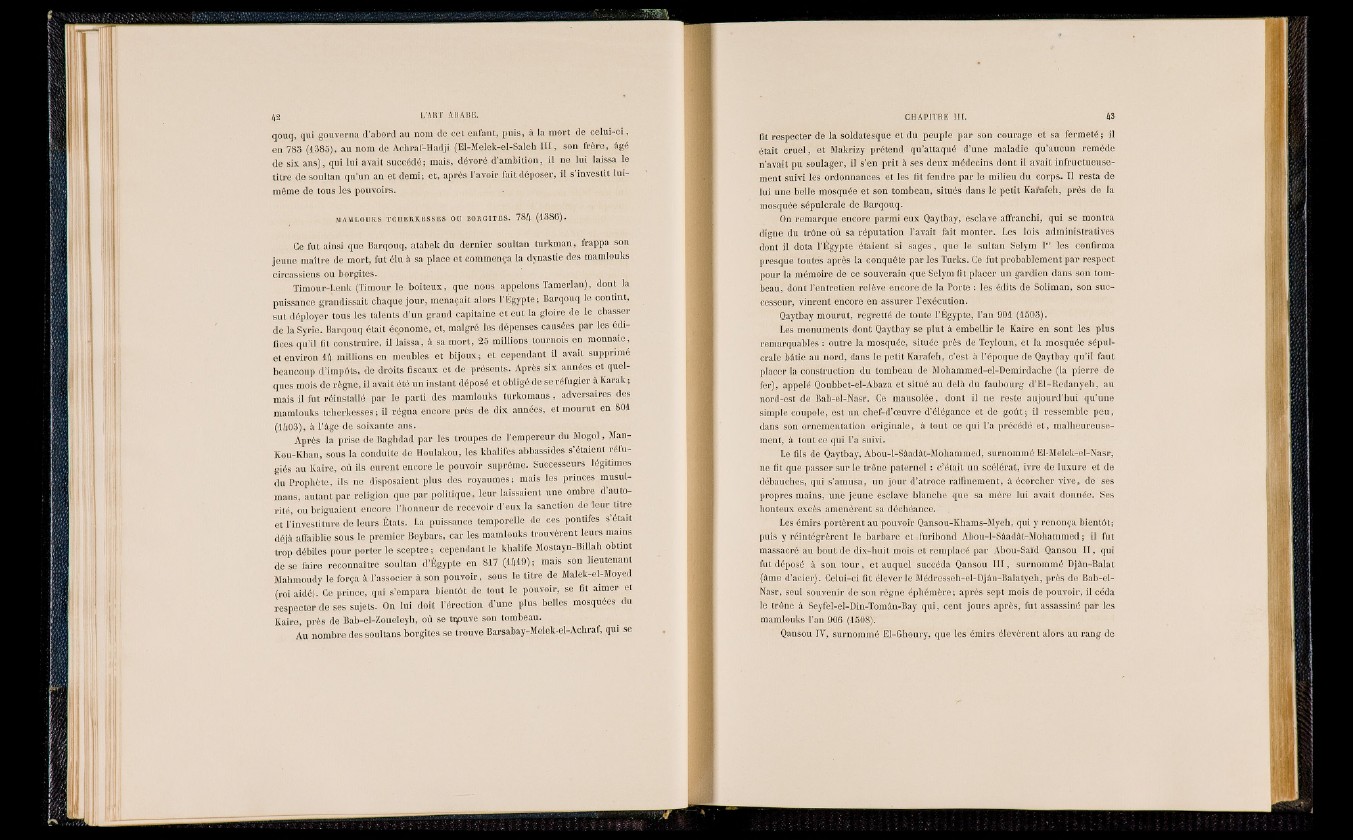
qouq, qui gouverna d’abord au nom de cet enfant, puis, à la m o rt de c e lu i-c i,
en 783 (1385)* au nom de Achraf-Hadji (El-Melek-el-Saleh I I I , son frè re , âgé
de six ans), qui lu i avait succédé; mais, dévoré d ’ambition, il ne lu i laissa Ie
titre de soultan qu’u n an et demi; et, après l ’avoir fait d époser, il s’investit lu i-
même de tous les pouvoirs.
M AM tO U K S T C H E R K .B S S E S OU B O R G IT E S . 7 8 A ( 1 3 8 6 ) .
Ce fut ainsi que Barqouq, atabek du d e rn ie r soultan tu rkm an , frappa son
jeu n e maître de mort, fut élu à sa place et commença la dynastie des mamlouks
circassiens ou borgites.
Timour-Lenk (Timour le b o ite u x , que nous appelons Tamerlan), dont la
puissance grandissait chaque jour, menaçait alors l’Égypte; Barqouq le contint,
su t déployer tous les talents d’un grand capitaine e t eu t la gloire de le cbasser
de la Syrie. Barqouq était économe, et, malgré les dépenses causées p a r les édifices
qu'il fit construire, il laissa, à sa m o rt, 25 millions tournois en monnaie,
et environ lit millions en meubles e t bijoux; et cependant il avait supprimé
beaucoup d ’impôts, de droits fiscaux et de présents. Après, six années et quelques
mois de règne, il avait été u n instant déposé e t obligé de se réfugier à Karak ;
mais il fu t réinstallé p a r le pa rti des mamlouks tu rk om an s , adversaires des
mamlouks tcherkesses ; il rég n a encore près de dix années, e t mo u ru t en 801
(1403), à l’âge de soixante ans.
Après la prise de Baghdad p a r les troupes de l’empereur du Mogol, Man-
Kou-Khan, sous la conduite de Houlakou, les khalifes abbassides s étaient réfugiés
au Kaire, où ils eu re n t encore le pouvoir suprême. Successeurs légitimes
du P ro p h è te ,d is ne disposaient plus des royaumes; mais les princes musulmans,
autant p a r religion que p a r p o litiq u e , leu r laissaient une ombre d autorité
, ou b riguaient encore l ’honneur de recevoir d ’eux la sanction de l e u r titre
e t l’investiture de leurs États, ha puissance temporelle de ces pontifes s’était
déjà affaiblie sous le p rem ie r Beybars, car les mamlouks trouvèrent leurs mains
trop débiles p o u r po rte r le sceptre ; cependant le khalife Mostayn-Billah obtint
de se faire reconnaître soultan d ’Égypte en 817 (1419); mais son lieutenant
Mahmoudy le força à l’associer à son pouvoir, sous le titre de Malek-el-Moyed
(roi aidé). Ce prince, qui s’empara bientôt de to u t le pouvoir, se fit aimer et
re sp ec te r de ses sujets. On lu i doit l’érection d’une plus belles mosquée|,;du
Kaire, p rè s de Bab-el-Zoueleyh, où se trouve son tombeau.
Au nombre dessoultans borgites se trouve Barsabay-Melek-el-Achraf, qui se
fit respecter de la soldatesque e t du peuple p a r son courage e t sa fe rm e té ; il
était c ru e l, e t Makrizy prétend q u ’attaqué d ’une maladie qu’aucun remède
n’avait pu soulager, il s’en p rit à ses deux médecins dont il avait infructueusement
suivi les ordonnances e t les fit fendre p a r le milieu du corps- Il resta de
lui une belle mosquée e t son tombeau, situés dans le pe tit Karafeh, près de la
mosquée sépulcrale de Barqouq.
On remarque encore parmi eux Qaytbay, esclave affranchi, qui se montra
digne du trône où sa réputation l ’avait fait monter. Les lois administratives
dont il dota l ’Égypte é taient si s ag e s , que le sultan Selym Ior les Confirma
presque toutes après la conquête p a r les Turks. Ce fut p robablement p a r respect
pour la mémoire de ce souverain que Selym fit placer un gardien dans son tombeau,
dont l’entretien relève encore de la Porte : les édits de Soliman, son successeur,
v inrent encore en assurer l’exécution.
Qaytbay mourut, reg re tté de toute l’Égypte, l’an 901 (1503).
Les monuments dont Qaytbay se p lu t à embellir le Kaire en sont les plus
remarquables : outre la mosquée, située près de Teyloun, e t la mosquée sépulcrale
bâtie au nord, dans le pe tit K arafeh, c’est à l ’époque de Qaytbay qu ’il faut
placer la construction du tombeau de Mohammed-el-Demirdache (la p ie rre de
fer), appelé Qoubbet-el-Abaza e t situé au delà du faubourg d’El-Redanyeh, au
nord-est de Bab-el-Nasr. Ce mausolée, dont il ne reste aujourd’hui qu’une
simple coupole, est un chef-d’oeuvre d’élégance et de g o û t; il ressemble p eu ,
dans son ornementation originale,, à tout ce qui l’a précédé e t , malheureusement,
à tout ce qui l’a suivi.
Le fils de Qaytbay, Abou-l-Sâadât-Mohammed, surnommé Ei-Melelc-el-Nasr,
ne fit que passer sur le trône paternel : c’était u n scélérat, ivre de lu x u re et de
débauches, qui s’amusa, u n jo u r d’atroce raffinement, à é corcher vive, de ses
propres mains, une jeu n e esclave blanche que sa mère lu i avait donnée. Ses
honteux excès amenèrent sa déchéance.
Les émirs portèrent au pouvoir Qansou-Khams-Myeh, qui y renonça bientôt;
puis y réintégrèrent le b arbare et .furibond Abou-l-Sâadât-Mohammed ; il fut
massacré au bout de dix-huit mois e t remplacé p a r Abou-Saïd Qansou I I , qui
fut déposé à son to u r , e t auquel succéda Qansou I I I , surnommé Djân-Balat
(âme d’a cier). Celui-ci fit élever le Médresseh-el-Djân-Balatyeh, près de Bab-el-
Nasr, seul souvenir de son règne éphémère; après sept mois de pouvoir, il céda
le trôné à Seyfel-el-Din-Tomân-Bay q u i, cent jo u rs après, fu t assassiné p a r les
mamlouks l’an 906 (1508).
Qansou IV, surnommé El-Ghoury, que les émirs élevèrent alors au rang de