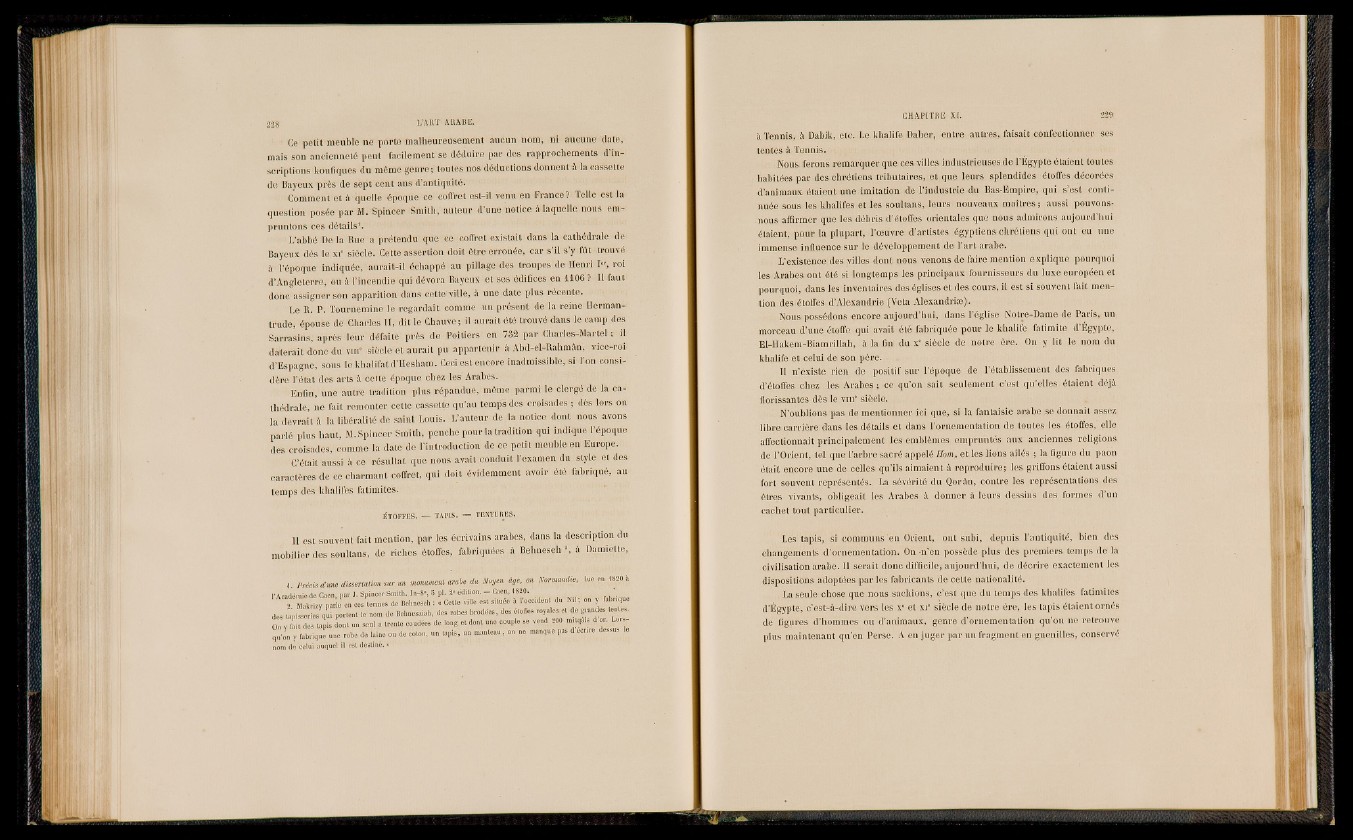
Ce petit meuble ne porte malheureusement aucun nom, ni aucune date,
mais son ancienneté peut facilement se déduire par des rapprochements d'inscriptions
koufiques du môme genre ; toutes nos déductions donnent à la cassette
de Bayeux près de sèpt cent ans d ’antiquité.
Comment e t à quelle époque ce coffret est-il venu en France? Telle est la
question posée p a r M. Spincer Smith, au teu r d’une notice à laquelle nous empruntons
ces détails1.
L’abbé De la Rue a prétendu que ce coffret existait dans la cathédrale de
Bayeux dès le xt' siècle. Cette assertion doit ê tre erronée, car s’il s’y fût trouvé
à l’époque indiquée, au ra it-il échappé au pillage des troupes de Henri p roi
d ’Angleterre, ou il l’incendie qui dévora Bayeux et ses édifices en 1106’? Il faut
donc assigner son apparition dans cette'ville, à une date plus récente.
t e R. P. Tournemine le regardait com ù é ïiu n présent de Ta'reine'Hermank'
tru d e , épouse de Charles II, dit le Chauve; il aura it été trouvé'dans le camp des
Sarrasins, après leu r défaite près de Poitiers en 732 par Charles-Martel ; il
da te ra it donc du vin* siècle e t au ra it pu appartenir il Abd-el-Rahmân, vice-roi
d’Espagne, sous le kh a lifa td ’Hesham. Ceci est encore inadmissible, si' Ppn considère
l’état des arts il celte époque: chez les Arabes. "
Enfin, une au tre tradition plus répandue, même parmi le clergé de la cathédrale,
ne fait remonter cette cassette qu’au temps des; croisades ■; dès lors on
la devrait à la libéralité de saint Louis. L’auteur de la notice dont nous avons
parlé plus h aut, M.Spincer Smith, p e n c h e pour la tradition qui indique l'époque
des croisades, comme la date de l’introduction de ce petit meuble en Europe,:'
C’était aussi h ce ré su lta t que nous avait'conduit l’examen du style et des
caractères de ce charmant coffret, qui doit évidemment avoir été fabriqué, au
temps des khalifes fatimites.
ÉTOFFES. — TAPIS. — TENTURES.
Il est souvent fait mention, p a r les écrivains arabes, dans la description du
mobilier des s o u lta n Ê d e riches étoffes, fabriqué«; à Behneseh % à Damielte,
4 . ¡ i S m Ê Î dissertation su r un monument arabe du Moyen Age, en Normandie, tuo on 1820 |
l'Académie de Caen, par J. Spincer Smith. In-8°, 5 pl. 2°. édition. — Caen, 4820.
J Makrizy parle en ces termes de Behneseh : « Cette Mlle e t itaéo h l’occident du NU; on y fabrique
des tapisseries qui perlent le nom-do Bolincsaiali, des robes brodées, des étoiles royales, et de grandes Iqntes,
IB— dont un seul a ¡ ¡ ■ H d e jo n g e t dont une couple se vend 200 H B B g
qii'M y fabrique uno robe de ialno ou de colon. Un tapis, un manteau, on ne manque pas d écrire de» u s le
nom île celui auquol ¡1 est dèstmé. »M
à Tennis, à Dabik, etc. Le khalife Daher, en tre autres, faisait confectionner ses
tentes à Tennis.
Nous ferons rem a rq u e r que ces villes industrieuses de l ’Égypte é taient toutes
habitées p a r des chrétiens tributaires, et que leurs splendides étoffes décorées
d ’animaux é taient une imitation de l’industrie du Bas-Empire, qui s’est contin
u é e sous les khalifes.et les soultans, leurs nouveaux maîtres ; aussi pouvons-
nous affirmer que les débris d’étoffes orientales que nous admirons au jo u rd ’hui
étaient, p our la plupart, l'oeuvre Æartistes-égyptiens chrétiens qui ont eu une
immense influence su r le développement .de 1 a rt arabe.
L’existence des villes dont nous venons de faire mention explique pourquoi
les Arabes ont été si longtemps ies principaux fournisseurs du luxe européen et
pourquoi, dans les inventaires.des églises e t des cours, il est si souvent fait mention
des'étoffes d’Alexandrie (Veta Alexandriæ).
Nous possédons encore aujo,urd’h | i | dans l ’église Notre-Dame de Paris, un
morceau d ’une étoffe qui avait été fabriquée pour le khalife fatimite d’Égyple,
El-Hakem-Biamrillah, à la fin du x*. siècle de notre ère. On y lit le nom dn
khalife et celui de son père.
Il n ’existe rien de positif su r l ’époque: de l’établissement des fabriques
d’étoffes:: chez les Arabes ; ce: qu’on sait seulement, c’est- qu’jè îfe é taient déjà
florissantes dès le vui* siècle.
N’oublions pas de mentionner ici que, si la fantaisie arabe se donnait assez
libre c arriè re dans les détails et dans l ’ornementation de toutes les étoffe^*.,elle
affectionnait principalement les emblèmes empruntés aux anciennes religions
de l ’Orient, tel que l’a rb re sacré appelé Hom, et les lions ailés ; la figure du paon
était encore une de celles qu ’ilsïaimaient à rep ro d u ire; les griffons é taient aussi
fort souvent représentés. La sévérité du Qoràn, contre les représentations des
êtres vivants, obligeait les Arabes à donner à leurs dessins des formes d ’un
cachet tout particulier.
Les tapis, si communs en Orient, ont subi, depuis l ’antiquité, bien des
changements d’ornementation. On n ’en possède plus des premiers temps de la
civilisation arabe. Il serait donc difficile, aujourd’hui; de décrire exactement les
dispositions adoptées p a rle s fabricants de celle nationalité.
La seule chose que nous sachions, c’est que du temps des khalifes fatimites
d ’Égypte, c’est-à-dire vers les x* e t xi* siècle de notre ère, les tapis é taient ornés
de figures d’hommes ou d ’animaux, genre d’ornementation qu’on ne retrouve
plus maintenant qu’en Perse. A en ju g e r p a r u n fragment en guenilles, conservé