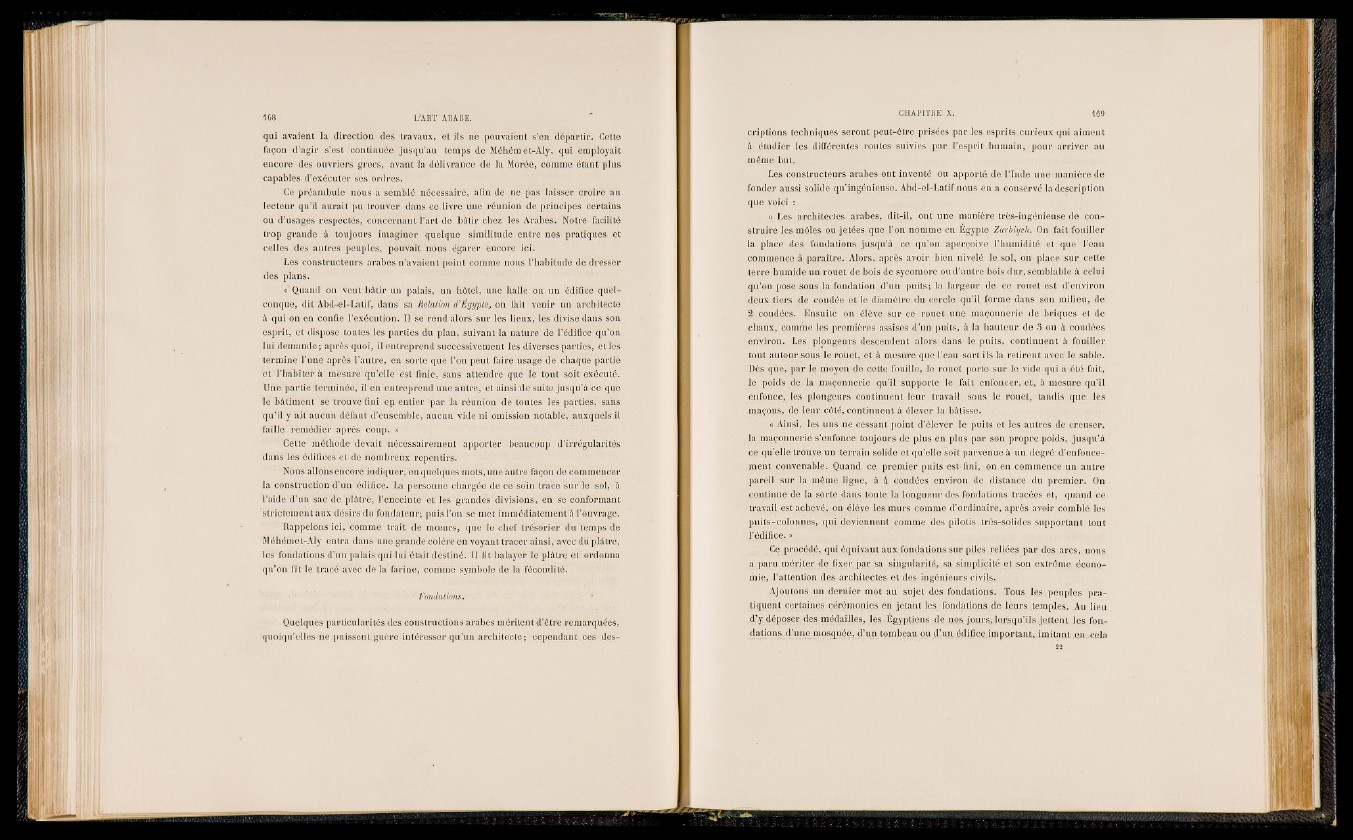
qui avaient la direction des travaux, et ils ne pouvaient s’en d épartir. Celte
façon d’agir s’e st continuée ju sq u ’au temps de Méhémet-Aly, qui employait
encore des ouvriers grecs, avant la délivrance de la Morée, comme é tan t plus
capables d ’exécuter ses ordres.
Ce préambule nous a semblé nécessaire, afin de ne pas laisser croire au
le c teu r qu ’il au ra it pu trouver dans ce livre une réunion de principes certains
ou d’usages respectés, concernant l ’a rt de b â tir chez les Arabes. Notre facilité
tro p grande à toujours imaginer quelque similitude en tre nos pratiques et
celles des autre s peuplés, pouvait nous égarer encore ici.
Les constructeurs arabes n ’avaient point comme nous l’habitude de dresser
des plans.
«' Quand on veut b â tir u n palais, un hôtel, une halle ou un édifice quelconque,
d it Abd-el-Latif, dans" sa Relation d'Egypte¿ on fait venir un architecte
à qui on en confie l ’exécution. Il se rend alors su r les lieux, les divise dans son
e sprit, e t dispose toutes les parties du plan, suivant la n a tu re de l ’édifice qu’on
lui demande; après quoi, il e ntreprend successivement les diverses p arties, et les
termine l’une après l ’au tre , en sorte que l’on peut faire usage dé chaque partie
e t l ’h abiter à mesure q u ’elle est finie, sans attendre que le tout soit exécuté.
Une partie terminée, il en en trep ren d une autre, et ainsi de suite ju sq u ’à ce que
le bâtiment sè trouve fini en entie r p a r la réunion de toutes lés partiésj saris
q u ’il y a it aucun défaut d’ensemble,'aucun vide ni omission notable, auxquels il
faille remédier après coup. »
Cette méthode devait nécessairement apporte r beaucoup d ’irrégularités
dans les édifices e t de riombreux repentirs.
Nous allons encore indiquer, en quelques riiots, une au tre façon dé commencer
la construction d ’un édifice. La personne chargée de ce soin trâèe su r lé sol, à
l ’aide d’un sac de plâtre, l ’enceinte e t les grandes divisions, en se conformant
s trictement aux désirs du fondateur; p u is l’on se met immédiateriaeritàTorivrage.
Rappélôns ici, comme tra it de moeurs, que le chef tré so rie r du temps de
Méhémet-Aly entra dans une grande colère en voyant tra c e r ainsi, avec dii plâtre,
les fondations d ’un palais qui lui était destiné. Il fit balayer le plâtre e t ordonna
qu ’on fît le tracé avec de la farine, comme symbole dé la fécondité^
Fondations.
Quelques particularités des constructions arabes méritent d ’ê tre remarquées,
quoiqu’elles rie puissent guère inté re sse r qu ’un archite cte ; cependant ces descriptions
techniques seront peut-être prisées p a r les esprits curieux qui aiment
à étudier les différentes routes suivies p a r l’esprit humain, p our a rriv e r au
même but.
Les constructeurs arabes ont inventé ou apporté de l’Inde une manière de
fonder aussi solide qu’ingénieuse. Abd-el-Latif nous en a conservé la description
que voici :
« Les architectes arabes, dit-il, ont une manière très-ingénieuse de constru
ire les môles ou jetées que l’on nomme en Égypte Zarbiyeh. On fait fouiller
la place des fondations jusqu’à ce qu ’on aperçoive l’humidité et que l’eau
commence à paraître. Alors, après avoir bien nivelé le sol, on place su r cette
te rre humide un ro u e t de bois de sycomore ou d ’au tre bois dur, semblable à celui
qu ’on pose.sous la fondation d’un puits; la la rg eu r de ce ro u e t est d’environ
deux tiers de coudée e t le diamètre du cercle qu ’il forme dans son milieu, de
2 coudées. Ensuite on élève su r ce ro u e t une maçonnerie de briques et de
chaux, comme les premières assises d’un puits, à la hau teu r de 3 ou h coudées
environ. Les plongeurs descendent alors dans le puits, continuent à fouiller
tout autour sous le rouet, et à mesure que l’eau so rt ils la re tiren t avec le sable.
Dès que, par le moyen de cette fouille, le ro u e t porte su r le vide qui a été fait,
le poids de la maçonnerie qu’il supporte le fait enfoncer, e t, à mesure q u ’il
enfonce, les plongeurs continuent le u r travail sous le roue t, tandis que les
maçons, de le u r côté, continuent à élever la bâtisse.
« Ainsi, les uns ne cessant point d ’élever le puits et les a u tre s de creuser,
la maçonnerie s’enfonce toujours de plus en plus p a r son pro p re poids, ju sq u ’à
ce qu ’elle trouve un te rra in solide et qu’elle soit p arvenue à u n degré d ’enfoncement
convenable. Quand ce premier puits est-fini, on en commence un au tre
pareil su r la même ligne, à à coudées environ de distance du p remier. On
continue de la sorte dans toute la longueur des fondations tracées et, quand ce
travail est achevé, on élève les murs comme d ’ordinaire, après avoir comblé les
puits-colonnes, qui deviennent comme des pilotis très-solides supportant tout
l’édifice. »
Ce procédé, qui équivaut aux fondations su r pries reliées p a r des arcs, nous
a paru mé rite r de fixer p a r sa singularité, sa simplicité e t son extrême économie,
l ’attention des architectes e t des ingénieurs civils.
Ajoutons un de rnie r mot au sujet des fondations. Tous lejs, peuples p ra tiquent
certaines cérémonies en je tan t les fondations de le u rs .temples. Au lieu
d’y déposer des médailles^ les Égyptiens.de nQS/ j^urs^.lorsqu’ils je lte n t les fondations
d ’une mosquée, d ’un tombeau ou 4 ’qn, édifice jmppjrta,n.t.,Jmitant .en.cela