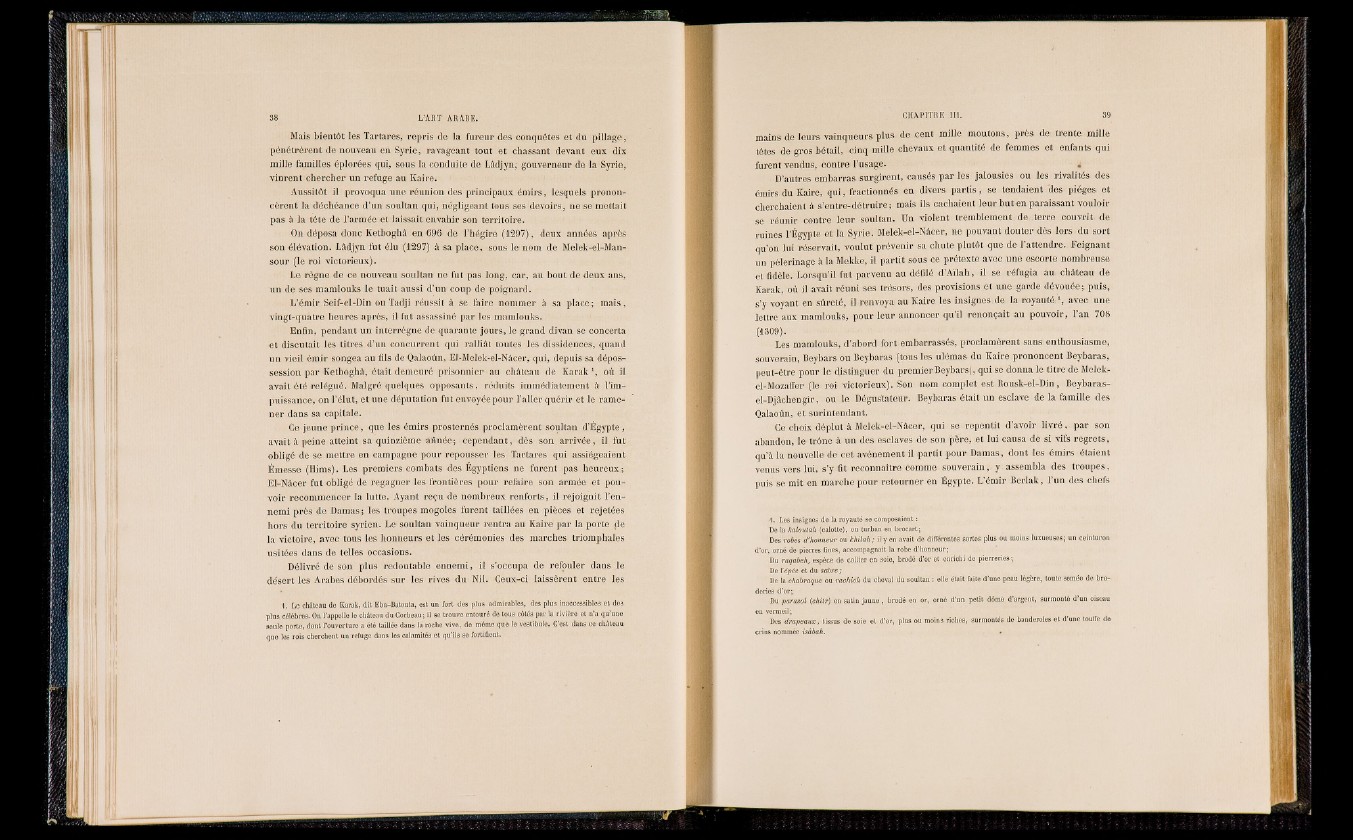
Mais bientôt les Tartares, rep ris de la fu reu r des conquêtes e t du pillage,
p é n é trè ren t de nouveau en Syrie, ravageant to u t e t chassant devant eux dix
mille familles éplorées qui, sous la conduite de Lâdjyn; gouverneur de la Syrie,
v in ren t ch erch e r u n refuge au Kaire.
Aussitôt il provoqua une réunion des principaux ém irs , lesquels prononc
èren t la déchéance d ’un soultan qui, négligeant tous ses .devoirs, ne se mettait
pas à la tê te de l ’armée e t laissait envahir son te rritoire .
On déposa donc Ketboghâ en 696 de l’hégire (1.297), deux années après
son élévation. Lâdjyn fut élu (1297) à sa pla c e, sous le nom de Melek-el-Man-
sour (le ro i victorieux).
Le règne de ce nouveau soultan ne fut pas long, car, au bout de deux ans,
u n de ses mamlouks le tuait aussi d’un coup de poignard.
L’émir Seif-el-Din ou Tadji réussit à se faire nommer à sa place; m a is,
vingt-quatre heures après, il fut assassiné p a r les mamlouks.
Enfin, p endant un interrègne de quarante jo u rs, le grand divan se concerta
e t discutait les titre s d ’un concurrent qui ralliât toutes les dissidences, quand
u n vieil émir songea au fils de Qalaoûn, EJ-Melek-el-Nâcer, qui, depuis sa dépossession
p a r Ketboghâ, était demeuré prisonnier au château de Karak % où il
avait été relégué. Malgré quelques opposants, réduits immédiatement à l ’impuissance,
on l’élut, e t une députation fut envoyée pour l’aller qu é rir et le ramen
e r dans sa capitale.
Ce jeune p rin c e , que les émirs prosternés proclamèrent soultan d’Egypte,
avait à peine a tte in t sa quinzième âfinée; c ependant, dès son a rriv é e , il fut
obligé de se mettre en campagne p our repousser les Tartares qui assiégeaient
Émesse (Hims), Les p remiers combats des Égyptiens ne furent pas heu reu x ;
El-Nâcer fut obligé de regagner le s frontières pour refaire son armée et pouvoir
recommencer la lutte. Ayant re çu de nombreux re n fo rts , il re joignit l’ennemi
près de Damas ; les troupes mogoles furent taillées en pièces et rejetées
hors du te rrito ire syrien. Le soultan vainqueur re n tra au Kaire p a r la porte (le
la victoire, avec tous les honneurs e t les cérémonies des marches triomphales
usitées dans de telles occasions.
Délivré de son plus redoutable ennem i, il s’occupa de refouler dans le
d é se rt les Arabes débordés su r les rives du Nil. Ceux-ci laissèrent en tre les
\ . Le château de Karak, dit Ebn-Batouta, est un fort des plus admirables, des plus inaccessibles e t des
plus célèbres. On l’appelle le château du Corbeau; il se trouve entouré de tous côtés par la rivière e t n’a qu’une
seule porte, dont l’ouverture a été taillée dans la roche vive, de môme que le vestibule. C’est dans ce château
que les rois cherchent un refuge dans les calamités e t qu’ils se fortifient.
m a i n s de leurs vainqueurs plus de c en t mille moutons, près de tren te mille
têtes de gros bétail, cinq mille chevaux e t quantité de femmes e t enfants qui
furent vendus, .contre l’usage. .
D’autres embarras surgirent, causés p a r les jalousies ou les rivalités des
émirs du Kaire, q u i, fraotionnés en divers p a r tis , se tendaient 'des pièges et
cherchaient à s’e n tre -d é tru ire ; mais ils cachaient leu r b u t en paraissant vouloir
sé; ré u n ir contre leu r soultan. Un violent tremblement de te rre couvrit de
ruines l’Égyple e t la Syrie. Melek-el-Nâcer, ne pouvant douter dès lo rs du sort
qu’on lui réservait, voulut prévenir sa chute plutôt que de l ’attendre. Feignant
un pèlerinage à la Mekke, il p a rtit sous ce prétexte avec une escorte nombreuse
et fidèle. Lorsqu’il fut parvenu au défilé d’Aïlah, il se réfugia au château de
Karak, où il avait réu n i ses trésors, des provisions e t une garde dévouée; puis,
s’y voyant en sûreté, il renvoya- au Kaire les insignes de- la ro y a u té 1, avec une
lettre aux mamlouks, pour leu r annoncer qu ’il renonçait au pouvoir, l’an 708
(1809).
Les mamlouks, d’abord fort embarrassés, proclamèrent sans enthousiasme,
souverain, Beybars ou Beybaras (tous les ulémas du Kaire prononcent Beybaras,
peut-être pour le distinguer du premier Beybars), qui se donna le titre de Melek-
el-Mozaffer (le roi victorieux). Son nom complet.est Kousk-el-Din, Beybaras-
el-Djâchengir,-,;ou le Dégustateur. Beybaras était un esclave de la famille des
Qalaoûn, et surintendant.
Ce choix déplut à Melek-el-Nâcer, qui se rep en tit d ’avoir liv r é , p a r son
abandon, le trône à u n des esclaves d e son père, et lui causa de si vifs re g re ts ,
qu’à la nouvelle de cet avènement, il p a rtit p o u r Damas, dont les émirs étaient
venus vers lui, s’y fit reconnaître comme souverain;, y assembla des tro u p e s,
puis se mit en marche p our re to u rn e r en Égypte. L’émir Berlak, l ’un des chefs
4. Les insignes de la royauté se composaient :
De la kaloutah (calotte), ou turban en brocart;
Des rbbès d'honneur ou k h ila h f il-y en avait de différentes sortes plus ou moins luxueuses; un ceinturon
d’or, orné de pierres fines, accompagnait la robe d’honneur;
Du raqabeh, espèce de collier en soie, brodé d’or et enrichi de pierreries;
De Ÿépëe ë l du sabre;
De la cliabraque ou rachieh du cheval du soultan : elle était faite d’une peau légère, toute semée de broderies
d’o r;’
Du parasol (chitr) en satin ja u n e , brodé en or, orné d’un petit dôme d’argent, surmonté d un oiseau
en vermeil ;
Des drapeaux y tissus de soie et d’or, plus ou moins riches, surmontés de banderoles et d une touffe de
crins nommée isâbah. • •