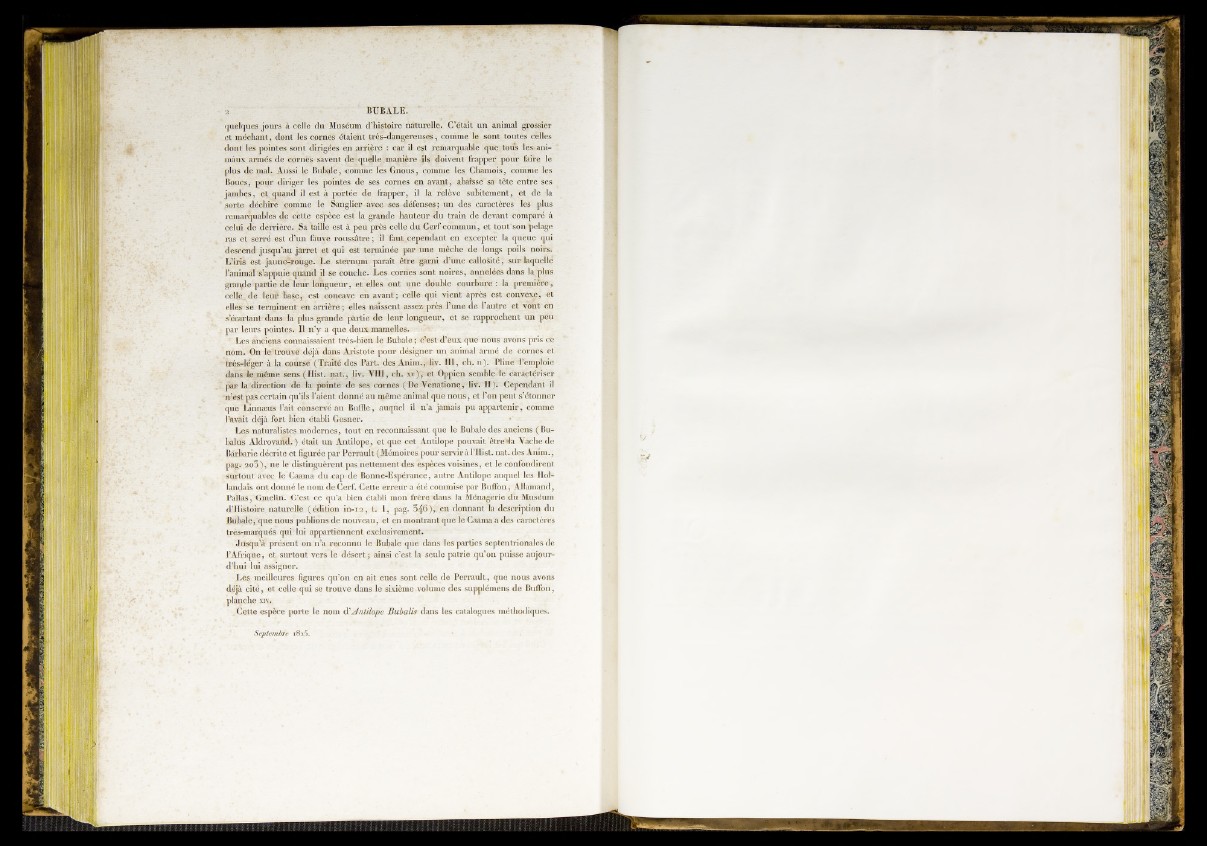
quelques jours à celle du Muséum d’histoire naturelle. C’était un animal grossier
et méchant, dont les cornes étaient très-dangereuses, comme le sont toutes celles
dont les pointes sont dirigées en arrière : car il est remarquable que tous les » animaux
armés de cornés savent de quelle manière ils doivent frapper pour faire le
plus de mal. Aussi le Bubale, comme les Gnous, comme les Chamois, comme les
Boucs, pour diriger les pointes de ses cornes en avant, abaisse sa tête entre ses
jambes, et quand il est à portée de frapper, il la relève subitement, et de la
sorte déchire comme le Sanglier avec ses défenses; un des caractères les plus
remarquables de cette espèce est la grande hauteur du train de devant comparé à
celui de derrière. Sa taille est à peu près celle du Cerf commun, et tout son pelage
ras et serré est d’un fauve roussâtre ; il faut cependant en excepter la queue qui
descend jusqu’au jarret et qui est terminée par une mèche de longs poils noirs.
L’iris est jaune-rouge. Le sternum paraît être garni d’une callosité, sur laquelle
l’animal s’appuie quand il se couche. Les cornes sont noires, annelées dans la plus
grande partie de leur longueur, et elles ont une double courbure : la première,
celle.de leur base, est concave en avant; celle qui vient après est convexe, et
elles se terminent en arrière; elles naissent assez près l’une de l’autre et vont en
s’écartant dans la plus grande partie de leur longueur, et se rapprochent un peu
par leurs pointes. 11 n’y a que deux mamelles.
J Les anciens connaissaient très^-bien le Bubale ; c’est d’ëux que nous avons pris ce
nom. On le trouve déjà dans Aristote pour désigner un animal armé de cornes et
très-léger à la course (Traité des Part, des Anim., liv. III, ch. n). Pline l’emploie
dans le même sens (Hist. nat., liv. VIII, ch. xv), et Oppien semble le caractériser
par la direction dé la pointe de ses cornes (De Venatione, liv. II)ï Cependant il
n’est pas certain qu’ils l’aient donné au même animal que nous , et l’on peut s’étonner
que Linnæus l’ait conservé au Buffle, auquel il n’a jamais pu appartenir, comme
l’avait déjà fort bien établi Gesner.
Les naturalistes modernes, tout en reconnaissant que le Bubale des anciens (Bu-
balus Aldrovaiid. ) était un Antilope, et que cet Antilope pouvait êtreda Vache de
Barbarie décrite et figurée par Perrault (Mémoires pour servira l’Hist. nat. des Anim.,
pagi- 2o 3 ) , ne le distinguèrent pas nettement des espèces voisines, et le confondirent
surtout avec le Caama du cap de Bonne-Espérance, autre Antilope auquel les Hollandais
ont donné le nom de Cerf. Cette erreur a été commise par Buffon, Allamand,
Pallas, Gmelin. C’est ce qu’a bien établi mon frère dans la Ménagerie du Muséum
d’IIistoire naturelle (édition in-12, t. I , pag. 346),. en donnant la description du
Bubale, que nous publions de nouveau, et en montrant que le Caama a des caractères
très-marqués qui lui appartiennent exclusivement.
Jusqu’à présent on n’a reconnu le Bubale que dans les parties septentrionales de
l’Afrique, et. surtout vers le désert ; ainsi c’est la seule patrie qu’on puisse aujourd’hui
lui assigner.
Les meilleures figures qu’on en ait eues sont celle de Perrault, que nous avons
déjà cité, et celle qui se trouve dans.le sixième volume des supplémens de Buffon,
planche x iy .
Cette espèce porte le nom $ Antilope Bubalis dans les catalogues méthodiques.
Septembre