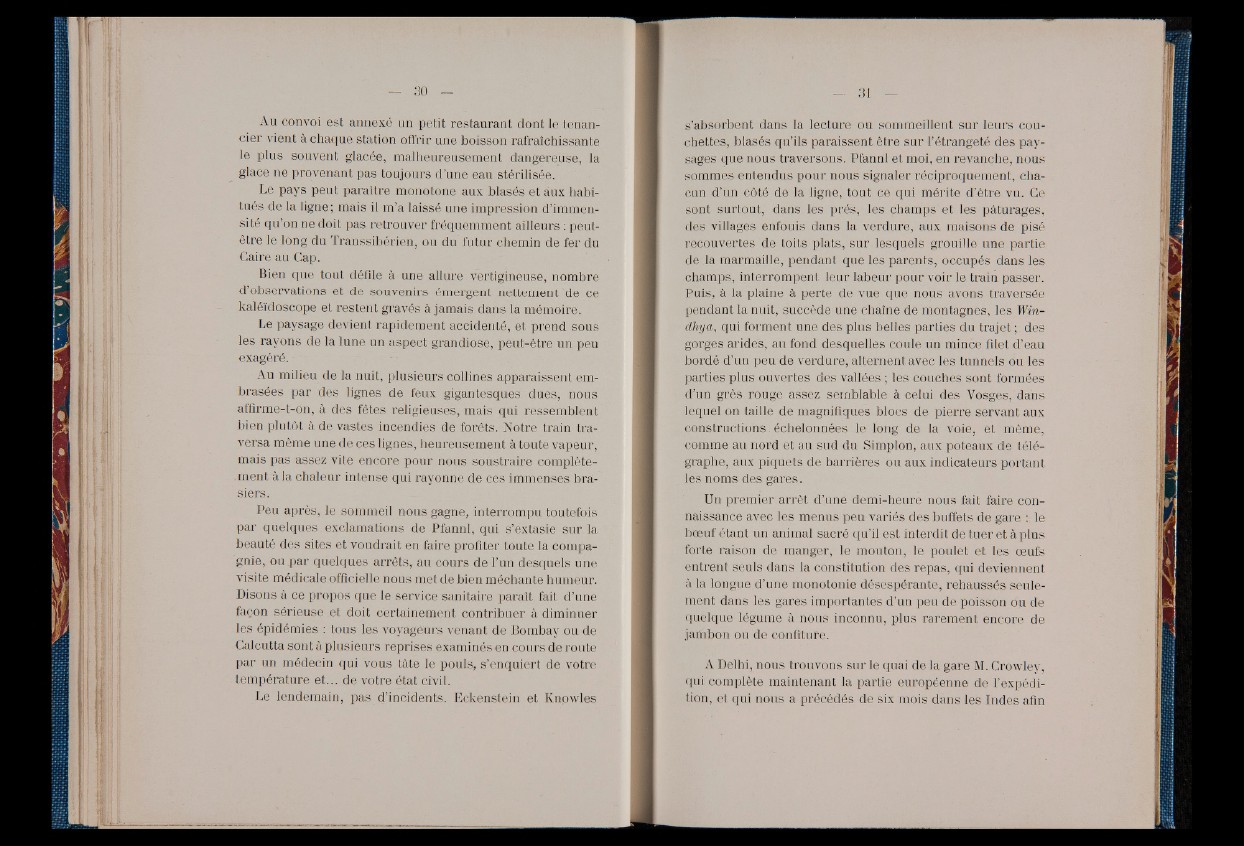
Au convoi est annexé un petit restaurant dont le tenancier
vient à chaque station offrir une boisson rafraîchissante
le plus souvent glacée, malheureusement dangereuse, la
glace ne provenant pas toujours d’une eau stérilisée.
Le pays peut paraître monotone aux blasés et aux habitués
de la ligne; mais il m’a laissé une impression d’immensité
qu’on ne doit pas retrouver fréquemment ailleurs : peut-
être le long du Transsibérien, ou du futur chemin de fer du
Caire au Cap.
Bien que tout défile à une allure vertigineuse, nombre
d’observations et de souvenirs émergent nettement de ce
kaléidoscope et restent gravés à jamais dans la mémoire.
Le paysage devient rapidement accidenté, et prend sous
les rayons de la lune un aspect grandiose, peut-être un peu
exagéré.
Au milieu de la nuit, plusieurs collines apparaissent embrasées
par des lignes de feux gigantesques dues, nous
affirme-t-on, à des fêtes religieuses, mais qui ressemblent
bien plutôt à de vastes incendies de forêts. Notre train traversa
même une de ces lignes, heureusement à toute vapeur,
mais pas assez vite encore pour nous soustraire complètement
à la chaleur intense qui rayonne de ces immenses brasiers.
Peu après, le sommeil nous gagne, interrompu toutefois
par quelques exclamations de Pfannl, qui s’extasie sur la
beauté des sites et voudrait en faire profiter toute la compagnie,
ou par quelques arrêts^ au cours de l’un desquels une
visite médicale officielle nous met de bien méchante humeur.
Disons à ce propos que le service sanitaire paraît fait d’une
façon sérieuse et doit certainement contribuer à diminuer
les épidémies : tous les voyageurs venant de Bombay ou de
Calcutta sont à plusieurs reprises examinés en cours de route
par un médecin qui vous tâte le pouls, s’enquiert dé votre
température et... de votre état civil.
Le lendemain, pas d’incidents. Eckenstein et Knowles
s’absorbent dans la lecture ou sommeillent sur leurs couchettes,
blasés qu’ils paraissent être sur l’étrangeté des paysages
que nous traversons. Pfannl et moi, en revanche, nous
sommes entendus pour nous signaler réciproquement, chacun
d’un côté de la ligne, tout ce qui mérite d’être vu. Ce
sont surtout, dans les prés, les champs et les pâturages,
des villages enfouis dans la verdure, aux maisons de pisé
recouvertes de toits plats, sur lesquels grouille une partie
de la marmaille, pendant que les parents, occupés dans les
champs, interrompent leur labeur pour voir le train passer.
Puis, à la plaine à perte de vue que nous avons traversée
pendant la nuit, succède une chaîne de montagnes, les Win-
dhya, qui forment une des plus belles parties du trajet des
gorges arides, au fond desquelles coule un mince filet d’eau
bordé d’un peu de verdure, alternent avec les tunnels ou les
parties plus ouvertes des vallées ; les couches sont formées
d’un grès rouge assez semblable à celui des Vosges, dans
lequel on taille de magnifiques blocs de pierre servant aux
constructions. échelonnées le long de la voie, et même,
comme au nord et au sud du Simplón, aux poteaux de télégraphe,
aux piquets de barrières ou aux indicateurs portant
les noms des gares.
Un premier arrêt d’une demi-heure nous fait faire connaissance
avec les menus peu variés des buffets de gare ; le
boeuf étant un animal sacré qu’il est interdit de tuer et à plus
forte raison de manger, le mouton, le poulet et les oeufs
entrent seuls dans la constitution des repas, qui deviennent
à la longue d’une monotonie désespérante, rehaussés seulement
dans les garés importantes d’un peu de poisson ou de
quelque légume à nous inconnu, plus rarement encore de
jambon ou de confiture.
A Delhi, nous trouvons sur le quai de la gare M. Crowley,
qui complète maintenant la partie européenne de l’expédition,
et qui nous a précédés de six mois dans les Indes afin