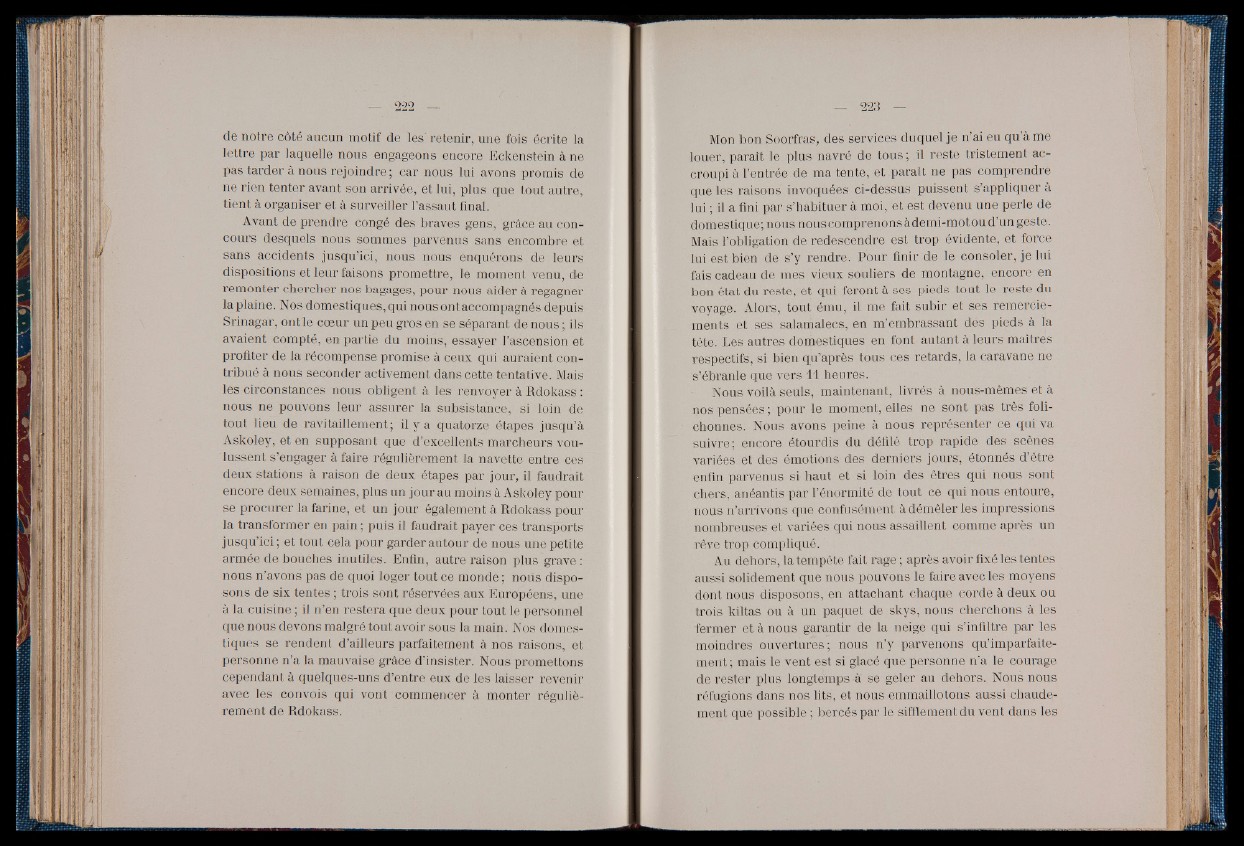
de notre côté aucun motif de les' retenir, une fois écrite la
lettre par laquelle nous engageons encore Eckenstein à ne
pas tarder à nous rejoindre ; car nous lui avons promis de
ne rien tenter avant son arrivée, et lui, plus que tout autre,
tient à organiser et à surveiller l’assaut final.
Avant de prendre congé des braves gens, grâce au concours
desquels nous sommes parvenus sans encombre et
sans accidents jusqu’ici, nous nous enquérons de leurs
dispositions et leur faisons promettre, le moment venu, de
remonter chercher nos bagages, pour nous aider à regagner
la plaine. Nos domestiques, qui nous ont accompagnés depuis
Srinagar, ont le coeur un peu gros en se séparant de nous ; ils
avaient compté, en partie du moins, essayer l’ascension et
profiter de la récompense promise à ceux qui auraient contribué
à nous seconder activement dans cette tentative. Mais
les circonstances nous obligent à les renvoyer à Rdokass :
nous ne pouvons leur assurer la subsistance, si loin de
tout lieu de ravitaillement; il y a quatorze étapes jusqu’à
Askoley, et en supposant que d’excellents marcheurs voulussent
s’engager à faire régulièrement la navette entre ces
deux stations à raison de deux étapes par jour, il faudrait
encore deux semaines, plus un jour au moins à Askoley pour
se procurer la farine, et un jour également à Rdokass pour
la transformer en pain ; puis il faudrait payer ces transports
jusqu’ici; et tout cela pour garder autour de nous une petite
armée de bouches inutiles. Enfin, autre raison plus grave :
nous n’avons pas de quoi loger tout ce monde ; nous disposons
de six tentes ; trois sont réservées aux Européens, une
à la cuisine ; il n’en restera que deux pour tout le personnel
que nous devons malgré tout avoir sous la main. Nos domestiques
se rendent d’ailleurs parfaitement à nos raisons, et
personne n’a la mauvaise grâce d'insister. Nous promettons
cependant à quelques-uns d’entre eux de les laisser revenir
avec les convois qui vont commencer à monter régulièrement
de Rdokass.
Mon bon Soorfras, des services duquel je n’ai eu qu’à me
louer, paraît le plus navré de tous; il reste tristement accroupi
à l’entrée de ma tente, et paraît ne pas comprendre
que les raisons invoquées ci-dessus puissent s’appliquer à
lui ; il a fini par s’habituer à moi, et est devenu une perle de
domestique; nous nous comprenons à demi-mot ou d’un geste.
Mais l’obligation de redescendre est trop évidente, et force
lui est bien de s’y rendre. Pour finir de le consoler, je lui
fais cadeau de mes vieux souliers de montagne, encore en
bon état du reste, et qui feront à ses pieds tout le reste du
voyage. Alors, tout ému, il me fait subir et ses remerciements
et ses salamalecs, en m’embrassant des pieds à la
tête. Les autres domestiques en font autant à leurs maîtres
respectifs, si bien qu’après tous ces retards, la caravane ne
s’ébranle que vers 11 heures.
Nous voilà seuls, maintenant, livrés à nous-mêmes et à
nos pensées; pour le moment, elles ne sont pas très folichonnes.
Nous avons peine à nous représenter ce qui va
suivre; encore étourdis du défilé trop rapide des scènes
variées et des émotions des derniers jours, étonnés d’être
enfin parvenus si haut et si loin des êtres qui nous sont
chers, anéantis par l’énormité de tout ce qui nous entoure,
nous n’arrivons que confusément à démêler les impressions
nombreuses et variées qui nous assaillent comme après un
rêve trop compliqué.
Au dehors, la tempête fait rage ; après avoir fixé les tentes
aussi solidement que nous pouvons le faire avec les moyens
dont nous disposons, en attachant chaque corde à deux ou
trois kiltas ou à un paquet de skys, nous cherchons à les
fermer et à nous garantir de la neige qui s’infiltre par les
moindres ouvertures; nous n’y parvenons qu’imparfaitement
; mais le vent est si glacé que personne n’a le courage
de rester plus longtemps à se geler au dehors. Nous nous
réfugions dans nos lits, et nous emmaillotons aussi chaudement
que possible ; bercés par le sifflement du vent dans les