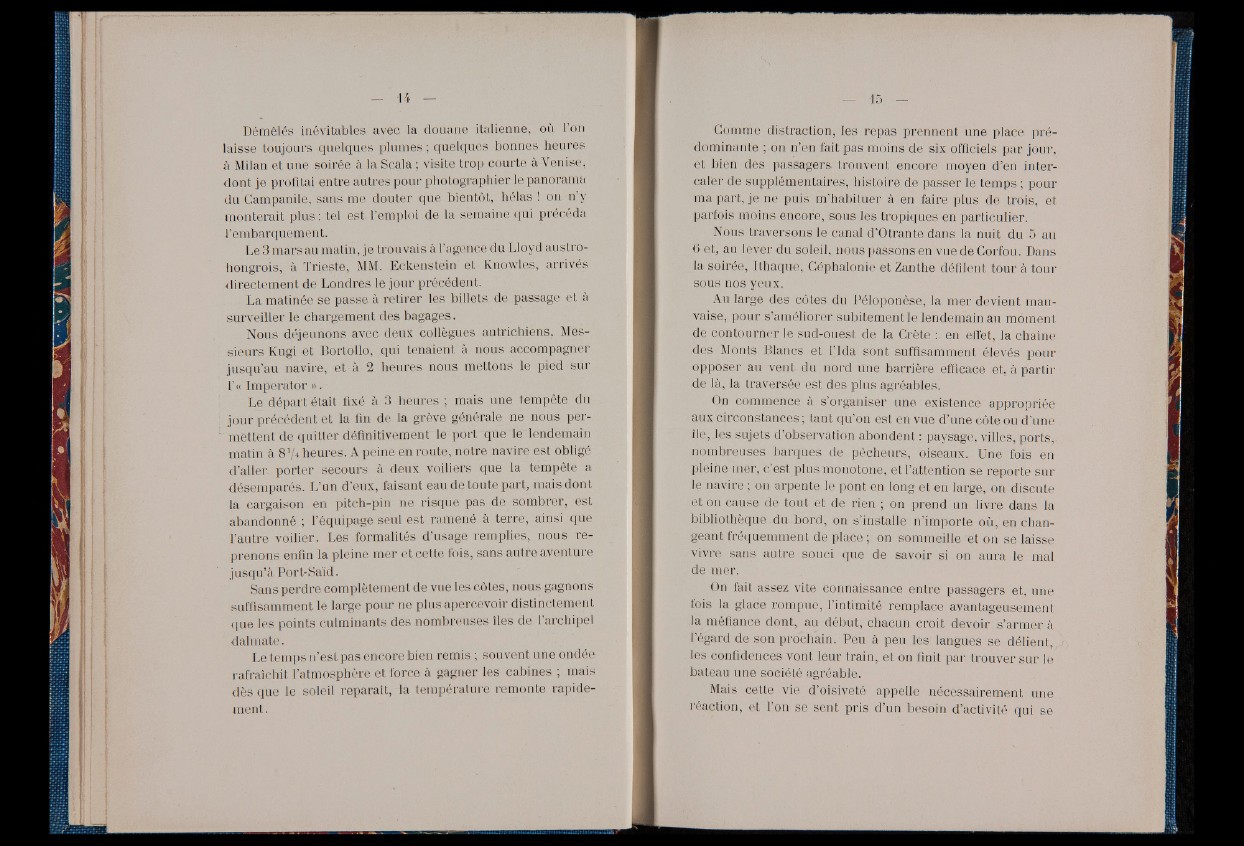
Démêlés inévitables avec la douane italienne, où l’on
laisse toujours quelques plumes ; quelques bonnes heures
à Milan et une soirée à la Scala ; visite trop courte à Venise,
dont je profitai entre autres pour photographier le panorama
du Campanile, sans me douter que bientôt, hélas ! on n’y
monterait plus : tel est l’emploi de la semaine qui précéda
rembarquement.
Le 3 mars au matin, je trouvais à l’agence du Lloyd austro-
hongrois, à Trieste, MM. Eckenstein et Knowles, arrivés
directement de Londres le jour précédent.
La matinée se passe à retirer les billets de passage et à
surveiller le chargement des bagages.
Nous déjeunons avec deux collègues autrichiens, Messieurs
Kugi et Bortollo, qui tenaient à nous accompagner
jusqu’au navire, et à 2 heures nous mettons le pied sur
F « Imperator » „
Le départ était fixé à 3 heures ; mais une tempête du
jour précédent et la fin de la grève générale ne nous permettent
de quitter définitivement le port (pie le lendemain
matin à 8 7* heures. A peine en route, notre navire est obligé
d ’aller porter secours à deux voiliers que la tempête a
désemparés. L’un d’eux, faisant eau de toute part, mais dont
la cargaison en pitch-pin ne risque pas de^ sombrer, est
abandonné ; l’équipage seul est ramené à terre, ainsi que
l’autre voilier. Les formalités d’usage remplies, nous reprenons
enfin la pleine mer et cette fois, sans autre aventure
jusqu’à Port-Saïd.
Sans perdre complètement de vue les côtes, nous gagnons
suffisamment le large pour ne plus apercevoir distinctement
que les points culminants des nombreuses îles de l’archipel
•dalmate.
Le temps n’est pas encore bien remis ; souvent une ondée
rafraîchit l’atmosphère et force à gagner les cabines ; mais
dès que le soleil reparaît, la température remonte rapidement
.
Gomme distraction, les repas prennent une place prédominante
; on n’en fait pas moins de six officiels par jour,
et bien des passagers, trouvent encore moyen d’en intercaler
de supplémentaires, histoire de passer le temps ; pour
ma part, je ne puis m’habituer à en faire plus de trois, et
parfois moins encore, sous les tropiques en particulier.
Nous traversons le canal d’Otrante dans la nuit du 5 au
6 et, au lever du soleil, nous passons en vue de Corfou. Dans
. la soirée, Ithaque, Géphalonie et Zanthe défilent tour à tour
sous nos yeux.
Au large des côtes du Péloponèse, la mer devient mauvaise,
pour s’améliorer subitement le lendemain au moment
de contourner le sud-ouest de la Crète en effet, la chaîne
des Monts Blancs et l’Ida sont suffisamment élevés pour
opposer au vent du nord une barrière efficace et, à partir
de là, la traversée est des plus agréables.
On commence à s’organiser une existence appropriée
aux circonstances ; tant qu’on est en vue d’une côte ou d’une
île, les sujets d’observation abondent : paysage, villes, ports,
nombreuses barques de pêcheurs, oiseaux. Une fois en
pleine mer, c’est plus monotone, et l’attention se reporte sur
le navire ; on arpente le pont en long et en large, on discute
et on cause de tout et de rien ; on prend un livre dans la
bibliothèque du bord, on s’installe n’importe où, en changeant
fréquemment de place ; on sommeille et on se laisse
vivre sans autre souci que de savoir si on aura le mal
de mer.
On fait assez vite connaissance entre passagers et, une
fois la glace rompue, l’intimité remplace avantageusement
la méfiance dont, au début, chacun croit devoir s’armer à
l’égard de son prochain. Peu à peu les langues se délient,,
les confidences vont leur train, et on finit par trouver sur le
bateau une société agréable.
Mais cette vie d’oisiveté appelle nécessairement une
réaction, et l’on se sent pris d’un besoin d’activité qui se