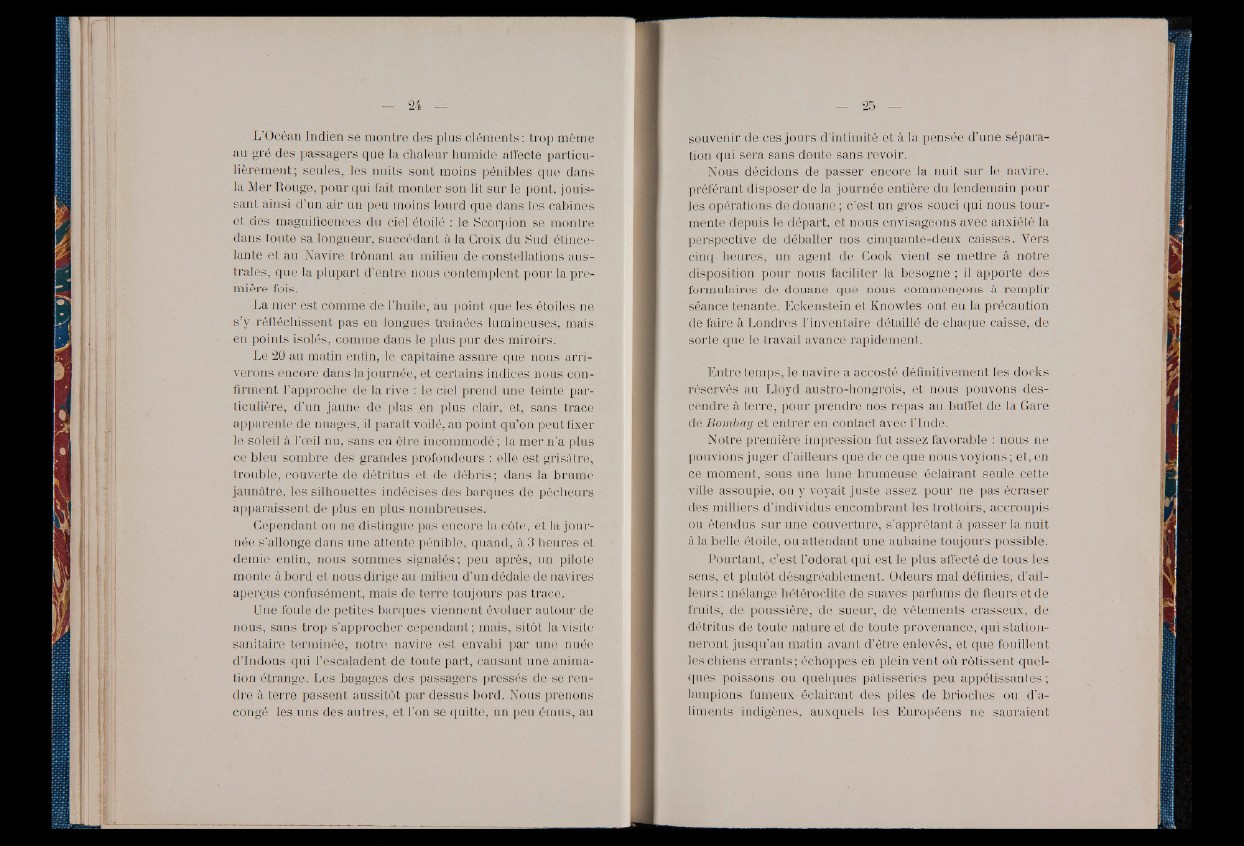
L’Océan Indien se montre des plus cléments: trop même
au gré des passagers que la chaleur humide affecte particulièrement;
seules, les nuits sont moins pénibles que dans
la Mer Rouge, pour qui fait monter son lit sur le pont, jouissant
ainsi d’un air un peu moins lourd que dans les cabines
et des magnificences du ciel étoilé : le Scorpion se. montre
dans toute sa longueur, succédant à la Croix du Sud étincelante
et au Navire trônant au milieu de constellations australes,
que la plupart d’entre nous contemplent pour la première
fois.
La mer est comme de l’huile, au point que les étoiles ne
s’v réfléchissent pas en longues traînées lumineuses, mais
en points isolés, comme dans le plus pur des miroirs.
Le 20 au matin enfin, le capitaine assure que nous arriverons
encore dans la journée, et certains indices nous confirment
l’approche de la rive : le ciel prend une teinte particulière,
d’un jaune de plus en plus clair, et, sans trace
apparente de nuages, il paraît voilé, au point qu’on peut fixer
le soleil à l’oeil nu, sans en être incommodé ; la mer n’a plus
ce bleu sombre des grandes profondeurs : elle est grisâtre,
trouble, couverte de détritus et de débris; dans la brume
jaunâtre, les silhouettes indécises des barques de pêcheurs
apparaissent de plus en plus nombreuses,: ■
Cependant on ne distingue pas encore la côte, et la journée
s’allonge dans une attente pénible, quand, à 3 heures et
demie enfin, nous sommes signalés; peu après, un pilote
monte à bord et nous dirige au milieu d’un dédale de navires
aperçus confusément, mais de terre toujours pas trace.
Une foule de petites barques viennent évoluer autour de
nous, sans trop s’approcher cependant; mais, sitôt la visite
sanitaire terminée, notre navire est envahi par une nuée
d’Indous qui l’escaladent de toute part, causant une animation
étrange. Les bagages des passagers pressés de se rendre
à terre passent aussitôt par dessus bord. Nous prenons
congé les uns des autres, et l’on se quitte, un peu émus, au
souvenir de ces jours d’intimité et à la pensée d’une séparation
qui sera sans doute sans revoir.
Nous décidons de passer encore la nuit sur le navire,
préférant disposer de la journée entière du lendemain pour
les opérations de douane ; c’est un gros souci qui nous tourmente
depuis le départ, et nous envisageons avec anxiété la
perspective de déballer nos cinquante-deux caisses. Vers
cinq heures, un agent de Cook vient se mettre à notre
disposition pour nous faciliter la besogne.; il apporte des
formulaires de douane que nous commençons à remplir
séance tenante. Eckenstein et Knowles ont eu la précaution
de faire à Londres l’inventaire détaillé de chaque caisse, de
sorte que le travail avance rapidement.
Entre temps, le navire a accosté définitivement les docks
réservés au Lloyd austro-hongrois, et nous pouvons descendre
à terre, pour prendre nos repas au buffet de la Gare
de Bombay et entrer en contact avec l’Inde.
Notre première impression fut assez favorable : nous ne
pouvions juger d’ailleurs que de ce que nous voyions; et, en
ce moment, sous une lune brumeuse éclairant seule cette
ville assoupie, on y voyait juste assez pour ne pas écraser
des milliers d’individus encombrant les trottoirs, accroupis
ou étendus sur une couverture, s’apprêtant à passer la nuit
à la belle étoile, ou attendant une aubaine toujours possible.
Pourtant, c’est l’odorat qui est le plus affecté de tous les
sens, et plutôt désagréablement. Odeurs mal définies, d’ailleurs
: mélange hétéroclite de suaves parfums de fleurs et de
fruits, de poussière, de sueur, de vêtements crasseux, de
détritus de toute nature et de toute provenance, qui stationneront
jusqu’au matin avant d’être enlevés, et que fouillent
les chiens errants; échoppes en plein vent où rôtissent quelques
poissons ou quelques pâtisseries peu appétissantes ;
lampions fumeux éclairant des piles de brioches ou d’aliments
indigènes/auxquels les Européens ne sauraient