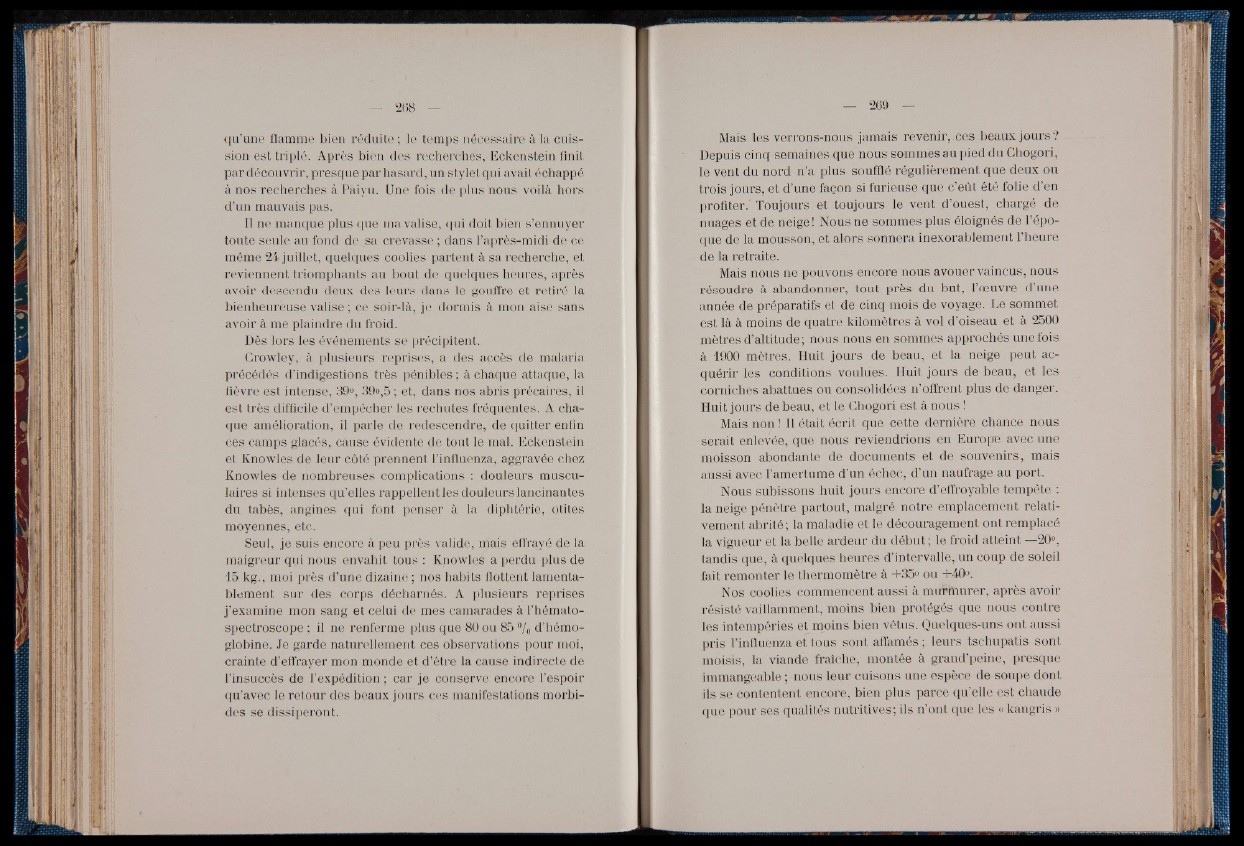
qu’une flamme bien réduite ; U temps nécessaire à la cuis-
sion est triplé. Après bien des recherches, Eckenstein finit
par découvrir, presque par hasard, un stylet qui avait échappé
à nos recherches à Paiyu. Une fois de plus nous voilà hors
d’un mauvais pas.
Il ne manque plus que ma valise, qui doit bien s’ennuyer
toute seule au fond de sa crevasse ; dans l’après-midi de ce
même 24 juillet, quelques coolies partent à sa recherche, et
reviennent triomphants au bout de quelques heures, après
avoir descendu deux des leurs dans le gouffre et retiré la
bienheureuse valise ; ce soir-là, je dormis à mon aise sans
avoir à me plaindre du froid.
Dès lors les événements se précipitent.
Crowley, à plusieurs reprises, a des accès de malaria
précédés d’indigestions très pénibles; à chaque attaque, la
fièvre est intense, 39°, 39»,5 ; et, dans nos abris précaires, il
est très difficile d’empêcher les rechutes fréquentes. A chaque
amélioration, il parle de redescendre, de quitter enfin
ces camps glacés, cause évidente de tout le mal. Eckenstein
et Knowles de leur côté prennent l’influenza, aggravée chez
Iinowles de nombreuses complications : douleurs musculaires
si intenses qu’elles rappellent les douleurs lancinantes
du tabès, angines qui font penser à la diphtérie, otites
moyennes, etc.
Seul, je suis encore à peu près valide, mais effrayé de la
maigreur qui nous envahit tous : Knowleé a perdu plus de
15 kg., moi près d’une dizaine ; nos habits flottent lamentablement
sur des corps décharnés. A plusieurs reprises
j’examine mon sang et celui de mes camarades à l’hémato-
spectroscope ; il ne renferme plus que 80 ou 85 % d’hémoglobine.
Je garde naturellement ces observations pour moi,
crainte d’effrayer mon monde et d’être la cause indirecte de
l’insuccès de l’expédition ; car je conserve encore l’espoir
qu’avec le retour des beaux jours ces manifestations morbides
se dissiperont.
Mais les verrons-nous jamais revenir, ces beaux jours?
Depuis cinq semaines que nous sommes au pied duChogori,
le vent du nord n’a plus soufflé régulièrement que deux ou
trois jours, et d’une façon si furieuse que c’eût été folie d’en
profiter. Toujours et toujours le vent d’ouest, chargé de
nuages et de neige! Nous ne sommes plus éloignés de l’époque
de la mousson, et alors sonnera inexorablement l’heure
de la retraite.
Mais nous ne pouvons encore nous avouer vaincus, nous
résoudre à abandonner, tout près du but, l’oeuvre d’une
année de préparatifs et de cinq mois de voyage. Le sommet
est là à moins de quatre kilomètres à vol d’oiseau et à 2500
mètres d’altitude; nous nous en sommes approchés une fois
à 1900 mètres. Huit jours de beau, et la neige peut acquérir
les conditions voulues. Huit jours de beau, et les
corniches abattues ou consolidées n’offrent plus de danger.
Huit jours de beau, et le Ghogori est à nous !
Mais non ! Il était écrit que cette dernière chance nous
serait enlevée, que nous reviendrions en Europe avec une
moisson abondante de documents et de souvenirs, mais
aussi avec l’amertume d’un échec, d’un naufrage au port.
Nous subissons huit jours encore d’effroyable tempête :
la neige pénètre partout, malgré notre emplacement relativement
abrité; la maladie et le découragement ont remplacé
la vigueur et la belle ardeur du début ; le froid atteint —20°,
tandis que, à quelques heures d’intervalle, un coup de soleil
fait remonter le thermomètre à +35° ou +40°.
Nos coolies commencent aussi à murmurer, après avoir
résisté vaillamment, moins bien protégés que nous contre
les intempéries et moins bien vêtus. Quelques-uns ont aussi
pris l’influenza et tous sont affamés ; leurs tsehupatis sont
moisis, la viande fraîche, montée à grand’peine, presque
immangeable ; nous leur cuisons une espèce de soupe dont
ils se contentent encore, bien plus parce qu’elle est chaude
que pour ses qualités nutritives; ils n’ont que les « kangris »