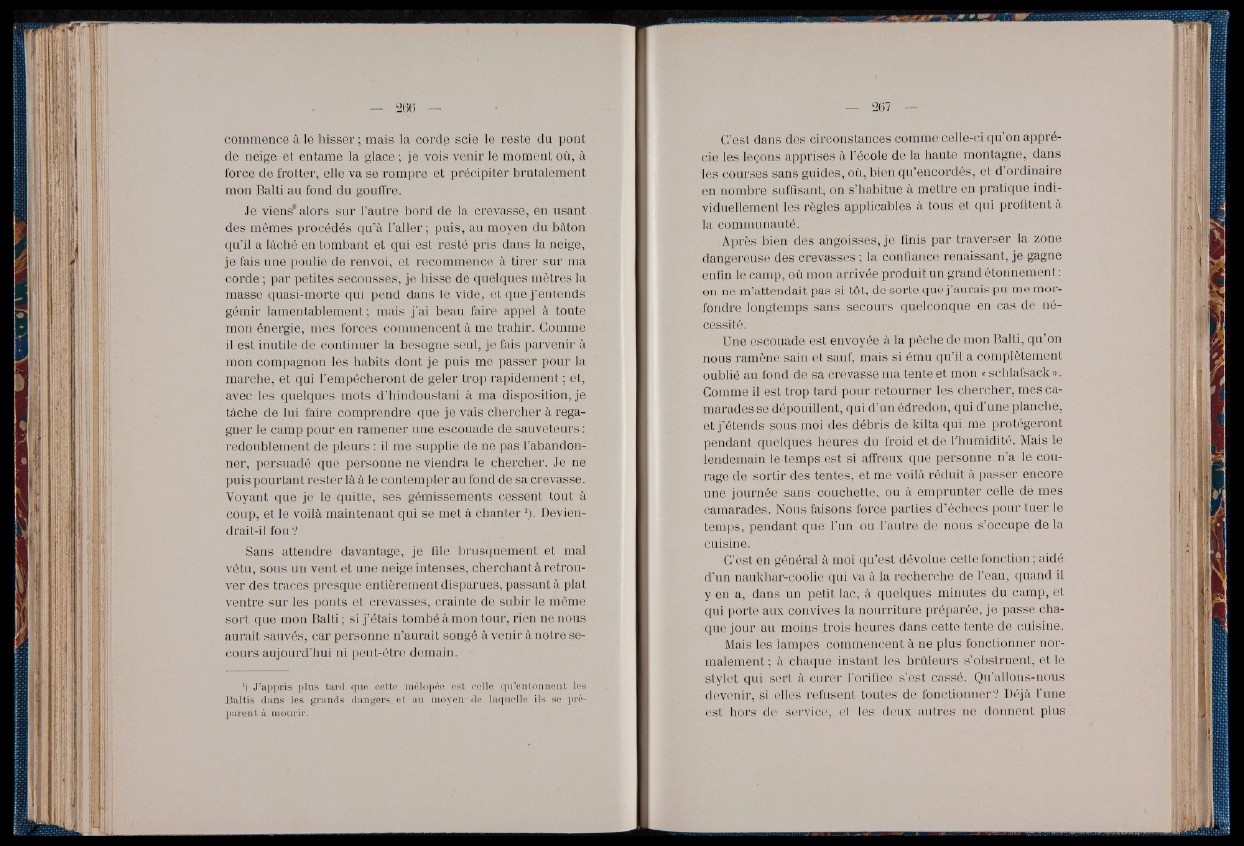
commence à le hisser ; mais la cordg scie le reste du pont
de neige et entame la glace ; je vois venir le moment où, à
force de frotter, elle va se rompre et précipiter brutalement
mon Balti au fond du gouffre.
Je viens* alors sur l’autre bord de la crevasse, en usant
des mêmes procédés qu’à l’aller ; puis, au moyen du bâton
qu’il a lâché en tombant et qui est resté pris dans la neige,
je fais une poulie de renvoi, et recommence à tirer sur ma
corde ; par petites secousses, je hisse de quelques mètres la
masse quasi-morte qui pend dans le vide, et que j’entends
gémir lamentablement ; mais j'ai beau faire appel à toute
mon énergie, mes forces commencent à me trahir. Gomme
il est inutile de continuer la besogne seul, je fais parvenir à
mon compagnon les habits dont je puis me passer pour la
marche, et qui l’empêcheront de geler trop rapidement ; et,
avec les quelques mots d’hindoustani à ma disposition, je
tâche de lui faire comprendre que je vais chercher à regagner
le camp pour en ramener une escouade de sauveteurs :
redoublement de pleurs : il me supplie de ne pas l’abandonner,
persuadé que personne ne viendra le chercher. Je ne
puis pourtant rester là à le contempler au fond de sa crevasse.
Voyant que je le quitte, ses gémissements cessent tout à
coup, et le voilà maintenant qui se met à chanter *). Deviendrait
il fou?
Sans attendre davantage, je file brusquement et mal
vêtu, sous un vent et une neige intenses, cherchant à retrouver
des traces presque entièrement disparues, passant à plat
ventre sur les ponts et crevasses, crainte de subir le même
sort que mon Balti ; si j’étais tombé à mon tour, rien ne nous
aurait sauvés, car personne n’aurait songé à venir à notre secours
aujourd’hui ni peut-être demain.
*) J’appris plus tard que cette mélopée est celle qu’entonnent les
Baltis dans le s grands dangers, et au moyen de laquelle ils se préparent
à mourir.
— 267 —
C’est dans des circonstances comme celle-ci qu’on apprécie
les leçons apprises à l’école de la haute montagne, dans
les courses sans guides, où, bien qu’encordés, et d’ordinaire
en nombre suffisant, on s’habitue à mettre en pratique individuellement
les règles applicables à tous et qui profitent à
la communauté.
Après bien des angoisses, je finis par traverser la zone
dangereuse des crevasses ; la confiance renaissant, je gagne
enfin le camp, où mon arrivée produit un grand étonnement :
on ne m’attendait pas si tôt, de sorte que j’aurais pu me morfondre
longtemps sans secours quelconque en cas de nécessité.
Une escouade est envoyée à la pêche de mon Balti, qu’on
nous ramène sain et sauf, mais si ému qu’il a complètement
oublié au fond de sa crevasse ma tente et mon «schlafsack».
Gomme il est trop tard pour retourner les chercher, mes camarades
se dépouillent, qui d’un édredon, qui d’une planche,
et j’étends pous moi des débris de kilta qui me protégeront
pendant quelques heures du froid et de l’humidité. Mais le
lendemain le temps est si affreux que personne n’a le courage
de sortir des tentes, et me voilà réduit à passer encore
une journée sans couchette, ou à emprunter celle de mes
camarades. Nous faisons force parties d’échecs pour tuer le
temps, pendant que l’un ou l’autre de nous s’occupe de la
cuisine.
C’est en général à moi qu’est dévolue cette fonction ; aidé
d’un naukhar-coolie qui va à la recherche de l’eau, quand il
y en a, dans un petit lac, à quelques minutes du camp, et
qui porte aux convives la nourriture préparée, je passe chaque
jour au moins trois heures dans cette tente de cuisine.
Mais les lampes commencent à ne plus fonctionner normalement
; à chaque instant les brûleurs s’obstruent, et le
stylet qui sert à curer l’oriflce s’est cassé. Qu’allons-nous
devenir, si elle's refusent toutes de fonctionner? Déjà l’une
est hors de service, et les deux autres ne donnent plus