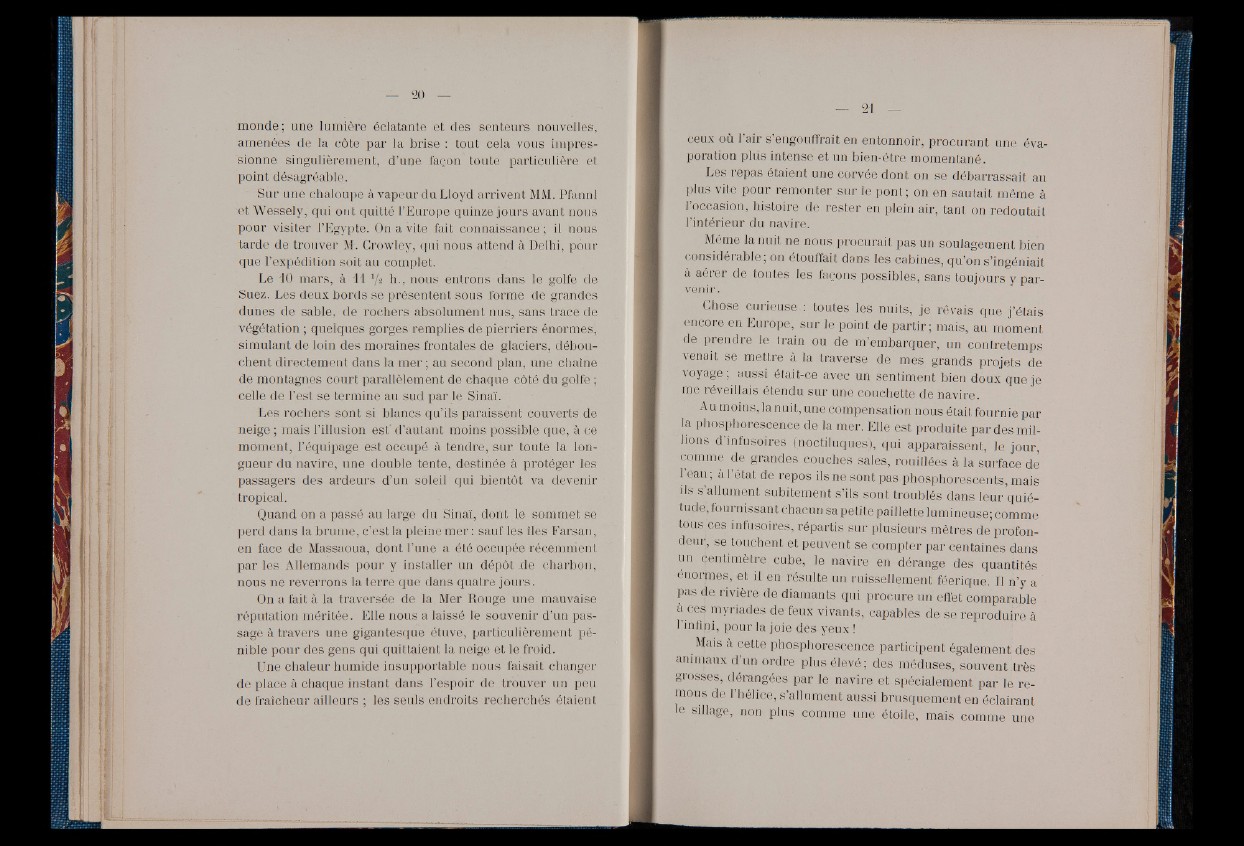
monde; une lumière éclatante et des senteurs nouvelles,
amenées de la côte par la brise : tout cela vous impressionne
singulièrement, d’une façon toute particulière et
point désagréable.
' Sur une chaloupe à vapeur duLloyd arrivent MM. Pfannl
et Wessely, qui ont quitté l’Europe quinze jours avant nous
pour visiter l’Egypte. On a vite fait connaissance ; il nous
tarde de trouver M. Crowley, qui nous attend à Delhi, pour
que l’expédition soit au complet.
Le 10 mars, à 11 7* h., nous entrons dans le golfe de
Suez. Les deux bords se présentent sous forme de grandes
dunes de sable, de rochers absolument ri us, sans trace de
végétation ; quelques gorges remplies de pierriers énormes,
simulant de loin des moraines frontales de glaciers, débouchent
directement dans la mer ; au second plan, une chaîne
de montagnes court parallèlement de chaque côté du golfe ;
celle de l’est se termine au sud par le Sinaï.
Les rochers sont si blancs qu’ils paraissent couverts de
neige ; mais l’illusion est' d’autant moins possible que, à ce
moment, l’équipage est occupé à tendre, sur toute la longueur
du navire, une double tente, destinée à protéger les
passagers des ardeurs d’un soleil qui bientôt va devenir
tropical.
Quand on a passé au large du Sinaï, dont le sommet sè
perd dans la brume, c’est la pleine mer : sauf les îles Farsan,
en face de Massaoua, dont l’une a été occupée-récemment
par les Allemands pour y installer un dépôt Me charbon,
nous ne reverrons la terre que dans quatre jours.
On a fait à la traversée de la Mer Rouge une mauvaise
réputation méritée. Elle nous a laissé le souvenir d’un passage
à travers une gigantesque étuve, particulièrement pénible
pour des gens qui quittaient la neige et le froid.
Une chaleur humide insupportable nous faisait changer
de place à chaque instant dans l’espoir de trouver un peu
de fraîcheur ailleurs ; les seuls endroits recherchés étaient
ceux où l’air s’engouffrait en entonnoir, procurant une évaporation
plus intense et un bien-être momentané.
Les repas étaient une corvée dont on sé débarrassait au
plus vite pour remonter sur le pont ; on en sautait même à
1 occasion, histoire de rester en plein air, tant on redoutait
l’intérieur du navire.
Même la nuit ne nous procurait pas un soulagement bien
considérable; on étouffait dans les cabines, qu’on s’ingéniait
à aérer de toutes les façons possibles, sans toujours y parvenir.
Chose curieuse : toutes les nuits, je rêvais que j’étais
encore en Europe, sur le point de partir; mais, au moment
de prendre le Irain ou de m’embarquer, un contretemps
venait se mettre à la traverse de mes grands projets de
voyage, aussi était-ce avec un sentiment bien doux que je
me réveillais étendu sur une couchette de navire.
Au moins, la nuit, une compensation nous était fournie par
la phosphorescence de la mer. Elle est produite par des millions
d’infusoires (noctiluques), qui apparaissent, le jour,
comme de grandes couches sales, rouillées à la surface de
l’eau ; à l’état de repos ils ne sont pas phosphorescents, mais
ils s’allument subitement s’ils sont troublés dans leur quiétude;
fournissant chacun sapetite paillette lumineuse; comme
tous.ces infusoires, répartis sur plusieurs mètres de profondeur,
se touchent et peuvent se compter par centaines dans
un centimètre cube, le navire en dérange des quantités
énormes, et il en résulte un ruissellement féerique. Il n’y a
pas de rivière de diamants qui procure un effet comparable
à ceé myriades de feux vivants, capables de se reproduire à
l’infini, pour la joie dea yeux !
Mais à cette phosphorescence participent également des
animaux d’un ordre plus élevé; des méduses, souvent très
grosses, dérangées par le navire et spécialement par le remous
de l’hélice, s’allument aussi brusquement en éclairant
le sillage, non plus comme une étoile, mais comme une