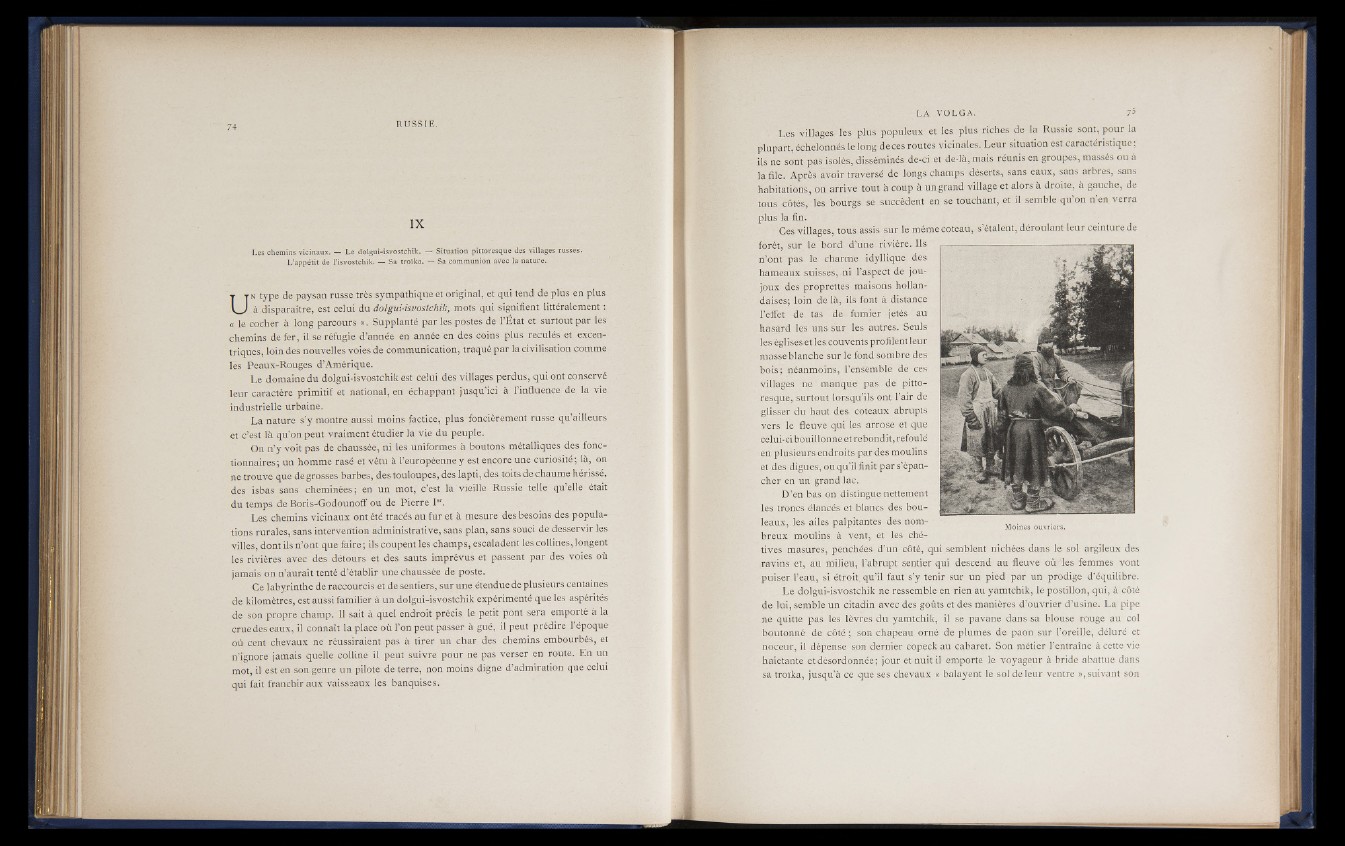
Les chemins vicinaux. — Le dolgui-isvostchik. — Situation pittoresque des villages russes.
L ’appétit de l’isvostchik. — Sa troïka. — Sa communion avec la nature. .•
Un type de paysan russe très sympathique et original, et qui tend de plus en plus
à disparaître, est celui du dolgui-isvostchik, mots qui signifient littéralement :
« le cocher à long parcours ». Supplanté parles postes de l’État et surtout par les
chemins de fer, il se réfugie d’année en année en des coins plus reculés et excentriques,
loin des nouvelles voies de communication, traqué par la civilisation comme
les Peaux-Rouges d’Amérique.
Le domaine du dolgui-isvostchik est celui des villages perdus, qui ont conservé
leur caractère primitif et national, en échappant jusqu’ici à l’influence de. la vie
industrielle urbaine.
La nature s’y montre aussi moins factice, plus foncièrement russe qu’ailleurs
et c’est là qu’on peut vraiment étudier la vie du peuple.
On n’y voit pas de chaussée, ni les uniformes à boutons métalliques des fonctionnaires;
un homme rasé et vêtu à l’européenne y est encore une curiosité; là, on
ne trouve que de grosses barbes, des touloupes, des lapti, des toits de chaume hérissé,
des isbas sans cheminées; en un mot, c’est la vieille Russie telle qu’elle était
du temps de Boris-Godounoff ou de Pierre Ier.
Les chemins vicinaux ont été tracés au fur et à mesure des besoins des populations
rurales, sans intervention administrative, sans plan, sans souci de desservir les
villes, dont ils n’ont que faire ; ils coupent les champs, escaladent les collines, longent
les rivières avec des détours et des sauts imprévus et passent par des voies où
jamais on n’aurait tenté d’établir une chaussée de poste.
Ce labyrinthe de raccourcis et de sentiers, sur une étendue de plusieurs centaines
de kilomètres, est aussi familier à un dolgui-isvostchik expérimenté que les aspérités
de son propre champ. Il sait à quel endroit précis le petit pont sera emporté à la
crue des eaux, il connaît la place où l’on peut passer à gué, il peut prédire l’époque
où cent chevaux ne réussiraient pas à tirer un char des chemins embourbés, et
n’ignore jamais quelle colline il peut suivre pour ne pas verser en route. En un
mot, il est en son genre un pilote de terre, non moins digne d’admiration que celui
qui fait franchir aux vaisseaux les banquises.
> Les villages les plus populeux et les plus' riches de la Russie sont, pour la
plupart, échelonnés le long deces routes vicinales. Leur situation est caractéristique ;
ils ne sont pas isolés, disséminés de-ci et de-là, mais réunis en groupes, massés ou à
la file. Après avoir traversé de longs champs déserts, sans eaux, sans arbres, sans
habitations, on arrive tout à coup à un grand village et alors à droite, à gauche, de
tous côtés, les bourgs se succèdent en se touchant, et il semble qu on n en verra
plus la fin.
Ces villages, tous assis sur le même coteau, s’étalent, déroulant leur ceinture de
forêt, sur le bord d’une rivière. Ils
n’ont pas le charme idyllique des
hameaux suisses, .ni l’aspect de joujoux
des proprettes maisons hollandaises;
loin de là, ils font à distance
l’effet de tas de fumier jetés au
hasard les uns sur les autres. Seuls
les églises et les. couvents profilent leur
masse blanche sur le fond sombre des
bois; néanmoins, l’ensemble de ces
villages ne manque pas de pittoresque,
surtout lorsqu’ils ont l’air de
glisser du haut des coteaux abrupts
vers le fleuve qui les arrose et que
celui-ci bouillonne et rebondit, refoulé
en plusieurs endroits par des moulins
et des digues, ou qu'il finit par s’épancher
en un grand lac.
D ’en bas on distingue nettement
les troncs élancés et blancs des bouleaux,
les ailes palpitantes 5 r r des nom- M. .o.ines ouvriers.,
breux moulins à vent, et les chétives
masures, penchées d’un côté, qui semblent nichées dans le sol argileux des
ravins et, au milieu, l’abrupt sentier qui descend au fleuve où les femmes vont
puiser l’eau, si étroit, qu’il faut s’y tenir sur un pied par un prodige d’équilibre.
Le dolgui-isvostchik ne ressemble en rien au yamtchik, le postillon, qui, à côté
de lui, semble un citadin avec des goûts et des manières d’ouvrier d’usine. L a pipe
ne quitte pas les lèvres du yamtchik, il se pavane dans sa blouse rouge au col
boutonné de côté ; son chapeau orné de plumes de paon sur l’oreille, déluré et
noceur, il dépense son dernier copeck au cabaret. Son métier l’entraîne à cette vie
haletante et désordonnée ; jour et nuit il emporte le voyageur à bride abattue dans
sa troïka, jusqu’à ce que ses chevaux « balayent le sol de leur ventre », suivant son