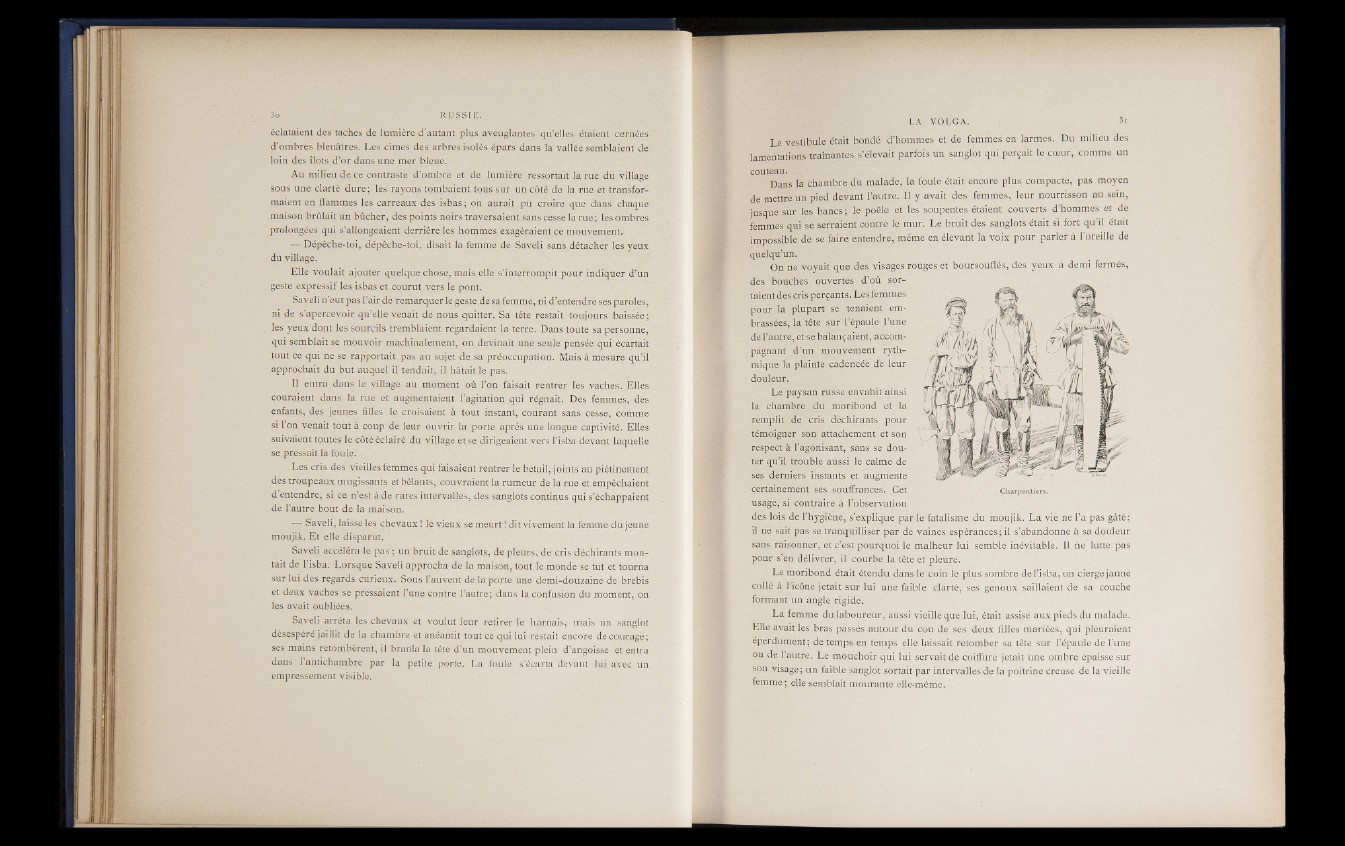
3o ; RUSSIE.
éclataient des taches de lumière d'autant plus aveuglantes qu’elles étaient cernées
d’ombres bleuâtres. Les cimes des arbres isolés épars dans la vallée semblaient de
loin des îlots d’or dans une mer bleue.
Au milieu de ce contraste d’ombre et de lumière ressortait la rue du village
sous une clarté dure; les rayons tombaient tous sur un côté de la rue et transformaient
en flammes les carreaux des isbas ; on aurait pu croire que dans chaque
maison brûlait un bûcher, des points noirs traversaient sans cesse la rue; les ombres
prolongées qui s’allongeaient derrière les hommes exagéraient ce mouvement.
— Dépêche-toi, dépêche-toi, disait la femme de Saveli sans détacher les yeux
du village.
Elle voulait ajouter quelque chose, mais elle s’interrompit pour indiquer d’un
geste expressif les isbas et courut vers le pont.
Saveli n’eut pas l’air de remarquer le geste de sa femme, ni d’entendre ses paroles,
ni de s’apercevoir qu’elle venait de nous quitter. Sa tête restait toujours baissée ;
les yeux dont les sourcils tremblaient regardaient la terre. Dans toute sa personne,
qui semblait se mouvoir machinalement, on devinait une seule pensée qui écartait
tout ce qui ne se rapportait pas au sujet de sa préoccupation. Mais à mesure qu’il
approchait du but auquel il tendait, il hâtait le pas.
Il entra dans le village au moment où l’on faisait rentrer les vaches. Elles
couraient dans la rue et augmentaient l’agitation qui régnait. Des femmes, des
enfants, des jeunes filles le croisaient à tout instant, courant sans cesse, comme
si l’on venait tout à coup de leur ouvrir la porte après une longue captivité. Elles
suivaient toutes le côté éclairé du village et se dirigeaient vers l’isba devant îaquelle
se pressait la foule.
Les cris des vieilles femmes qui faisaient rentrer le bétail, joints au piétinement
des troupeaux mugissants et bêlants, couvraient la rumeur de la rue et empêchaient
d’entendre, si ce n’est à de rares intervalles, des sanglots continus qui s’échappaient
de l’autre bout de la maison.
— Saveli, laisse les chevaux ! le vieux se meurt ! dit vivement la femme du jeune
moujik. Et elle disparut.
Saveli accéléra le pas ; un bruit de sanglots, de pleurs, de cris déchirants montait
de l’isba. Lorsque Saveli approcha de la maison, tout le monde se tut et tourna
sur lui des regards curieux. Sous l’auvent de la porte une demi-douzaine de brebis
et deux vaches se pressaient l’une contre l ’autre; dans la confusion du moment, on
les avait oubliées.
Saveli arrêta les chevaux et voulut leur retirer le harnais, mais un sanglot
désespéré jaillit de la chambre et anéantit tout ce qui lui restait encore découragé;
ses mains retombèrent, il branla la tête d’un mouvement plein d’angoisse et entra
dans l ’antichambre par la petite porte. La foule s’écarta devant lui avec un
empressement visible.
Le vestibule était bondé d’hommes et de femmes en larmes. Du milieu des
lamentations traînantes s’élevait parfois un sanglot qui perçait le coeur, comme un
couteau.
Dans la chambre du malade, la foule était encore plus compacte, pas moyen
de m e t t r e un pied devant l’autre. Il y avait des femmes, leur nourrisson au sein,
jusque sur les bancs ; le poêle et les soupentes étaient couverts d’hommes et de
femmes qui se serraient contre lé mur. Le bruit des sanglots était si fort qu’il était
impossible de se faire entendre, même en élevant la voix pour parler à l’oreille de
quelqu’un.
On ne voyait que des visages rouges et boursouflés, des yeux à demi fermés,
des bouches ouvertes d’où sortaient
des cris perçants. Les femmes
pour la plupart se tenaient embrassées,
la tête sur l’épaule l’une
de l’autre, et se balançaient, accompagnant
d ’un mouvement rythmique
la plainte cadencée de leur
douleur.
Le paysan russe envahit ainsi
la chambre du moribond et la
remplit de cris déchirants pour
témoigner son attachement et son
respect à l’agonisant, sans se douter
qu’il trouble aussi le calme de
f - 1 M
■ M L /liiiX ri JWÀ S
i m
r
\ /;.j il («Ma
ses derniers instants et augmente
certainement ses souffrances. Cet
Charpentiers.
usage, si contraire à l’observation
dés lois de l’hygiène, s’explique par le fatalisme du moujik. La vie ne l’a pas gâté;
il ne sait pas se tranquilliser par de vaines espérances ; il s’abandonne à sa douleur
sans raisonner, et c’est pourquoi le malheur lui semble inévitable. Il ne lutte pas
pour s’en délivrer, il courbe la tête et pleure.
Le moribond était étendu dans le coin le plus sombre de l’isba, un cierge jaune
collé à l ’icône jetait sur lui une faible clarté, ses genoux saillaient de sa couche
formant un angle rigide.
La femme du laboureur, aussi vieille que lui, était assise aux pieds du malade.
Elle avait les bras passés autour du cou de ses deux filles mariées, qui pleuraient
éperdument; de temps en temps elle laissait retomber sa tête sur l’épaule de l’une
ou de l’autre. Le mouchoir qui lui servait de coiffure jetait une ombre épaisse sur
son visage; un faible sanglot sortait par intervalles de la poitrine creuse de la vieille
femme ; elle semblait mourante elle-même.