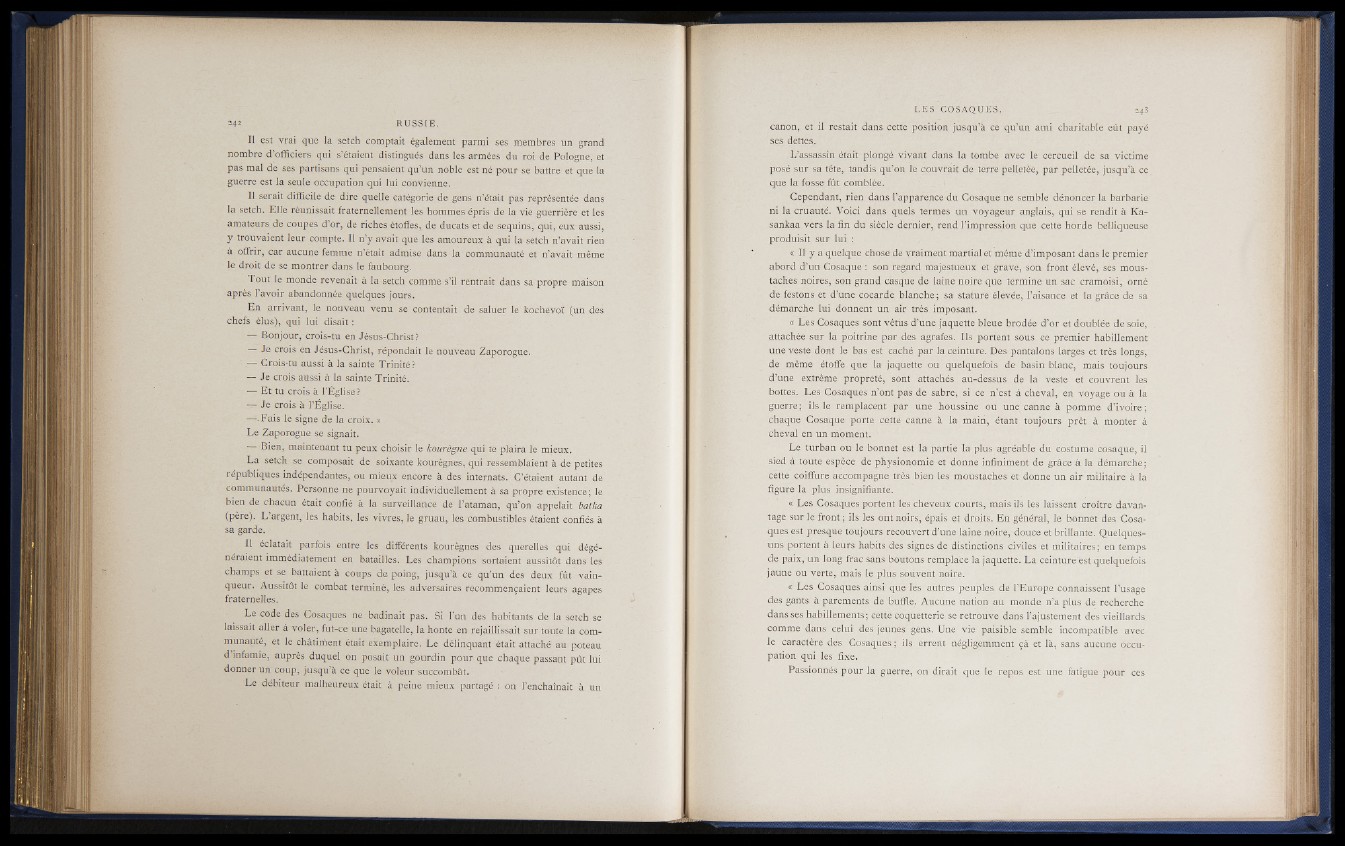
Il est vrai que la setch comptait également parmi ses membres un grand
nombre d’officiers qui s’étaient distingués dans les armées du roi de Pologne, et
pas mal de ses partisans qui pensaient qu’un noble est né pour se battre et que la
guerre est la seule occupation qui lui convienne.
Il serait difficile de dire quelle catégorie de gens n’était pas représentée dans
la setch. Elle réunissait fraternellement les hommes épris de la vie guerrière et les
amateurs de coupes d’or, de riches étoffes, de ducats et dé sequins, qui, eux aussi,
y trouvaient leur compte. Il n’y avait que les amoureux à qui la setch n’avait rien
à offrir, car aucune femme n’était admise dans la communauté et n’avait même
le droit de se montrer dans le faubourg.
Tout le monde revenait à la setch comme s’il rentrait dans sa propre maison
après l’avoir abandonnée quelques jours.
En arrivant, le nouveau venu se contentait de saluer le kochevoï (un des
chefs élus), qui lui disait :
— Bonjour, crois-tu en Jésus-Christ?
Je crois en Jésus-Christ, répondait le nouveau Zaporogue.
: |— Crois-tu aussi à la sainte Trinité
— Je crois aussi à la sainte Trinité.
— Et tu crois à l’Église ?
Je crois à l ’Église.
— .Fais le signe de la croix. »
Le Zaporogue se signait.
— Bien, maintenant tu peux choisir le kourègne qui te plaira le mieux.
La setch se composait de soixante kourègnes, qui ressemblaient à de petites
républiques indépendantes, ou mieux encore à des internats. C ’étaient autant de
communautés. Personne ne pourvoyait indi viduellement à sa propre existence ; le
bien de chacun était confié à la surveillance de l ’ataman, qu’on appelait batka
(père). L argent, les habits, les vivres, le gruau, les combustibles étaient confiés à
sa garde.
Il éclatait parfois entre les différents kourègnes des querelles qui dégénéraient
immédiatement en batailles. Les champions sortaient aussitôt dans les
champs et se battaient à coups de poing, jusqu’à ce qu’un des deux fût vainqueur.
Aussitôt le combat terminé, les adversaires recommençaient leurs agapes
fraternelles.
Le code des Cosaques ne badinait pas. Si l’un des habitants de la setch se
laissait aller à voler, fut-ce une bagatelle, la honte en rejaillissait sur toute la communauté,
et le châtiment était exemplaire. Le délinquant était attaché au poteau
d’infamie, auprès duquel on posait un gourdin pour que chaque passant pût lui
donner un coup, jusqu’à ce que le voleur succombât.
Le débiteur malheureux était à peine mieux partagé ; on l’enchaînait à un
canon, et il restait dans cette position jusqu’à ce qu’un ami charitable eût payé
ses dettes.
L’assassin était plongé vivant dans la tombe avec le cercueil de sa victime
posé sur sa tête, tandis qu’on le couvrait de terre pelletée, par pelletée, jusqu’à ce
que la fosse fût comblée.
Cependant, rien dans l’apparence du Cosaque ne semble dénoncer la barbarie
ni la cruauté. Voici dans quels termes un voyageur anglais, qui se rendit à Ka-
sankaa vers la fin du siècle dernier, rend l’impression que cette horde belliqueuse
produisit sur lui :
« Il y a quelque chose de vraiment martial et même d’imposant dans le premier
abord d’un Cosaque : son regard majestueux et grave, son front élevé, ses moustaches
noires, son grand casque de laine noire que termine un sac cramoisi, orné
de festons et d’une cocarde blanche; sa stature élevée, l ’aisance et la grâce de sa
démarche lui donnent un air très imposant.
« Les Cosaques sont vêtùs d’une jaquette bleue brodée d’or et doublée de soie,
attachée sur la poitrine par des agrafes. Ils portent sous ce premier habillement
une veste dont le bas est caché par la ceinture. Des pantalons larges et très longs,
de même étoffe que la jaquette ou quelquefois de basin blanc, mais toujours
d’une extrême propreté, sont attachés au-dessus^ de la veste et couvrent les
bottes. Les Cosaques n’ont pas de sabre, si ce n’est à cheval, en voyage ou à la
guerre; ils le remplacent par une houssine ou une canne à pomme d’ivoire;
chaque Cosaque porte cette canne à la main, étant toujours prêt à monter à
cheval en un moment.
Le turban ou le bonnet est la partie la plus agréable du costume cosaque, il
sied à toute espèce de physionomie et donne infiniment de grâce à la démarche;
cëtte coiffure accompagne très bien les moustaches et donne un air militaire à la
figure la plus insignifiante.
« Les Cosaques portent les cheveux courts, mais ils les laissent croître davantage
sur le front; ils les ont noirs, épais et droits. En général, le bonnet des Cosaques
est presque toujours recouvert d’une laine noire, douce et brillante. Quelques-
uns portent à leurs habits des signes de distinctions civiles et militaires; en temps
de paix, un long frac sans boutons remplace la jaquette. La ceinture est quelquefois
jaune ou verte, mais le plus souvent noire.
« Les Cosaques ainsi que les autres peuples de l’Europe connaissent l’usage
des gants à parements de buffle. Aucune nation au monde n’a plus de recherche
dans ses habillements; cette coquetterie, se retrouve dans l’ajustement des vieillards
comme dans celui des jeunes: gens. Une vie paisible semble incompatible avec
le caractère des Cosaques ; ils errent négligemment çà et là, sans aucune occupation
qui les fixe.
Passionnés pour la guerre, on dirait que le repos est une fatigue pour ces