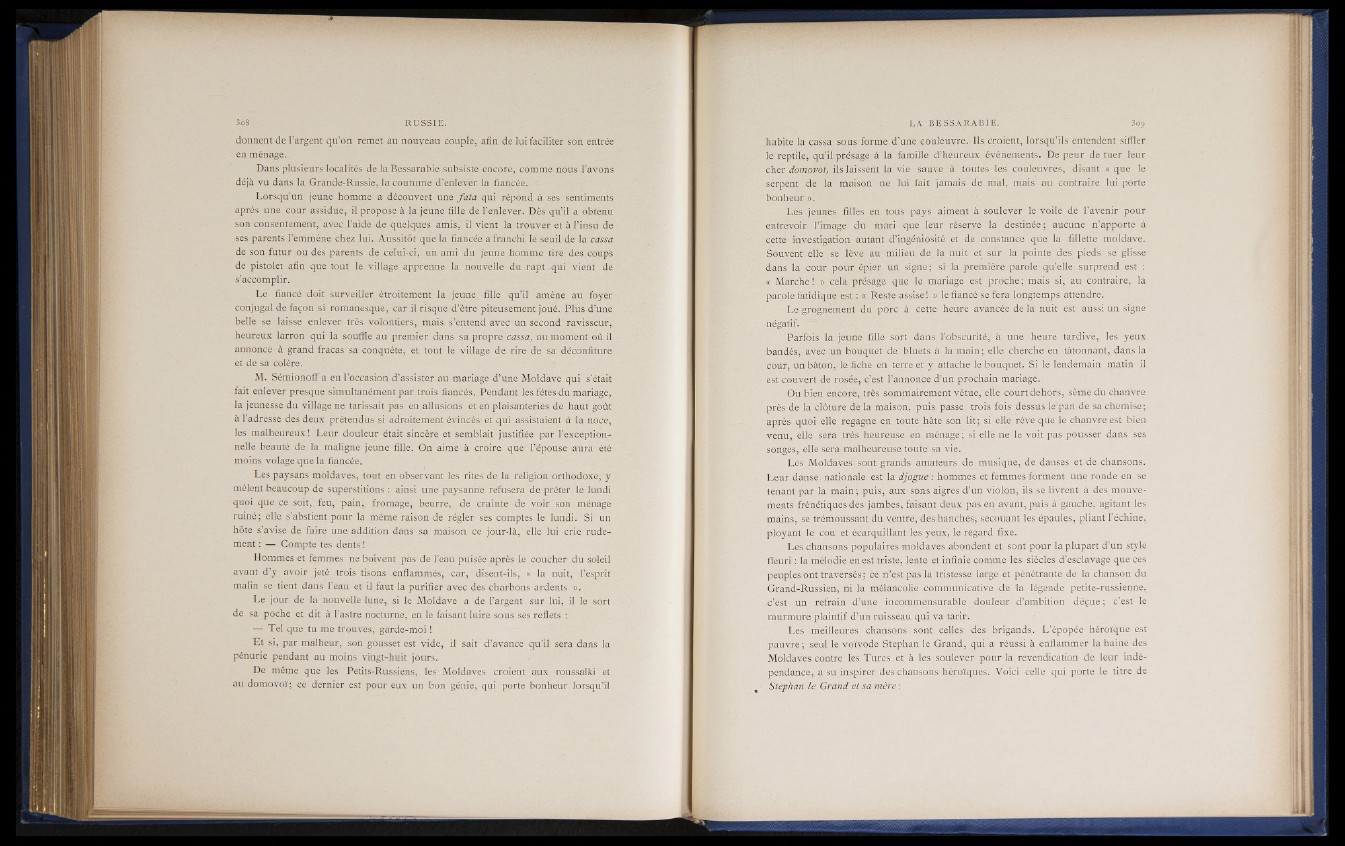
donnent de l’argent qu’on remet au nouveau couple, afin de lui faciliter son entrée
en ménage.
Dans plusieurs localités de la Bessarabie subsiste encore, comme nous l’avons
déjà vu dans la Grande-Russie, la coutume d’enlever la fiancée. '
Lorsqu’un jeune homme a découvert une fata qui répond à ses sentiments
après une cour assidue, il propose à la jeune fille de l’enlever. Dès qu’il a obtenu
son consentement, avec.l’aide de quelques amis, il vient la trouver et à l ’insu de
ses parents remmène chez lui. Aussitôt que la fiancée a franchi le seuil de la cassa
de son futur ou des parents de célui-ci, un ami du jeune homme tire des coup's
de pistolet afin que tout le village apprenne la nouvelle du rapt,qui vient de
s’accomplir.
Le fiancé doit surveiller étroitement la jeune fille qu’il amèrié au foyer
conjugal de façon si romanesque, car il risque d’être piteusement joué. Plus d’une,
belle se laisse enlever très volontiers, mais s’entend avec un second ravisseur,
heureux larron qui la souffle au premier dans sa propre cassa, au moment où il
annonce à grand fracas sa conquête, et tout le village de rire de sa déconfiture
et de sa colère.
M. Sémionoff a eu l’occasion d’assister au mariage d’une Moldave qui s’était
fait enlever presque simultanément par trois fiancés. Pendant les fêtes du mariage,
la jeunesse du village ne tarissait pas en allusions et en plaisanteries de haut goût
à l’adresse des deux prétendus si adroitement évincés et qui assistaient à la noce,
les malheureux ! Leur douleur était sincère et semblait justifiée par l’exceptionnelle
beauté de la maligne jeune fille. On aime à croire que l’épouse aura été
moins volage que la fiancée.
Les paysans moldaves* tout en observant les rites de la religion orthodoxe, y
mêlent beaucoup de superstitions : ainsi une paysanne refusera de prêter le lundi
quoi que ce soit, feu, pain, fromage, beurre, de crainte de voir son ménage
ruiné ; elle s’abstient pour la même raison de régler ses comptes le lundi;: Si un
hôte s’avise de faire une addition dans sa maison ce jour-là, elle lui crie rude-C
ment : — Compte tes dents !
Hommes et femmes ne boivent pas de l’eâu puisée après le coucher du soleil
avant d’y avoir jeté trois tisons enflammés, car, disent-ils, « la nuit, l’esprit
malin se tient dans l’eau et il faut la purifier avec des charbons ardents ».
Le jour de la nouvelle lune, si le Moldave a de l’argent sur lui, il le sort
de sa poche et dit à l’astre nocturne, en le faisant luire sous ses reflets :
— Tel que tu me trouves, garde-moi !
Et si, .par malheur, son gousset est vide, il sait d’avance qu’il sera dans la
pénurie pendant au moins vingt-huit jours.
De même què les Petits-Russiens, les Moldaves croient aux roussalki et
au domovoï; ce dernier est pour eux un bon génie, qui porte bonheur lorsqu’il:'
habite la cassa sous forme d’une couleuvre. Ils croient, lorsqu’ils entendent siffler
le reptile, qu’il présage à la famille d’heureux événements. De peur de tuer leur
cher domovoï, ils laissent la vie sauve à .toutes les couleuvres, disant « que le
serpent de la maison ne lui fait jamais de mal, mais au contraire lui porte
bonheur ».
Les jeunes filles en tous pays aiment à soulever le voile de l’avenir pour
entrevoir l’image du mari que leur réserve la destinée; aucune n’apporte à
cette investigation autant d’ingéniosité et de constance que la fillette moldave.
Souvent elle se lève au milieu de la nuit et sur la pointe des pieds se glisse
dans la cour pour épier un signe; si la première parole qu’elle surprend est :
« Marche ! » cela présage que le Éiariagè est proche; mais si, au contraire, la
parole fatidique est : « Reste assise! » le fiancé se fera longtemps attendre.
Le grognement du porc à . cette heure avancée de la nuit est aussi un signe
négatif.
Parfois la jeune fille sort dans l’obscurité, à une heure tardive, les yeux
bandés, avec un bouquet de bluets à la main; elle cherche en tâtonnant, dans la
cour, un bâton, le fiche en terre et y attache le bouquet. Si le lendemain matin il
est couvert de rosée, c’est l ’annonce d’un prochain mariage.
Où bien encore, très sommairement vêtue, elle court dehors, sème du chanvre
près de la clôture de la maison, puis passe trois fois dessus lè^pan de sa chemise;
après quoi elle regagne en toute hâte son lit; si elle rêve que le chanvre est bien
venu, elle sera très heureuse en ménage; si ellè ne Te voit pas pousser dans ses
songes, elle sera malheureuse toute sa vie.
Lès Moldaves sont grands amateurs de musique, de danses et de chansons.
Leur danse, nationale est la djogue : hommes et femmes forment une ronde en se
tenant par la main; puis, aux sons aigres d’un violon, ils se livrent à des mouvements
frénétiques des jambes* faisant deux pas en avant, puis à gauche, agitant les
mains, se trémoussant du yentre, des hanches, secouant les épaules, pliant l’échine,
ployant le cou et écarquillant les yeux, le regard fixe.
Les chansons populaires moldaves abondent et sont pour la plupart d’un style
fleuri : la mélodie en est triste, lente et infinie comme les siècles d’esclavage que ces
peuples ont traversés ; ce n’est pas la tristesse large et pénétrante de la chanson du
Grand-Russien, ni la mélancolie communicative de la légende petite-russienne,
..c’est un refrain d’une incommensurable douleur d’ambition déçue; c’est le
murmure plaintif d’un ruisseau qui va tarir.
Les meilleures chansons sont celles des brigands. L ’épopée héroïque est
pauvre ; seul le voïvode Stephan le Grand, qui a réussi à enflammer la haine des
Moldaves contre les Turcs et à les soulever pour la revendication de leur indépendance,
a su inspirer des chansons héroïques. Voici celle qui porte le titre de
Stephan le Grand et sa mère :