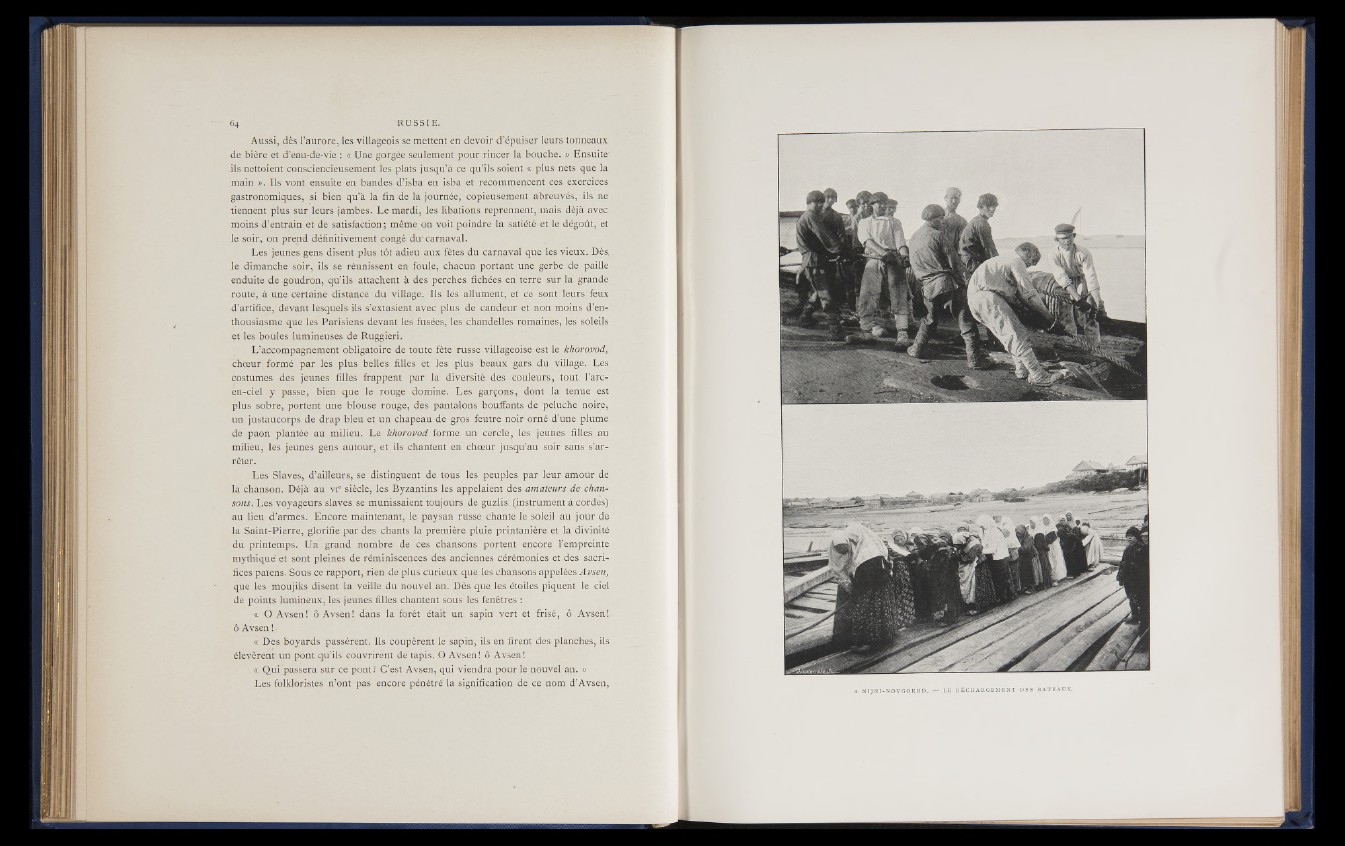
Aussi, dès l’aurore, les villageois se mettent en devoir d’épuiser leurs tonneaux
de bière et d’eau-de-vie : « Une gorgée seulement pour rincer là bouche. » Ensuite
ils nettoient consciencieusement les plats jusqu’à ce qti’ils soient « plus nets que la
main ». Ils vont ensuite en bandes d’isba en isba et recommencent ces exercices
gastronomiques, si bien qu’à la fin de la journée, copieusement abreuvés, ils ne
tiennent plus sur leurs jambes. Le mardi, les libations reprennent, mais déjà avec
moins d’entrain et de satisfaction ; même on voit poindre la satiété et le dégoût, et
le soir, on prend définitivement congé du*carnaval.
Les jeunes gens disent plus tôt adieu aux fêtes du carnaval que les vieux. Dès.
le dimanche soir, ils se réunissent en foule, chacun portant une gerbe de paille
enduite de goudron, qu’ils attachent à des perches fichées en terre sur la grande
route, à une certaine distance du village. Ils les allument, et ce sont leurs feux
d’artifice, devant lesquels ils s’extasient avec plus de candeur et non moins d’enthousiasme
que les Parisiens devant les fusées, les chandelles romaines, les soleils
et les boules, lumineuses de Ruggieri.
L ’accompagnement obligatoire de toute fête russe villageoise est le khorovod,
choeur formé par les plus belles filles et les plus beaux gars du village. Les
costumes des jeunes filles frappent par la diversité des couleurs, tout l’arc-
en-ciel y passe, bien que le rouge domine. Les garçons, dont la tenue est
plus sobre, portent une blouse rouge, des pantalons bouffants de peluche noire,
un justaucorps de drap bleu et un chapeau de gros feutre noir orné d’une plume
de paon plantée au milieu. Le khorovod forme un cercle, les jeunes filles au;
milieu, les jeunes gens autour, et ils chantent en choeur jusqu’au soir sans s’arrêter.
Les Slaves, d’ailleurs, se distinguent de tous les peuples par leur amour de
la chanson. Déjà au vie siècle, les Byzantins les appelaient des amateurs de chansons.
Les voyageurs slaves se munissaient toujours de guzlis (instrument à cordes)
au lieu d’armes. Encore maintenant, le paysan russe chante le soleil au jour dé
la Saint-Pierre, glorifie par des chants la première pluie printanière et la divinité
du printemps. Un grand nombre de ces chansons portent encore l’empreinte
mythique et sont pleines de réminiscences des anciennes cérémonies et des sacrifices
païens. Sous ce rapport, rien de plus curieux que les chansons appelées Avsen,
que les moujiks disent la veille du nouvel an. Dès que les étoiles piquent le ciel
de points lumineux, les jeunes filles chantent sous les fenêtres :
« O Avsen! ô Avsen! dans la forêt était un sapin vert et frisé, ô Avsen;!
ô Avsen ! •
« Des boyards passèrent. Ils coupèrent le sapin, ils en firent des planches, ils
élevèrent'un pont qu’ils couvrirent de tapis. O Avsen! ô Avsen!
' oe Qui passera sur ce pont? C’est Avsen, qui viendra pour le nouvel an. »
Les folkloristes n’ont pas encore pénétré' la signification de ce nom d’Avsen,