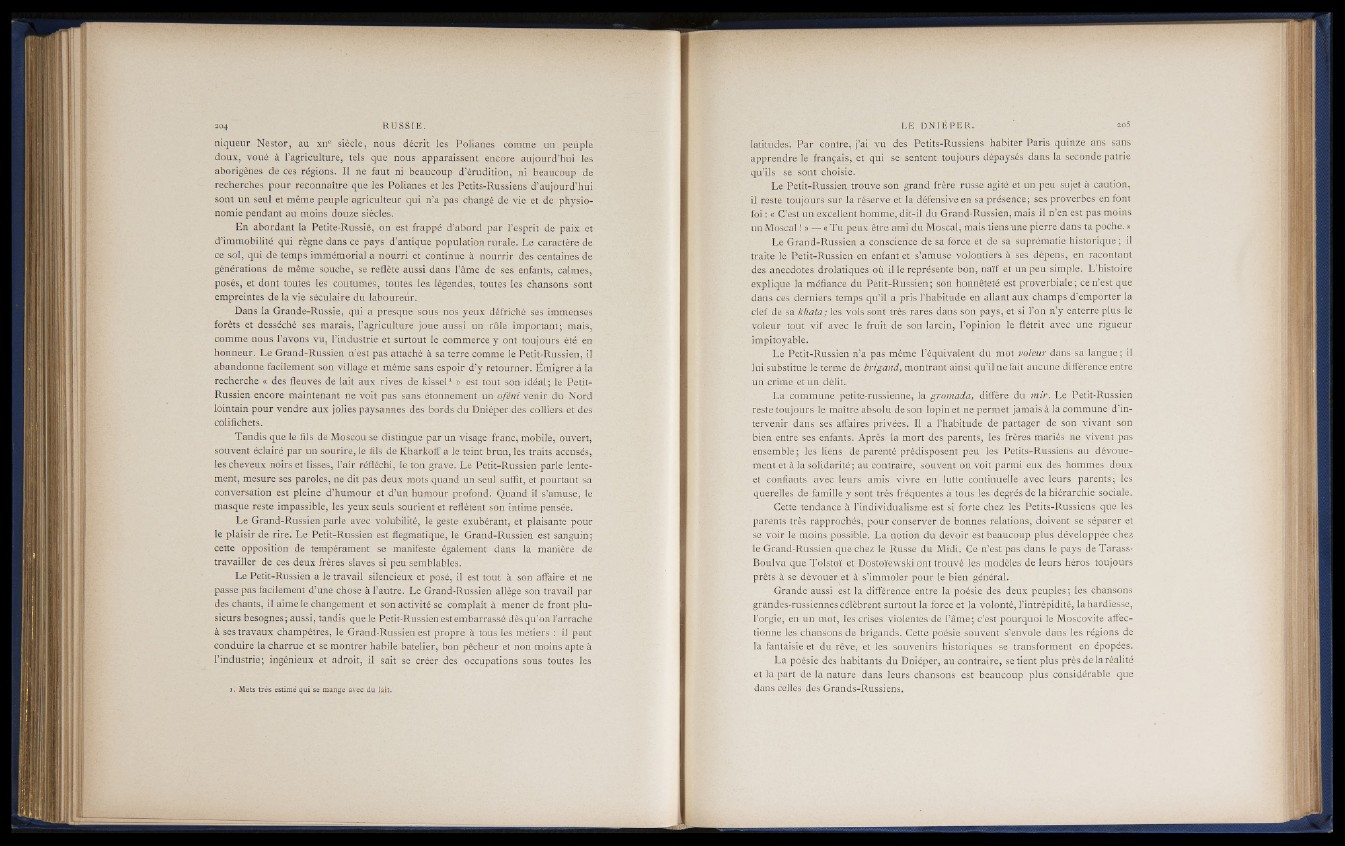
niqueur Nestor, au xne siècle, nous décrit les Polianes comme un. peuple
doux, voué à l’agriculture, tels que nous apparaissent encore aujourd’hui les
aborigènes de ces régions. Il ne faut ni beaucoup d’érudition, ni beaucoup de
recherches pour reconnaître que les Polianes et les Petits-Russiens d’aujourd’hui
sont un seul et même peuple agriculteur qui n’a pas changé de vie et de physionomie
pendant au moins douze siècles.
En abordant la Petite-Russié, on est frappé d’abord par l’esprit de paix et
d’immobilité qui règne dans ce pays d’antique population rurale. Le caractère de
ce sol, qui de temps immémorial a nourri et continue à nourrir des centaines de
générations de même souche, se reflète aussi dans l ’âme de ses enfants, calmes,
posés, et dont toutes les coutumes, toutes les légendes, toutes les chansons sont
empreintes de la vie séculaire du laboureur.
Dans la Grande-Russie, qui a presque sous nos yeux défriché ses immenses
forêts et desséché ses marais, l’agriculture joue aussi un rôle important; m aisi
comme nous l’avons vu, l’industrie et surtout le commerce y ont toujours été en
honneur. Le Grand-Russien n’est pas attaché à sa terre comme le Petit-Russien, il
abandonne facilement son village et même sans espoir d’y retourner. Émigrer à la
recherche « des fleuves de lait aux rives de kissel1 » est tout son idéal; le Petit-
Russien encore maintenant ne voit pas sans étonnement un oféni venir du Nord
lointain pour vendre aux jolies paysannes des bords du Dniéper des colliers et des
colifichets.
Tandis que le fils de Moscou se distingue par un visage franc, mobile, ouvert,
souvent éclairé par un sourire, le fils de Kharkoff a le teint brun, les traits accusés,
les cheveux noirs et lisses, l ’air réfléchi, le ton grave. Le Petit-Russien parle lentement,
mesure ses paroles, ne dit pas deux mots quand un .seul suffit, et pourtant sa
conversation est pleine d’humour et d’un humour profond. Quand il s’amuse, le
masque reste impassible, les yeux seuls sourient et reflètent son intime pensée.
L e Grand-Russien parle avec volubilité, le geste exubérant, et plaisante pour
le plaisir de rire. Le Petit-Russien est flegmatique, le Grand-Russien est sanguin;
cette opposition de tempérament se manifeste également dans la manière de
travailler de ces deux frères slaves si peu semblables.
Le Petit-Russien a le travail silencieux et posé, il est tout à son affaire et ne
passe pas facilement d’une chose à l’autre. Le Grand-Russien allège son travail par
des chants, il aime le changement et son activité se complaît à mener de front plusieurs
besognes; aussi, tandis que le Petit-Russien est embarrassé dès qu’on l’arrache
à ses travaux champêtres, le Grand-Russien est propre à tous les métiers : il peut
conduire la charrue et se montrer habile batelier, bon pêcheur et non moins apte à
l’industrie; ingénieux et adroit, il sait se créer des occupations sous toutes les
i . Mets très estimé qui se mange avec du lait.
latitudes. Par contre, j’ai, yu des Petits-Russiens habiter Paris quinze ans sans
apprendre le français, et qui se sentent toujours dépaysés dans la seconde patrie
qu’ils,, se sont choisier
Le Petit-Russien trouve son grand frère russe agité et un peu sujet à caution,
il reste toujours sur la réserve et la défensive en sa présence; ses proverbes en font
foi : « C ’est un excellent homme, dit-il du Grand-Russien, mais il n’en est pas moins
un Moscal ! » — « T u peux être ami du Moscal, mais tiens une pierre dans ta poche. »
Le Grand-Russien a conscience de sa force et de sa suprématie historique ; il
traite le Petit-Russien en enfant et s’amuse volontiers à ses dépens, en racontant
des anecdotes drolatiques où il le représente bon, naïf et un peu simple. L ’histoire
explique la méfiance du Petit-Russien ; son honnêteté est proverbiale ; ce n’est que
dans ces derniers temps qu’il a pris l’habitude en allant aux champs d’emporter la
clef de sa khata; les vols sont très rares dans son pays, et si l’on n’y enterre plus le
vôleur tout v if avec le fruit de son larcin, l’opinion le flétrit avec une rigueur
impitoyable. .
Le Petit-Russien n’a pas même l’équivalent du mot voleur dans sa langue ; il
lui substitue le terme de brigand, montrant ainsi qu’il ne fait aucune différence entre
un crime et un délit.
La commune petite-russienne, la gromada, diffère du mir. Le Petit-Russien
reste toujours le maître absolu de son lopin et ne permet jamais à la commune d’intervenir
dans ses affaires privées. Il a l’habitude de partager de son vivant son
bien entre ses enfants. Après la mort des parents, les frères mariés ne vivent pas
ensemble ; les liens de parenté prédisposent peu les Petits-Russiens au dévouement
et à la solidarité ; au contraire, souvent on voit parmi eux des hommes doux
et confiants avec leurs amis vivre en lutte continuelle avec leurs parents; les
querelles de famille y sont très fréquentes à tous les degrés de la hiérarchie sociale.
Cette tendance à l’individualisme est si forte chez les Petits-Russiens que les
parents très rapprochés, pour conserver de bonnes relations, doivent se séparer et
se voir le moins possible. La notion du devoir est beaucoup plus développée chez
le Grand-Russien que chez le Russe du Midi. Ce n’est pas dans le pays de Tarass-
Boulva que Tolstoï et Dostoïewski ont trouvé les modèles de leurs héros toujours
prêts à se dévouer et à s’immoler pour le bien général.
Grande aussi est la différence entre la poésie des deux peuples ; les chansons
grandes-russiennes célèbrent surtout la force et la volonté, l’intrépidité, la hardiesse,
l’orgie, en un mot, les crises violentes de l’âme; c’est pourquoi le Moscovite affectionne
les chansons de brigands. Cette poésie souvent s’envole dans les régions de
la fantaisie et du rêve, et les souvenirs historiques se transforment en épopées.
La poésie des habitants du Dniéper, au contraire, se tient plus près de la réalité
et la part de la nature dans leurs chansons est beaucoup plus considérable que
dans celles des Grands-Russiens.