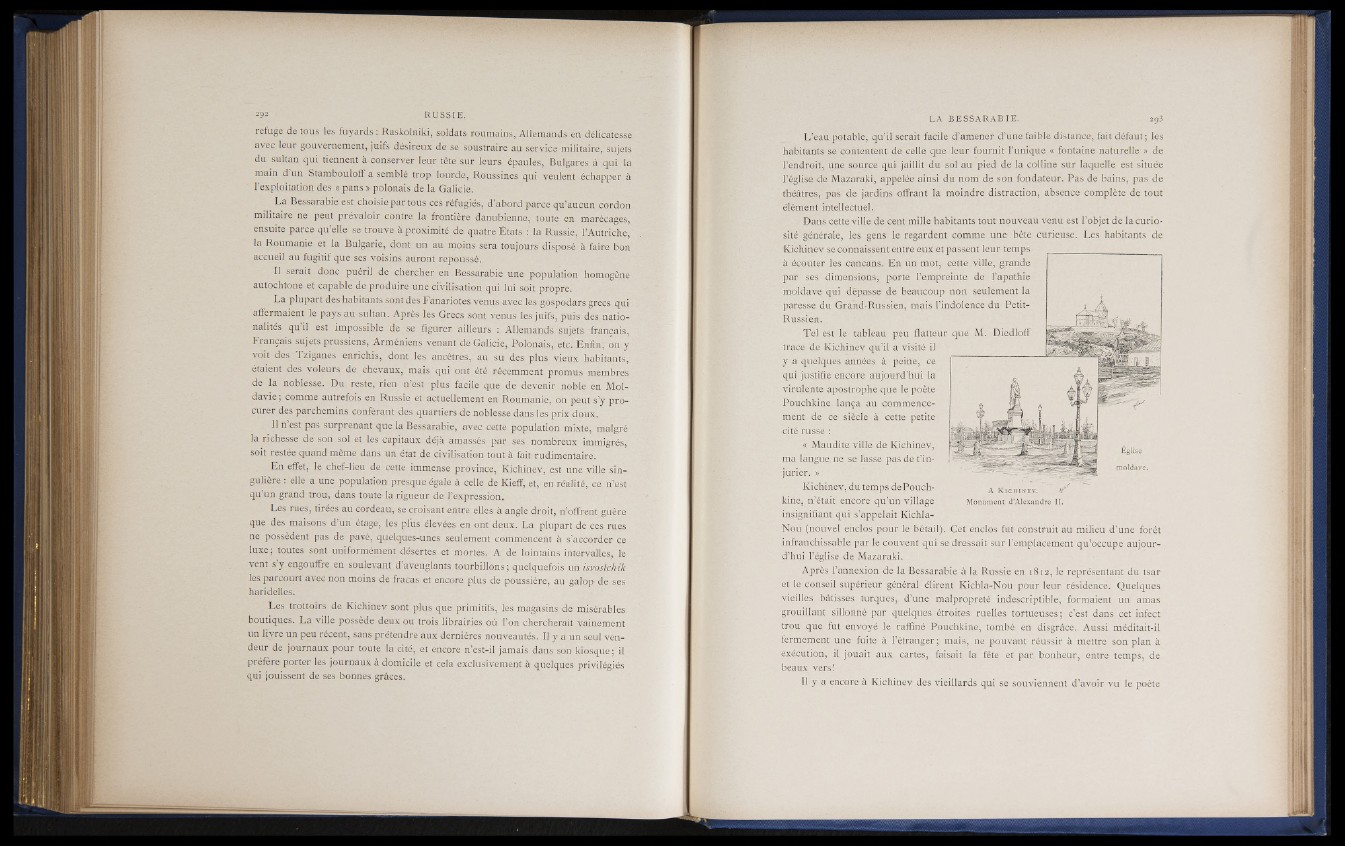
refuge de tous les fuyards : Raskolniki, soldats roumains, Allemands en délicatesse
avec leur gouvernement, juifs désireux de se soustraire au service militaire, sujets
du sultan qui tiennent à-conserver leur tête sur leurs épaules, Bulgares à qui la
main d un StamboulofF a semblé trop lourde, Roussines qui veulent échapper à
l ’exploitation des « pans » polonais de la Galicie.
La Bessarabie est choisie par tous, ces réfugiés, d’abord parce qu’aucun cordon
militaire ne peut prévaloir contre la frontière danubienne, toute en marécages,
ensuite parce qu’elle se trouve à proximité de quatre États : la Russie, l’Autriche,
la Roumanie et la Bulgarie, dont un au moins sera toujours disposé à faire bon
accueil au fugitif que ses voisins auront repoussé.
Il serait donc puéril de chercher e n . Bessarabie une population homogène
autochtone et capable de produire une civilisation qui lui soit propre.
La plupart des habitants sont des Fanariotes venus avec les gospodars grecs qui
affermaient le pays au sultan. Après les Grecs sont venus les juifs, puis des nationalités
qu’il est impossible de se figurer ailleurs : Allemands sujets français,
Français sujets prussiens, Arméniens venant de Galicie, Polonais,, etc. Enfin“ on y
voit des Tziganes enrichis, dont les ancêtres, au su des plus vieux -habitants,
étaient des voleurs de chevaux, mais qui ont été récemment promus membres
de la noblesse. Du, reste, rien n’est plus facile que de devenir noble en Moldavie
, comme autrefois en Russie et actuellement en Roumanie;, on peut s’y procurer
des parchemins conférant des quartiers de noblesse dans les prix doux.
11 n’est pas surprenant que la Bessarabie, avec cette population mixte, malgré-
là richesse dé son sol et les capitaux déjà amassés par ses nombreux immigrés,
soit restée quand même dans un état de civilisation tout à fait rudimentaire.
En effet, le chef-lieu de cette immense province, Kichinev, est une ville sin-
gulière : elle a une population presque égale à celle de Kieff, et, en réalité, ce n’est
qu’un grand trou, dans toute-la rigueur de l’expression.
Les rues, tirées au cordeau, se croisant entre elles à angle droit, n’offrent guère
que des maisons d’un étage, les plus élevées en ont deux. La plupart de ces rues
ne possèdent pas de pavé, quelques-unes seulement commencent à s’accorder ce
luxe; toutes sont uniformément désertes et mortes. A de lointains intervalles, le
vent s y engouffre en soulevant d’aveuglants tourbillons ; quelquefois un isvostchik
les parcourt avec non moins de fracas et encore plus de poussière, au galop de ses
haridelles.
Les trottoirs de Kichinev sont plus que primitifs, les magasins de misérables
boutiques. La ville possède deux ou trois librairies où l ’on chercherait vainement
un livre un peu récent, sans prétendre aux dernières nouveautés. Il y a un seul vendeur
de journaux pour toute la cité, et encore n’est-il .jamais dans son kiosque; il
préfère porter les journaux à domicile et cela exclusivement à quelques privilégiés
qui jouissent de ses bonnes grâces.
L ’eau potable, qu’il serait facile d’amener d’une faible distance, fait défaut; les
habitants se contentent de cellè que leur fournit l’unique « fontaine naturelle » de
l’endroit, une source qui jaillit du sol au pied de la colline sur laquelle est située
l ’église de Mazâraki, appèlée ainsi du nom de son fondateur. Pas de bains, pas de
théâtres, pas de jardins offrant la moindre distraction, absence complète de tout
élément intellectuel.
Dans cette ville de cent mille habitants tout nouveau venu est l’objet de la curiosité
générale, les gens le regardent comme une bête curieuse. Les habitants de
Kichinev se connaissent entre eux et passent leur temps
à écouter les cancans. En un mot, cette ville, grande
par ses dimensions., porte l’empreinte de l’apathie
moldave qui dépasse de beaucoup non seulement la
paresse du Grand-Russien, mais l’indolence du Petit-
Russien.
Tel est le tableau peu flatteur que M.
trace de Kichinev qu’il a visité il
y a quelques années à peine, ce
qui justifie encore aujourd’hui la
virulente apostrophe que le poète
Pouchkine lança au commencement
de ce siècle; à cette petite
cité russe : :
«. Maudite ville de Kichinev,
ma langue ne se lasse pas de t’injurier.
» '
Kichinev, du temps de Pouchkine,
n’était encore qu’un village
A K i c h i n e v . Jf
Monument d’Alexandre II.
insignifiant qui s’appelait Kichla-
Nou (nouvel enclos pour le bétaifJ^Cet enclos fut construit au milieu d’une forêt
infranchissable par le couvent qui se dressait sur l’emplacement qu’occupe aujourd’hui
l’église de, Mazaraki.
Après l’annexion de la Bessarabie à la Russie en 1812, le représentant du tsar
et le conseil supérieur général élirent Kichla-Nou pour leur résidence. Quelques
vieilles bâtisses turques, d’une malpropreté indescriptible, formaient un amas
grouillant sillonné par quelques étroites ruelles tortueuses ; c’est dans cet infect
trou que fut envoyé le raffiné Pouchkine, tombé en disgrâce. Aussi méditait-il
fermement une fuite à l’étranger; mais, ne pouvant réussir à mettre son plan à
exécution, il jouait aux cartes, faisait la fête et par; bonheur, entre temps, de
beaux vers !
Il y a encore à Kichinev des vieillards qui se souviennent d’avoir vu le poète