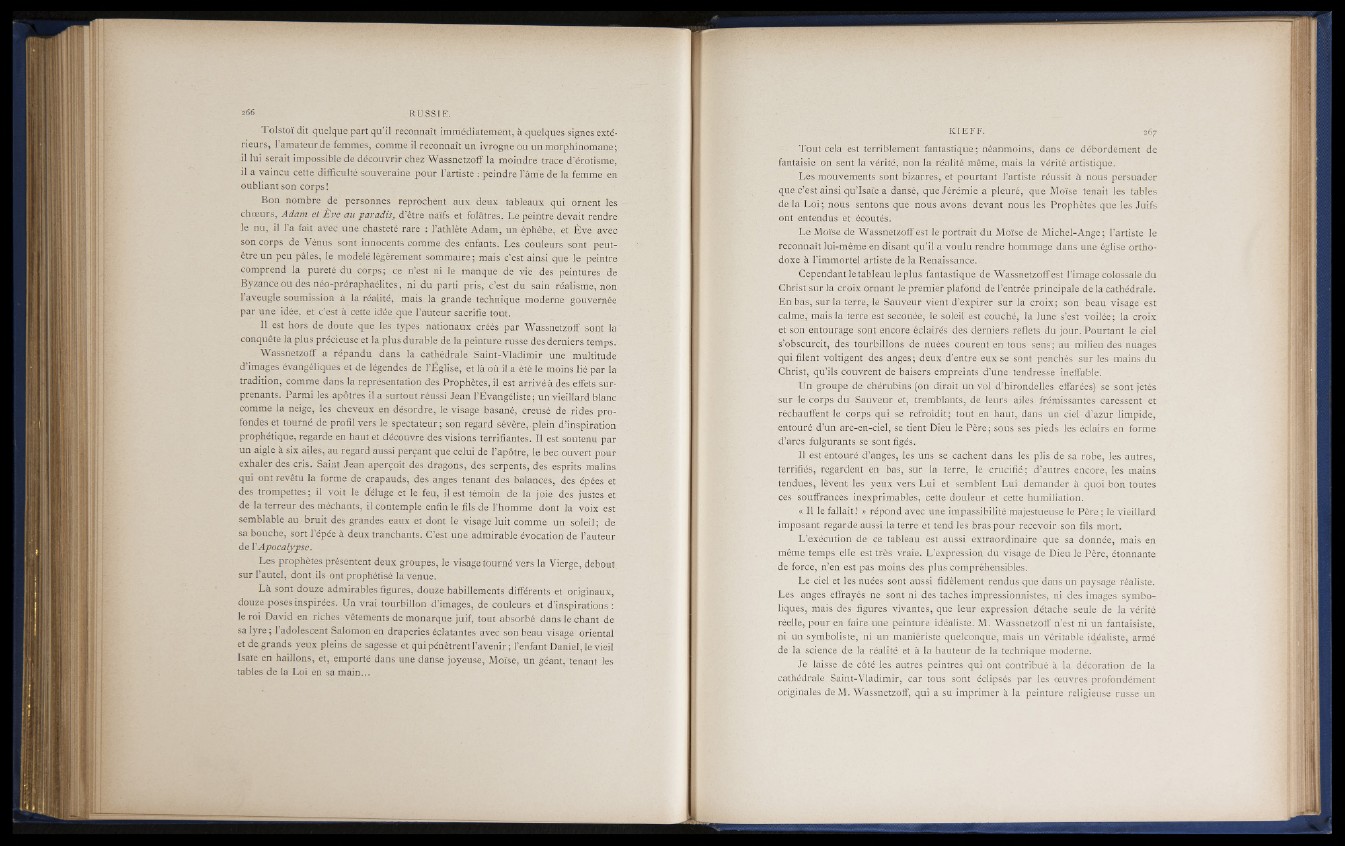
Tolstoï dit quelque part qu’il reconnaît immédiatement, à quelques signes extérieurs,
l’amateur de femmes, comme il reconnaît un ivrogne ou un morphinomane;
il lui serait impossible de découvrir chez Wassnetzoff la moindre trace d’érotisme,
il a vaincu cette difficulté souveraine pour l’artiste : peindre l’âme de la femme en
oubliant son corps!
Bon nombre de personnes reprochent aux deux tableaux qui ornent les
choeurs, Adam et Eve au paradis, d’être naïfs et folâtres. Le peintre devait rendre
le nu, il Fa fait avec une chasteté rare : l’athlète Adam, un éphèbe, et Ève avec
son corps de Vénus sont innocents comme des enfants. Les couleurs sont peut-
être un peu pâles, le modelé légèrement sommaire ; mais c’est ainsi que le peintre
comprend la pureté du corps; ce n’est ni le manque de vie des peintures de
Byzance ou des néo-préraphaélites, ni du parti pris, c’est du sain réalisme, non
l’aveugle soumission à la réalité, mais la grande technique moderne gouvernée
par une idée, et c’est à cette idée que l’auteur sacrifie tout.
Il est hors de doute que les types nationaux créés par Wassnetzoff sont la
conquête la plus précieuse et la plus durable de la peinture russe des derniers temps.
Wassnetzoff a répandu dans la cathédrale Saint-Vladimir une multitude
d’images évangéliques et de légendes de l’Église, et là où il a été le moins lié par la
tradition, comme dans la représentation des Prophètes, il est arrivé à des effets surprenants.
Parmi les apôtres il a surtout réussi Jean l’Évangéliste; un vieillard blanc
comme la neige, les cheveux en désordre, le visage basané, creusé de rides profondes
et tourné de profil vers le spectateur; son regard sévère, plein d’inspiration
prophétique, regarde en haut et découvre des visions terrifiantes. Il est soutenu par
un aigle à six ailes, au regard aussi perçant que celui de l’apôtre, le bec ouvert pour
exhaler des cris. Saint Jean aperçoit des dragons, des serpents, des esprits malins
qui ont revêtu la forme de crapauds, des anges tenant des balances, des épées et
des trompettes; il voit le déluge et le feu, il est témoin de la joie des justes et
de la terreur des méchants, il contemple enfin le fils de l’homme dont la voix est
semblable au - bruit des grandes eaux et dont le visage luit comme un soleil ; de
sa bouche, sort l ’épée à deux tranchants. C ’est une admirable évocation de l’auteur
de V Apocalypse.
Les prophètes présentent deux groupes, le visage tourné vers la Vierge, debout,
sur l’autel, dont .ils ont prophétisé la venue.
Là sont douze admirables figures, douze habillements différents et originaux,
douze .poses inspirées. Un vrai tourbillon d’images, de couleurs et d’inspirations :
le roi David en riches vêtements de monarque juif, tout absorbé dans le chant de
sa lyre; l’adolescent Salomon en draperies éclatantes avec son beau visage oriental
et de grands yeux pleins de sagesse et qui pénètrent l’avenir ; l’enfant Daniel, le vieil
Isaïe en haillons, et, emporté dans une danse joyeuse, Moïse, un géant, tenant les
tables de la Loi en sa main...
KIEFF. 267
Tout cela est terriblement fantastique ; néanmoins, dans ce débordement de
fantaisie on sent la vérité, non la réalité même, mais la vérité artistique.
Les mouvements sont bizarres, et pourtant l’artiste réussit à nous persuader
que c’est ainsi qu’Isaïe a dansé, que Jérémie a pleuré, que Moïse tenait les tables
de la Lo i; nous Séntons que nous avons devant nous les Prophètes que les Juifs
ont entendus et écoutés.
Le Moïse de Wassnetzoff est le portrait du Moïse de Michel-Ange ; l’artiste le
reconnaît lui-même en disant qu’il a voulu rendre hommage dans une église orthodoxe
à l’immortel artiste de la Renaissance.
Cependant le tableau le plus fantastique de Wassnetzoff est l ’image colossale du
Christ sur la croix ornant le premier plafond de l’entrée principale delà cathédrale.
En bas, sur la terre, le Sauveur vient d’expirer sur la croix; son beau visage est
calme, mais la terre est secouée, le soleil est couché, la lune s’est voilée; la croix
et son entourage sont encore éclairés des derniers reflets du jour. Pourtant le ciel
s’obscurcit, des tourbillons de nuées courent en tous sens; au milieu des nuages
qui filent voltigent des anges; deux d’entre eux se sont penchés sur les mains du
Christ, qu’ils couvrent de baisers empreints d’une tendresse ineffable:
Un groupe de chérubins (on dirait un vol d’hirondellës effarées) se sont jetés
sur le corps du' Sauveur et, tremblants, de leurs ailes frémissantes caressent et
réchauffent le corps qui se refroidit; tout en haut, dans un ciel d’azur limpide,
entouré d’un arc-en-ciel, se tient Dieu le Père; sous ses pieds les éclairs en forme
d’arcs fulgurants se sont figés.
Il est entouré d’anges, les uns se cachent dans les plis de sa robe, les autres,
terrifiés, regardent en bas, sur la terre, le crucifié ; d’autres encore, les mains
tendues, lèvent les yeux vers Lui et semblent Lui demander à quoi bon toutes
ces souffrances inexprimables, cette douleur et cette humiliation.
« Il le fallait! » répond avec une impassibilité majestueuse le Père.; le vieillard
imposant regarde aussi la terre et tend les bras pour recevoir son fils mort.
L ’exécution de ce tableau est aussi extraordinaire que sa donnée, mais en
même temps elle est très vraie. L ’expression du visage de Dieu le Père, étonnante
de force, n’en est pas moins des plus compréhensibles.
Le ciel et les nuées sont aussi fidèlement rendus que dans un paysage réaliste.
Les anges effrayés ne sont ni des taches impressionnistes, ni des images symboliques,
mais des figures vivantes, que leur expression détache seule de la vérité
réelle, pour en faire une peinture idéaliste. M. Wassnetzoff n’est ni un fantaisiste,
ni un symboliste, ni un maniériste quelconque, mais un véritable idéaliste, armé
de la science de la réalité et à la hauteur de la technique moderne.
Je laisse de Côté les autres peintres qui ont contribué à la décoration de la
cathédrale Saint-Vladimir, car tous sont éclipsés par les oeuvres profondément
originales de M. Wassnetzoff, qui a su imprimer à la peinture religieuse russe un