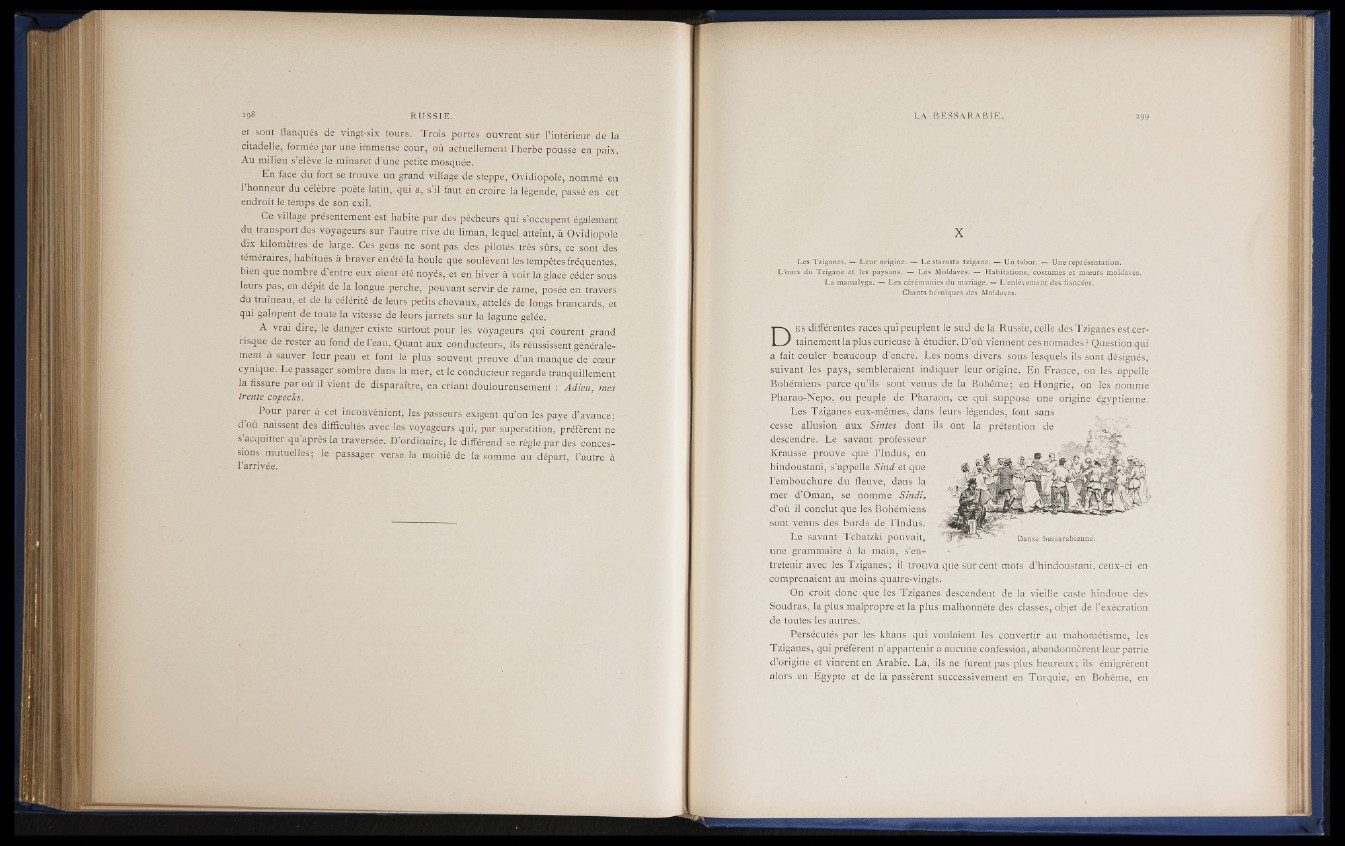
et sont flanqués de vingt-six tours. Trois portes ouvrent sur l’intérieur de la
citadelle, formée par une immense cour, où actuellement l ’herbe pousse en paix.
Au milieu s’élève le minaret d’une petite mosquée.
En face du fort se trouve un grand village de steppe, Ovidiopole, nommé en
l’honneur du célèbre poète latin, qui a, s’il faut en croire la légende, passé en cet
endroit lé temps de son exil.
Ce village présentement est habité par des pêcheurs qui s’occupent également
du transport des voyageurs sur Vautre rive du liman, lequel atteint, à Ovidiopole
dix kilomètres de large. Ces gens ne sont pas des pilotes très sûrs, ce sorit des
téméraires, habitués à- braver en été la houle que soulèvent les tempêtes fréquentes,
bien que nombre d’entre eux aient été noyés, et en hiver à voir la glace céder sous
leurs pas, en dépit de la longue perche, pouvant servir de rame, posée en travers
du traîneau, et de la célérité de leurs petits chevaux, attelés de longs brancards, et
qui galopent de toute la vitesse de leurs jarrets sur la lagune gelée.
A vrai dire, le danger existe surtout pour les voyageurs . qui; Courent grand
risque de rester au fond de l ’eau. Quant aux conducteurs, ils réussissent généralement
à sauver leur peau et font le plus souvent preuve d’un manque de cçsür
cynique. Le passager sombre dans la mer, et le conducteur regarde tranquillement
la fissure par où il vient de disparaître, en criant douloureusement : Adieu, mes
trente copecks.
■ Pour parer à cet inconvénient, les passeurs exigent qü’on les paye d’avance ;
d o ù naissent des difficultés avec les voyageurs qui, par superstition, préfèrent ne
s acquitter qu après la traversée. D’ordinaire, le différend se règle par des concessions
mutuelles; le passager verse la moitié de la somme au départ,il'àîitre à
l ’arrivée.
Les Tziganes. — Leur origine. — Le starosta tzigane. — Un t-ab or. — Une représentation.
L ’ours du Tzigane et les paysans. — Les Moldaves. — Habitations, costumes et moeurs moldaves.
La mamalyga. — Les cérémonies du mariage. — L’enlèvement des fiancées.
• ••••■ Ghànts héroïques des Moldaves.-
De s différentes races qui peuplent le sud de là Russie, celle des Tziganes est certainement
la plus curieuse à étudier. D ’où viennent ces nomades ? Question qui
a fait couler beaucoup d’encre. Les noms divers sous lesquels ils sont désignés,
suivant les pays, sembleraient indiquer leur origine. En France, on les appelle
Bohémiens parce qu’ils sont venus de la Bohême; en Hongrie, on les nomme
Pharao-Nepo, ou peuple de Pharaon, ce qui suppose une origine égyptienne.
Les Tziganes eux-mêmes, dans leurs légendes, font sans
cesse allusion aux Sintes dont ils ont la prétention de
descendre. Le savant professeur
Krausse prouve que l ’Indus, en
hindoustani, s’appelle Sind et que
l’embouchure du fleuve, dans la
mer d’Oman, se nomme Sindi,
d’où il conclut que les Bohémiens
sont venus des bords de l’Indus.
Le savant Tchatzki pouvait,
une grammaire à la main, s’entretenir
avec les Tziganes; il trouva que sur cent mots d’hindoustani, ceux-ci en
comprenaient au moins quatre-vingts.
On .croit donc que les Tziganes descendent de la vieille caste hindoue des
Soudras, la plus malpropre et la plus malhonnête des classes, objet de l’exécration
de toutes les autres.
Persécutés par les khans qui voulaient les convertir au mahométisme, les
Tziganes, qui préfèrent n’appartenir à aucune confession, abandonnèrent leur patrie
d’origine et vinrent en Arabie. Là, ils ne furent pas plus heureux; ils émigrèrent
alors en Egypte et de là passèrent successivement en Turquie, en Bohême, en