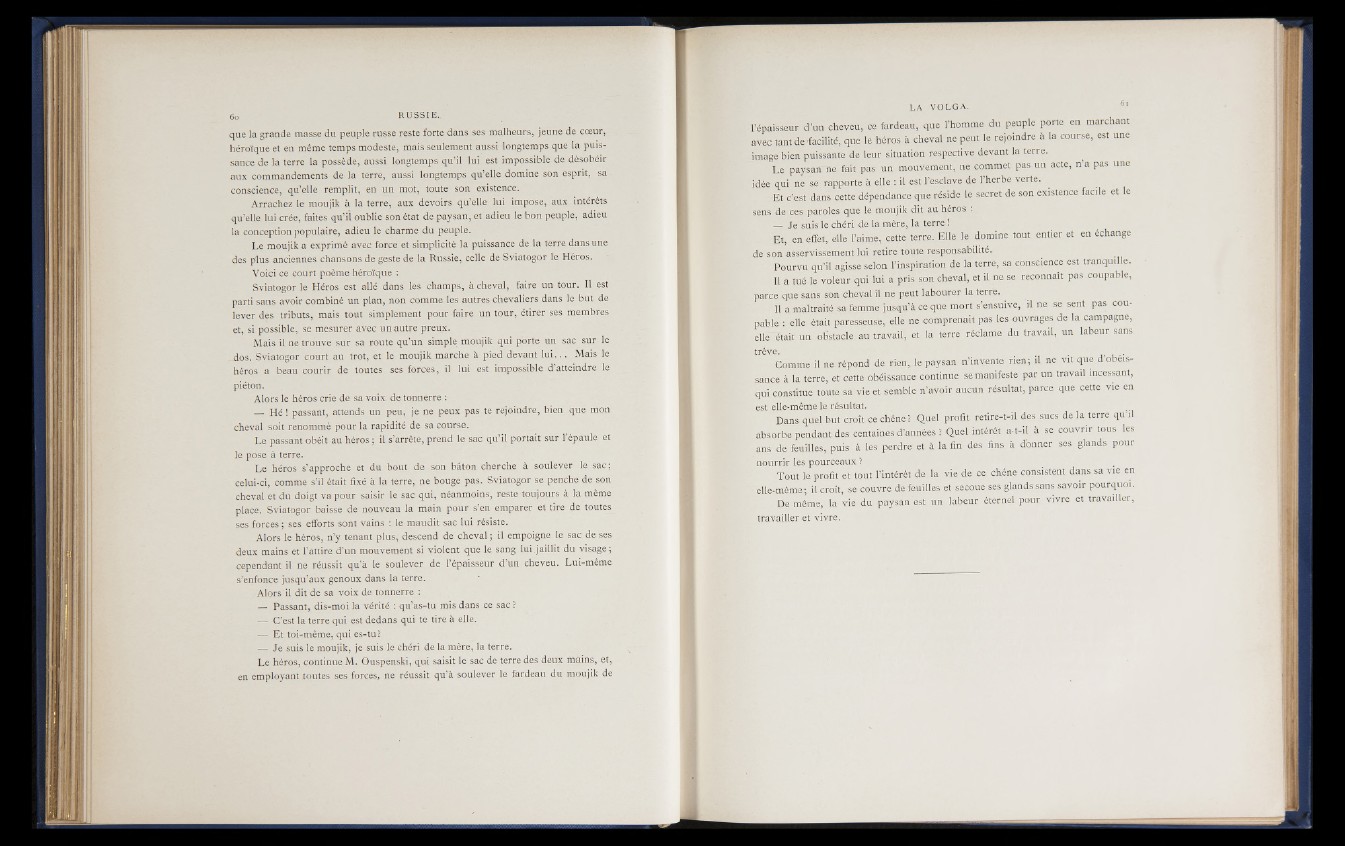
que la grande masse du peuple russe reste forte dans ses malheurs, jeune de coeur,
héroïque et en même temps modeste, mais seulement aussi longtemps que la. puissance
de la terre la possède, aussi longtemps qu’il lui est impossible de désobéir
aux commandements de- la terre, aussi longtemps, qu’elle domine son esprit, sa
conscience, qu’elle remplit, en un mot, toute son existence.
Arrachez le moujik à la terre, aux devoirs qu’elle lui impose, aux intérêts
qu’elle lui crée, faites qu’il oublie son état de paysan, et adieu le bon peuple, adieu
la conception populaire, adieu le charme du peuple.
Le moujik a exprimé avec force et simplicité la puissance de la terre dans une
des plus anciennes chansons de geste de la Russie, celle de Sviatogor le Héros.
Voici ce court poème héroïque.:,
Sviatogor le Héros est allé dans les champs, à cheval, faire un tour. Il est
parti sans avoir combiné un plan, non comme les autres chevaliers dans le but de
lever des tributs, mais tout simplement pour faire un tour, étirer ses membres
et, si possible, se mesurer avec un autre preux.
Mais il ne trouve sur sa route qu’un simple moujik qui porte un sac sur le
_jdos. Sviatogor court au trot, et le moujik marche à pied devant lu i . .. Mais le
héros a beau courir de toutes ses forces, il lui' est impossible d’atteindre le
piéton.
Alors le héros crie de sa voix de tonnerre :
— Hé ! passant, attends un peu, je ne peux pas te rejoindre, bien que mpn
. cheval soit renommé pour la rapidité de sa course.
Le passant obéit au héros ; il s’arrête, prend le sac qu’il portait sur l’épaule et
le pose à terre.
Le héros s’approche et du bout de son bâton cherche à soulever le sac ;
celui-ci, comme s’il était fixé à la terre, ne bouge pas. Sviatogor se penche de.spn
cheval et du doigt va pour saisir le sac qui, néanmoins, reste toujours à la même
place. Sviatogor baisse de nouveau la main pour s’en emparer et tire de toutes
ses forces ; ses efforts sont vains : le maudit sac lui résiste.
Alors le héros, n’y tenant plus, descend de cheval ; il empoigne. le sac de ses
deux mains et l’attire d’un mouvement si violent que le. sang îu g j j i f it du visage ;
cependant il ne réussit qu’à le soulever de l’épaisseur d’un cheveu. Lui-même
s’enfonce jusqu’aux genoux dans la terre.
Alors il dit de sa voix de. tonnerre :
— Passant, dis-moi la vérité : qu’as-tu mis dans ce sac ? .
|||i|Ë C’est la terre qui est dedans qui te tire à elle.
— Et toi-même, qui es-tu?
« y é f iJ e suis le moujik, je suis le chéri de la mère, la terre.
Le héros, continue M. Ouspenski, qui saisit le sac de terre des deux mains, et,
en employant toutes ses forces, ne réussit qu’à soulever le fardeau du moujik de
l’épaisseur d’un cheveu, ce fardeau, que l’homme du peuple porte en marchant
avec tant de facilité, que le héros à cheval ne peut le rejoindre à la course, est une
image bien puissante de leur situation respective devant la terre.
Le paysanTîe fait pas un mouvement, ne commet pas un acte, n’a pas une
idée qui ne se rapporte à elle : il est l’esclave de l’herbe verte.
Et c’est dans cette dépendance que réside le secret de son existence facile et le
sens de ces paroles que le moujik dit au héros .:,
— Je suis le chéri de la mère, la terre !
Et, en effet, elle l’aime, cette terre. Elle le domine tout entier et en échange
de son asservissement lui retire toute responsabilité.
Pourvu qu’il agisse selon l’inspiration de la terre, sa conscience est tranquille.
Il a tué le voleur qui lui a pris sS-cheval, et il ne se reconnaît pas coupable,
parce que sans son cheval il ne peut labourer la terre.
Il a maltraité sa femme jusqu’à ce que mort s’ensuive, il ne se sent pas coupable
: elle était paresseuse, elle ne comprenait pas les ouvrages de la campagne,
elle était un obstacle au travail, et la terre réclame du travail, un labeur sans
trêve.C
omme il ne répond de tiçn,..le paysan n’invente rien; il ne vit que d obéissance
à la terre, et cette obéissance continue se manifeste par un travail incessant,
quiifnstitue toute sa vie et semble n’avoir aüçjin résultat, parce que cette vie en
est elle-même le résultat.
Dans quel but croît,çéchêne? Quel profit retire-t-il des sucs d e là terre qu’il
a b s o r b e pendant des centaines d’année!..?; Quel intérêt a-t-il à se couvrir tous les
ans: À& feuilles, puis:, à les perdre et à la fin des ûa£ à donner ses glands pour
nourrir les pourceaux ?
Tout le profit et tout l’intérêt de la vie de ce chêne .consistent dans sa vie en
elle-même; il croît, sè couvre de feuilles et secoue ses glands sans savoir pourquoi,
De même, la vie du paysan est un labeur: éternel pour vivre et travailler,
travailler et vivre.