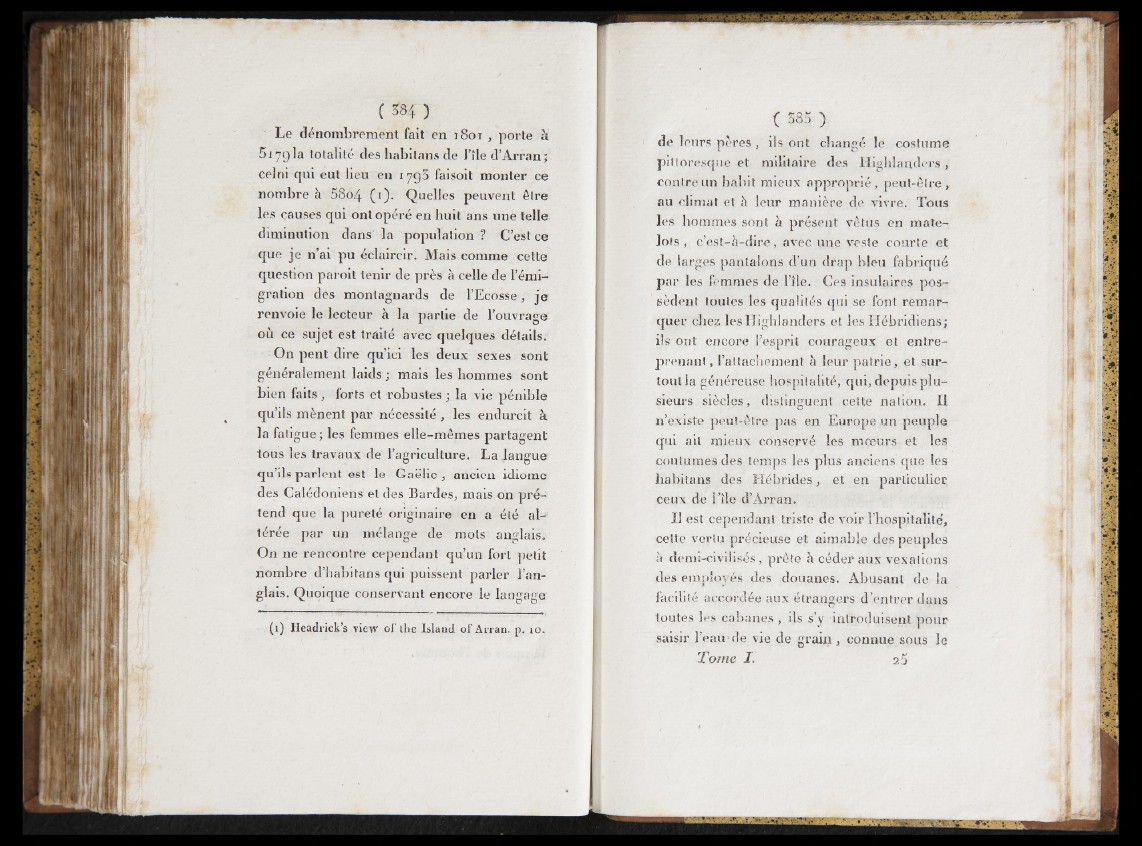
Le dénombrement fait en i8or , porte à
Siygla totalité des habitans de l’île d’Arran;
Celni qui eut lieu en 1793 faisoit monter ce
nombre à 58o4 (1). Quelles peuvent être
les causes qui ont opéré en huit ans une telle,
diminution dans la population ? C’est ce
que je n’ai pu éclaircir. Mais comme cette
question paroit tenir de près à celle de l’émi-
gration des montagnards de l’Ecosse, je
renvoie le lecteur à la partie de l’ouvrage
où ce sujet est traité avec quelques détails.
On pent dire qu’ici les deux sexes sont
généralement laids ; mais les hommes sont
bien faits , forts et robustes ; la vie pénible
qu’ils mènent par nécessité, les endurcit à
la fatigue; les femmes elle-mêmes partagent
tous les travaux de l’agriculture. La langue
qu’ds parlent est le Gaëlic , ancien idiome
des Calédoniens et des Bardes, mais on prétend
que la pureté originaire en a été altérée
par un mélange de mots anglais.
On ne rencontre cependant qu’un fort petit
nombre d’habitans qui puissent parler l’anglais.
Quoique conservant encore le langage
(1) Headrick’s view o f the Island o f A rran, p. 10.
de leurs pères, ils ont changé le costume
pittoresque et militaire des Iiighlanders,
contre un habit mieux approprié, peut-être ,
au climat et à leur manière de vivre. Tous
les hommes sont à présent vêtus en matelots
, c’est-à-dire, avec une veste courte et
de larges pantalons d’un drap bleu fabriqué
par les femmes de l’île. Ces insulaires possèdent
toutes les qualités qui se font remarquer
chez lesHighlanders et les Hébridiens;
ils ont encore l’esprit courageux et entreprenant,
rattachement à leur patrie, et sur-
toulla généreuse hospitalité, qui, depuis plusieurs
siècles, distinguent cette nation. Il
n’existe peut-être pas en Europe un peuple
qui ait mieux conservé les moeurs et les
coutumes des temps les plus anciens que les
habitans des Hébrides, et en particulier
ceux de l ’île d’Àrran.
Il est cependant triste de voir l’hospitalité,
cette vertu précieuse et aimable des peuples
à demi-civilisés, prête à céder aux vexations
des employés des douanes. Abusant de la
facilité accordée aux étrangers d ’entrer dans
toutes les cabanes , ils s’y introduisent pour
saisir l’eau1 de vie de grain, connue sous le
Tome J. 25