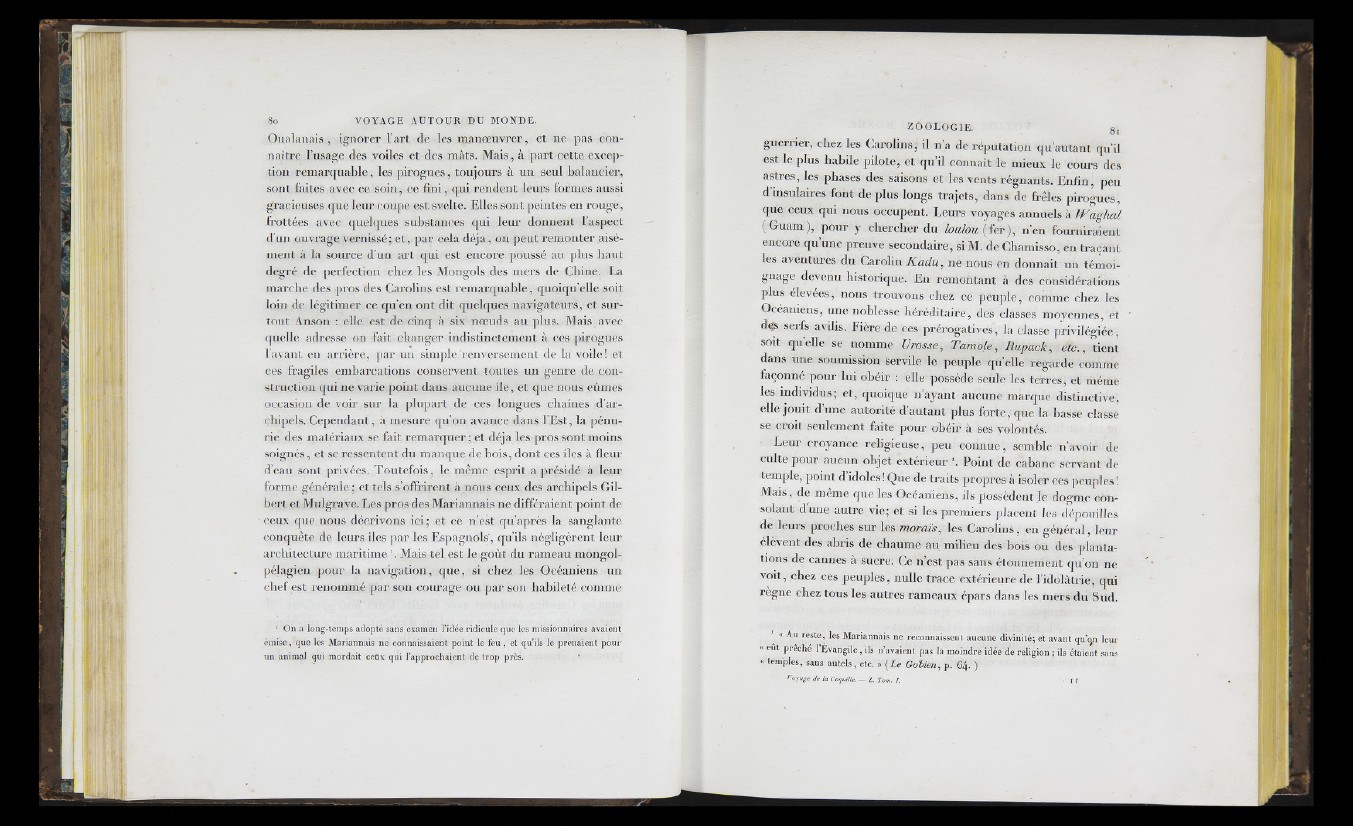
Oualaiiais , ignorer l ’art de les manoeuvrer, et ue pas connaître
l’usage des voiles et des mâts. Mais, à part cette exception
remarcyuable, les pirogues, toujours à un seul balancier,
sont faites avec ce soin, ce fini, qui rendent leurs formes aussi
gracieuses que leur coupe est svelte. Elles sont peintes en ronge,
frottées avec (yuelques substances qui leur donnent l’aspect
d’un ouvrage vernissé; et, par cela déjà, on peut remonter aisément
il la source d’un art qui est encore poussé au plus haut
degré de perfection chez les Mongols des mers de Chine. La
marche des pros des Carolins est remarquable, quoiqu’elle soit
loin de légitimer ce qu’en ont dit quelques navigateurs, et surtout
Anson : elle est de cinq à six noeuds au yilus. Mais avec
quelle adresse on fait changer indistinctement à ces pirogues
lavant en arrière, par un simple renversement de la voile! et
ces fragiles embarcations conservent toutes un genre de construction
qui ne varie point dans aucune île, et que nous eûmes
occasion de voir sur la yilupart de ces longues chaînes d’archipels.
Cependant, à mesure qu’on avance dans l’Est, la pénurie
des matériaux se fait remarquer; et déjà les pros sont moins
soignés, et se ressentent du manque de bois, dont ces îles à fleur
d’eau sont [irivées. Toutefois, le même esprit a présidé à leur
lorme générale;.et tels s’offrirent à nous ceux des archipels Gilbert
et Mulgrave. Les pros des Mariannais ne différaient point de
ceux que nous décrivons ici ; et ce n’est ((u’après la sanglante
conquête de leurs îles par les Espagnols', cyu’ils négligèrent leur
architecture maritime '. Mais tel est le goût du rameau mongol-
pélagien pour la navigation, qu e , si chez les Océaniens un
chef est renommé par son courage ou par son habileté (;omme
‘ On a long-temps adopté sans examen l’idée ridicule que les missionnaires avaient
émise, que les Mariannais ne connaissaient point le fe u , et qu’ils le prenaient pour
un animal qui mordait ceox qui l’approchaient d e fro p près.
guerrier, chez les Carolins, il n’a de réputation qu’autant (pi’il
est le plus habile pilote, et qu il connaît le mieux le cours des
astres, les phases des saisons et les vents régnants. Enfin, peu
d’msulaires font de plus longs trajets, dans de frêles pirogues,
que ceux qui nous occupent. Leurs voyages annuels à IVaghal
(Guam), pour y chercher du loulou f e v ) , n’en fourniraient
encore qu’une preuve secondaire, siM. de Chamisso, en traçant
les aventures du Carolin Kadu, ne nous en donnait uu témoignage
devenu historique. En remontant à des considérations
plus élevées, nous trouvons chez ce peuple, comme chez les
Océaniens, une noblesse héréditaire, des classes moyennes, et
des serfs avdis. Fière de ces prérogatives, la classe privilégiée,
soit qu’elle se nomme Urosse, Tamole, Rupack, etc., tient
dans une soumission servile le peuple qu’elle regarde comme
façonné pour lui obéir ; elle possède seule les terres, et même
les individus; ct, quoique n’ayant aucune marque distijictive,
elle jouit dune autorité d’autant plus forte, que la basse classe
se croit seulement faite pour obéir à ses volontés.
Leur croyance religieuse, peu comme, semble n’avoir de
culte pour aucun objet extérieur '. Point de cabane servant de
temple, point d’idoles! Que de traits propres à isoler ces peuples !
Mais, de même que les Océaniens, ils possèdent le dogrnc consolant
d’une autre vie; et si les premiers placent les déjiouilles
de leurs proches sur les moraîs, les Carolins, en général, leur
élèvent des abris de chaume au milieu des bois ou des plantations
de cannes à sucre. Ce n’est pas sans étonnement qu’on ne
voit, chez ces peuples, nulle trace extérieure de l’idolâtrie, qui
règne chez tous les autres rameaux épars dans les mers du Sud.
« Au reste, les Mariannais ne reconnaissent aucune divinité; et avant qu’qn leur
« eut prêché l’É v an g ile, ils n’avaient pas la moindre idée de religion ; ils étaient sans
« temples, sans autels, etc. » { L e Gob ien, p. 64. )
Foyoge de la Coquille. — Z. Tom. !. I I