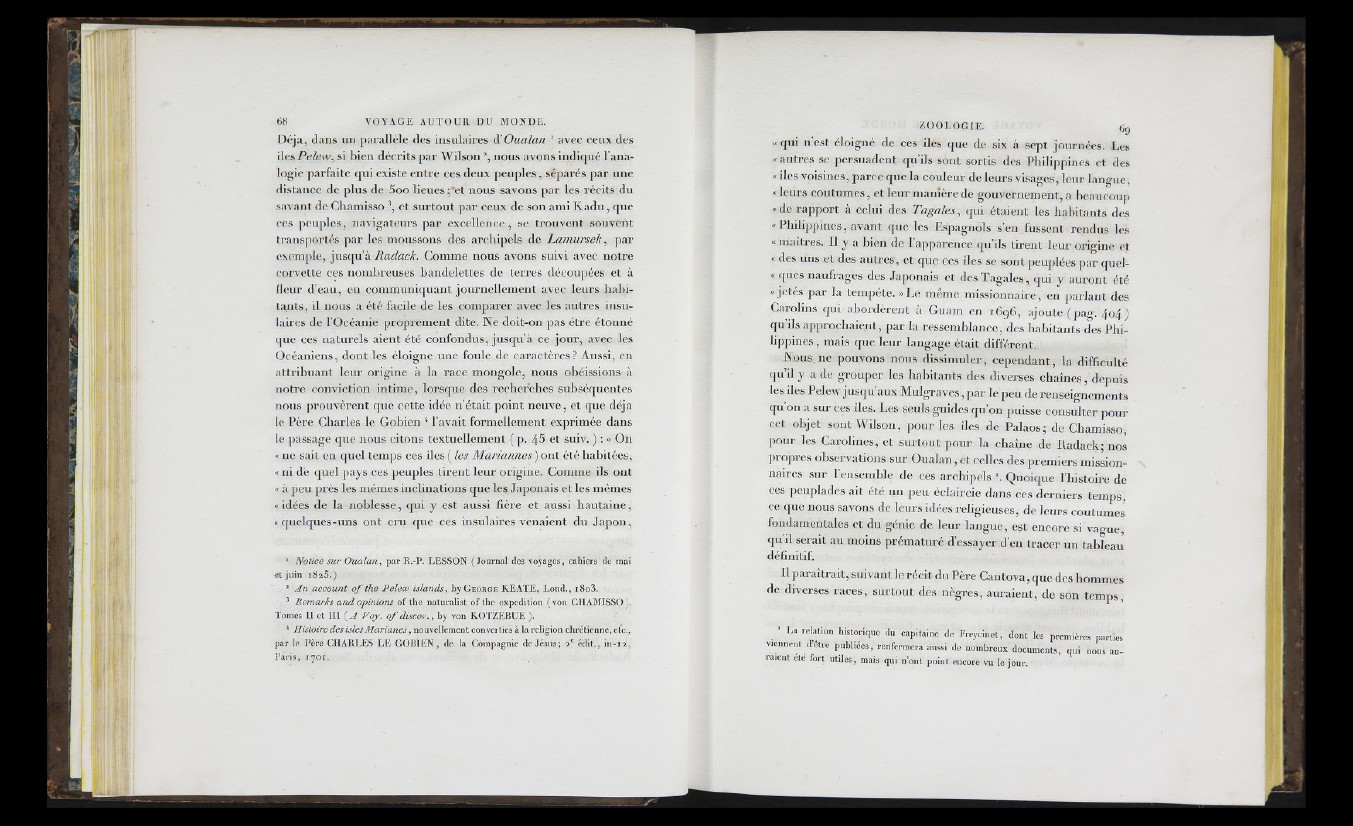
Déjà, dans un parallèle des insulaires diOualan ' avec ceux des
'des Pelew, si bien décrits par Wilson ”, nous avons indiqué l’analogie
]iarfaitc t|ui existe entre ces deux peuples, séparés par une
distance de plus de 5oo lieues; et nous savons par les récits du
sax ant de Chamisso et surtout par ceux de son ami K a d u , que
ces peuples, navigateurs par excellence, se trouvent souvent
transportés par les moussons des archipels de Lamursek, par
exemple, jusqu’à Radack. Coimue nous avons suivi avec notre
corvette ces nombreuses bandelettes de terres découpées et à
fleur d’eau, en communiquant journellement avec leurs habitants,
il nous a été facile de les comparer avec les autres insulaires
de l’Océanie proprement dite. Ne doit-on pas être étonné
(|ue ces naturels aient été confondus, jusqu’à ce jour, avec les
Océaniens, dont les éloigne une foule de caractères ? Aussi, en
attribuant leur origine à la race mongole, nous obéissions à
notre conviction intime, lorsque des recherches subséquentes
nous prouvèrent que cette idée n’était point neuve, et que déjà
le Père Charles le Gobien '* l’avait formellement exprimée dans
le passage que nous citons textuellement ( p. /|5 et suiv. ) ; « On
« ne sait en quel temps ces iles ( les Mariannes) ont été habitées,
« ni dé quel pays ces peuples tirent leur origine. Comme ils ont
« à peu près les mêmes inclinations que les Japonais et les mêmes
«idées de la noblesse, qui y est aussi fière et aussi hautaine,
«quelques-uns ont cru (jue ces insidaires venaient du Japon,
' Notice sur O u a la n , par Il.-P. LESSON (Journal des voyages, cahiers de mai
et juin 1825.)
“ A n ac coun t oJ the P elew islands, byOEOiiGE K E A T E , Lond., i 8o 3.
^ Remarks a n d opinions o f the naturalist o f the expedition (von CIIAMISSO ).
Tomes IÏ ct III { A V o j . o fd i s c o v . , by von RO TZ E BU E ).
^ Histoire des islesMarianes ,xio\xvc\\cmeni converties à la religion chrétienne, etc.,
par le Père CHARLES L E G O B IE N , de la Compagnie de Jésus; f édit., in - 12 ,
Pa ris, 1701.
« qui n’est éloigné de ces iles que de six à sept journées. Les
« autres se persuadent qu’ils sont sortis des Philippines ct des
« îles voisines, parce que la couleur de leurs visages, leur langue,
« leurs coutumes, et leur manière de gouvernement, a beaucoup
«de rapport à celui des Tagales, qui étaient les habitants des
«Philippines, avant que les Espagnols s’en fussent rendus les
« maîtres. Il y a bien de l’apparence qu’ils tirent leur origine et
« des uns et des autres, et que ces îles se sont yieuplées par quel-
« <|ucs naufrages des .Japonais ct des Tagales, qui y auront été
« jetés par la tempête. »JjC même missionnaire, en parlant des
Carolins qui abordèrent à Guam en 1G96, ajoute (pag. 404)
qu’ils approchaient, par la ressemblance, des habitants des Philippines
, mais que leur langage était différent.
Nous ne pouvons nous dissimuler, cependant, la difficulté
qu’il y a de grouper les habitants des diverses chaînes, depuis
les îles Pclew jusqu’aux Mulgraves, par le peu de renseignements
qu’on a sur ces îles. Les seuls guides qu’on puisse consulter jiour
cet objet sont Wilson, pour les iles de Palaos; de Chamisso,
pour les Carolines, et surtout pour la chaîne de Radack; nos
propres observations sur Oualan, et celles des premiers missionnaires
sur l’ensemble de ces archipels '. Quoique l’histoire de
ces peujilades ait été un peu éclaircie dans ces derniers temps,
ce que nous savons de leurs idées religieuses, de leurs coutumes’
fondamentales et du génie de leur langue, est encore si vague,
qu’il serait au moins prématuré d’essayer d’en tracer un tableau
définitif
Il paraîtrait, suivant le récit du Père Caiitova, que des hommes
de diverses races, surtout des nègres, auraient, de son temps,
■ L.1 relation historique ch, capit.iine 80 Freycinet, dont les premières parties
viennent d’ètre publiées, renfermera aussi de nombreux documents, qui nous au-
raient été fort utiles, mais qui n’ont point encore vu le jour.