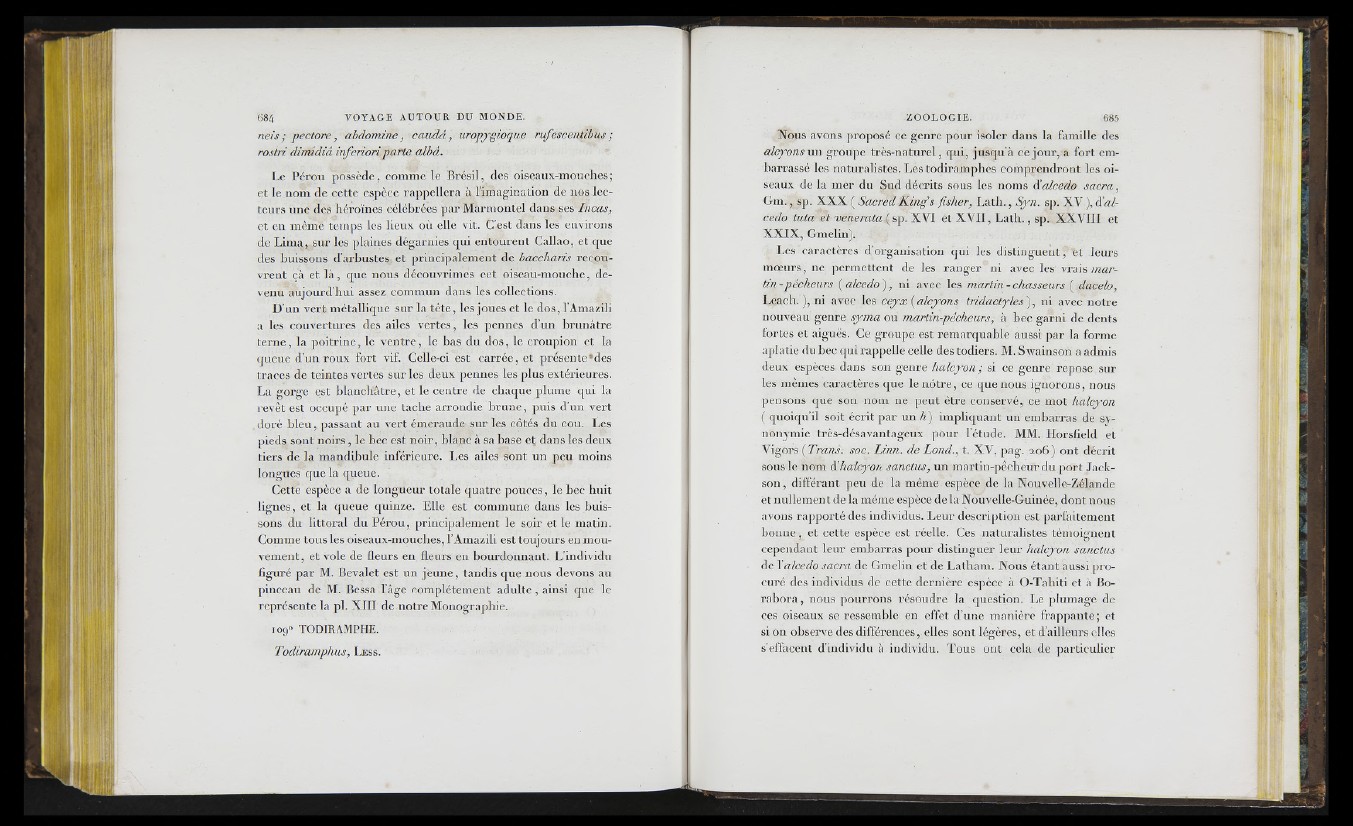
neis; pectore, abdomine, cau d â, uropygioque rufescentibus ;
rostri dimidiâ inferioriparte albâ.
Le Pérou possède, comme le Brésil, des oiscaux-mouelies;
et le uom de cette espèce rappellera à l’imagination de nos lecteurs
une des héroïnes célébrées par Marmontel dans scs Incas,
c t en mémo temps les lieux où elle vit. C ’est dans les environs
de L im a , sur les plaines dégarnies qui entourent Callao, et f[ue
des buissons d’arbustes et jirincipalement de baccharis re cou vrent
çà et là , que nous découvrîmes cet oiseau-mouche, devenu
aujourd’hui assez commun dans les collections.
D ’un v ert métallique sur la té te, les joues et le dos, l’Amazili
a les couvertures des ailes v e r te s , les jiennes d’un brunâtre
terne, la poitrine, le v en tre , le bas du dos, le croupion et la
([ueue d’nn roux fort vif. Celle-ci est ca r ré e , c t prés cnte'des
traces de teintes vertes sur les deux pennes les plus extérieures.
La gorge est b lanchâtre, et le centre de chaque plume qui la
revêt est occupé par une tache arrondie b ru n e, puis d’uu vert
doré b le u , passant au vert émeraude sur les côtés du cou. Les
jjieds sont n o ir s , le bec est n oir, blanc â sa base c t dans les deux
tiers de la mandibule inférieure. Les ailes sont un peu moins
longues que la cjiicue.
Cette espèce a de longueur totale quatre pouces, le bec huit
ligne s, et la queue quinze. Elle est commune dans les buissons
du littoral du Pérou, principalement le soir et le matin.
Comme tous les oiseaux-mouches, f Amazili est toujours eu mouvement,
et vole de fleurs eu fleurs en bourdonnant. L ’individu
figuré par M. Bcvalet est un jeu n e , tandis que nous devons au
pinceau de M. Bessa fâ g e complètement adulte , ainsi que le
représente la pl. XIII de notre Monographie.
109» TODIRAMPH E .
Todiramphus, I æ s s .
N o u s avons proposé ce genre pour isoler dans la famille des
alcyons \m groupe très-naturel, qui, ju sq u ’à ce jou r , a fort embarrassé
les naturalistes. Les todiramphes comprendront les oiseaux
de la mer du Sud décrits sous les noms Salcedo sacra,
G m ., sp. X X X ( Sacred King's fisher, L a th ,, Syn. sj>. X V ), S a lcedo
tuta et venerata (sp. X V I et X V I I , L a th ., sp. X X V I I I et
X X IX , Gmelin).
Les caractères d’organisation qui les distin gu ent, et leurs
moeurs, ne permettent de les ran ger ni avec les yva\s martin
pêcheurs [a lc e d o ) , ni avec les martin-chasseurs ( dacelo,
Leach. ), ni avec les ceyx [ alcyons tridactyles), ni avec notre
nouveau genre syrna ou martin-pécheurs, à bec garni de dents
fortes et aiguës. Cc groupe est remarquable aussi par la forme
aplatie du bec (jui rappelle celle des todiers. M. Swainson a admis
deux espèces dans son genre halcyon ; si ce genre repose sur
les mêmes caractères que le nôtre, ce (jue nous ign o ro n s , nous
jiensons que son nom ne peut être conservé, ce mot halcyon
[ (juoiqu’il soit écrit par un/*) impli(juaiit un embarras de synonymie
très-désavantageux pour l’étude. MM. Horsheld et
Vigors [Trans. soc. Linn. de Lond., t. X V , pag. 206) ont décrit
sous le nom S halcyon sanctus, un martin-pêcheur du port Jackson
, différant jieu de la même espèce de la Nouvelle-Zélande
et nullement de la même espèce de la N ouvelle-Guinée, dont nous
avons rapporté des individus. Iteur dcscrijition est parfaitement
b o n n e , et cette espèce est réelle. Ces naturalistes tcmoiguent
cependant leur embarras pour distinguer leur halcyon sanctus
de Xalcedo sacra de Gmelin et de Latham. Nous étant aussi jiro-
curé des individus de cette dernière espèce à O-Tahitl et à Bo-
ra h o ra , nous jtourrons résoudre la question. Le jdumage de
ces oiseaux se ressemble en effet d’une manière frap|)ante; et
si on observe des différences, elles sont légères, et d’a illeurs elles
s’effacent d’individu à individu. Tous ont cela de jiarticulier