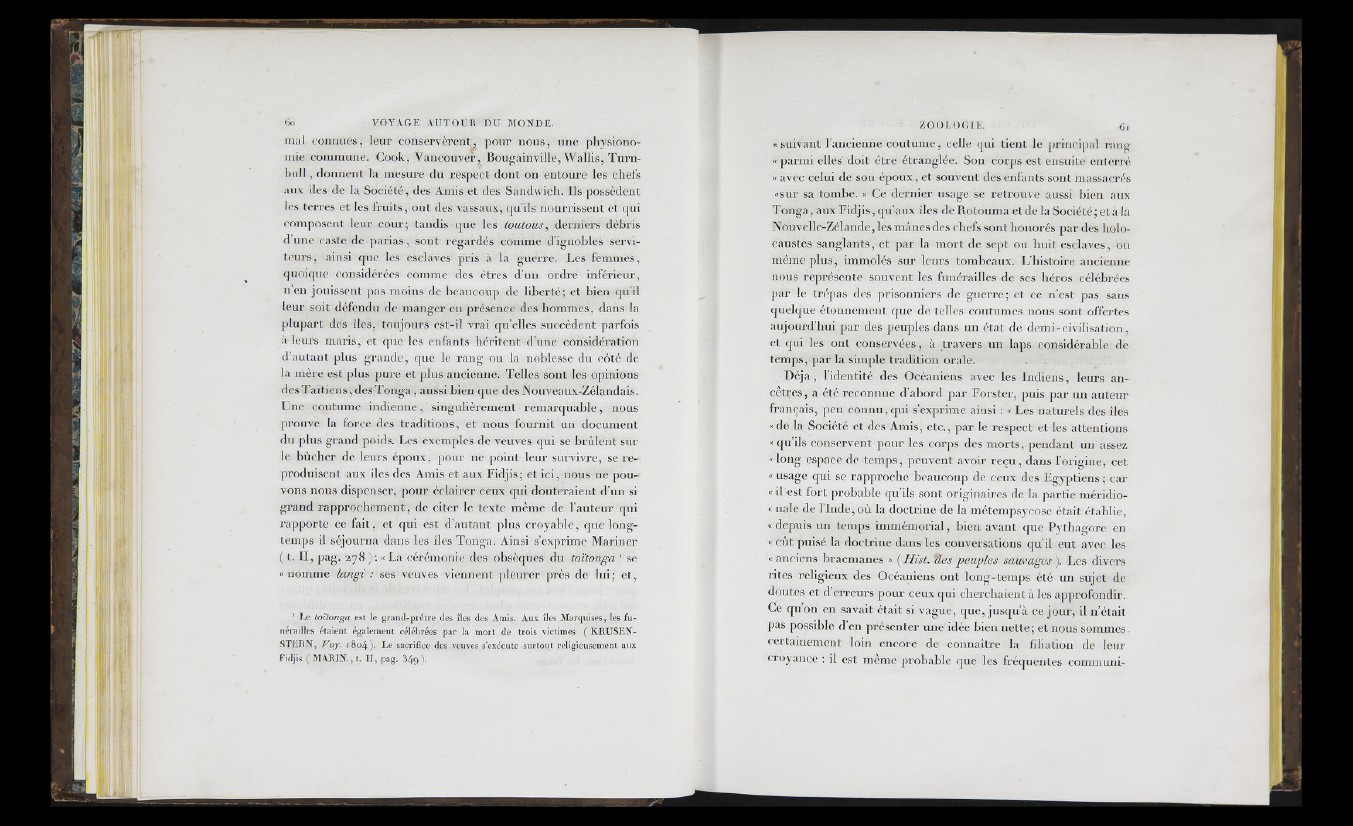
mal conimcs, leur conservèrent, pour nous, une physionomie
commune. Cook, Vancouver, Bougainville, Wallis, Turn-
bull , donnent la mesure du res]>ect dont on entoure les chefs
aux iles de la Société, des Amis et des Sandwich. Ils possèdent
les terres et les fruits, ont des vassaux, qu’ils nourrissent et qui
composent leur cour; tandis que les toutous, derniers débris
d’ime caste de parias, sont regardés comme d’iguobles serviteurs,
ainsi que les esclaves pris à la guerre. Les femmes,
(pioique considérées comme des êtres d’uu ordre inférieur,
n’en jouissent pas moins de beaucoup de liberté; et bieu qu’il
leur soit défendu de manger eu présence des hommes, dans la
plu]iart des lies, toujours est-il vrai qu’elles succèdent parfois
à leurs maris, et que les enfants héritent d’une considération
d’autant plus grande, que le rang ou la noblesse du côté de
la mère est plus jjure et plus ancienne. Telles sont les opinions
des Taïtiens, des Tonga , aus.si bien que des Nouvcaux-Zélandais.
Une coutume indienne, singulièrement remarquable , nous
prouve la force des traditions, et nous fournit un document
du plus graud poids. Les exemples de veuves qui se brûlent sur
le bûcher de leurs époux, pour ne point leur survivre, se reproduisent
aux iles des Amis et aux Fidjis; et ici, nous ne pouvons
nous dispenser, pour éclairer ceux qui douteraient d’un si
grand rapprochement, de citer le texte même de l ’auteur qui
rapporte ce fait, et qui est d’autant plus croyable, que longtemps
il séjourna dans les iles Tonga. Ainsi s’exprime Mariner
( t. II, pag. 278 ) ■. « La cérémonie des obsèques du toïtonga ‘ se
«nomme langi : ses veuves viennent pleurer près de lui; et,
* Le toïtonga est le grand-prètre des îles des .Amis. Aux îles Marquises, les funérailles
étaient également célébrées par la mort de trois victimes ( KRUSF.N-
S T E RN , Voy. 1804 )■ Le sacrifice des veuves s’exécute surtout religieusement aux
Fidjis (M A R IN - , t. I I , pag. 349).
«suivant rancicniie coutume, celle qui tient le principal rting
« [jarmi elles doit être étranglée. Son corjis est ensuite enterré
« avec celui de son époux, et souvent des enfants sont massacrés
«sur sa tombe. » Ce dernier usage se retrouve aussi bien aux
Tonga, aux Fidjis, qu’aux îles de Rotouma et de la Société; et à la
Nouvelle-Zélande, les mânes des chefs sont honorés par des holocaustes
sanglants, et par la mort de sept ou huit esclaves, ou
même plus, immolés sur leurs tombeaux. L ’histoire ancienne
nous représente souvent les funérailles de ses héros célébrées
par le trépas des prisonniers de guerre; et ce n’est jjas sans
quelque étormeincnt que de telles coutumes nous sont offertes
aujourd’hui par des jjerqdes dans un état de demi-civilisation,
et qui les ont conservées, à travers un laps considérable de
temps, ])ar la simple tradition orale.
D é jà , l’identité des Océaniens avec les Indiens, leurs ancêtres,
a été reconnue d’abord par Forster, puis par mi auteur
français, peu connu, qui s’exprime aiirsi ; « Les naturels des îles
« de la Société et des Amis, etc., ]iar le respect et les attentions
«qu’ils conservent pour les corps des morts, pendant un assez
«long espace de temps, peuvent avoir reçu, dans l’origine, cet
« usage qui se rapproche beaucoup de ceux des Égyptiens ; car
« il est fort [irobable (jii’ils sont originaires de la jiartie méridio-
« nalc de fInde,où la doctrine de la métempsycose était établie,
«depuis un temps immémorial, bien avant <jue Pytliagore en
« eût puisé la doctrine dans les conversations f[u’il eut avec les
«anciens bracmanes » [Hist. des peuples sauvages). Les divers
rites religieux des Océaniens ont long-temps été un sujet de
doutes et d’erreurs pour ceux qui cherchaient aies approfondir.
Ce quou en savait était si vague, que, jusqu’à ce jour, il n’était
pas possible d’en présenter une idée bien nette; et nous sommes.
certainement loin encore de connaître la filiation de leur
croyance : il est même [îrohable (pie les fréquentes commuui