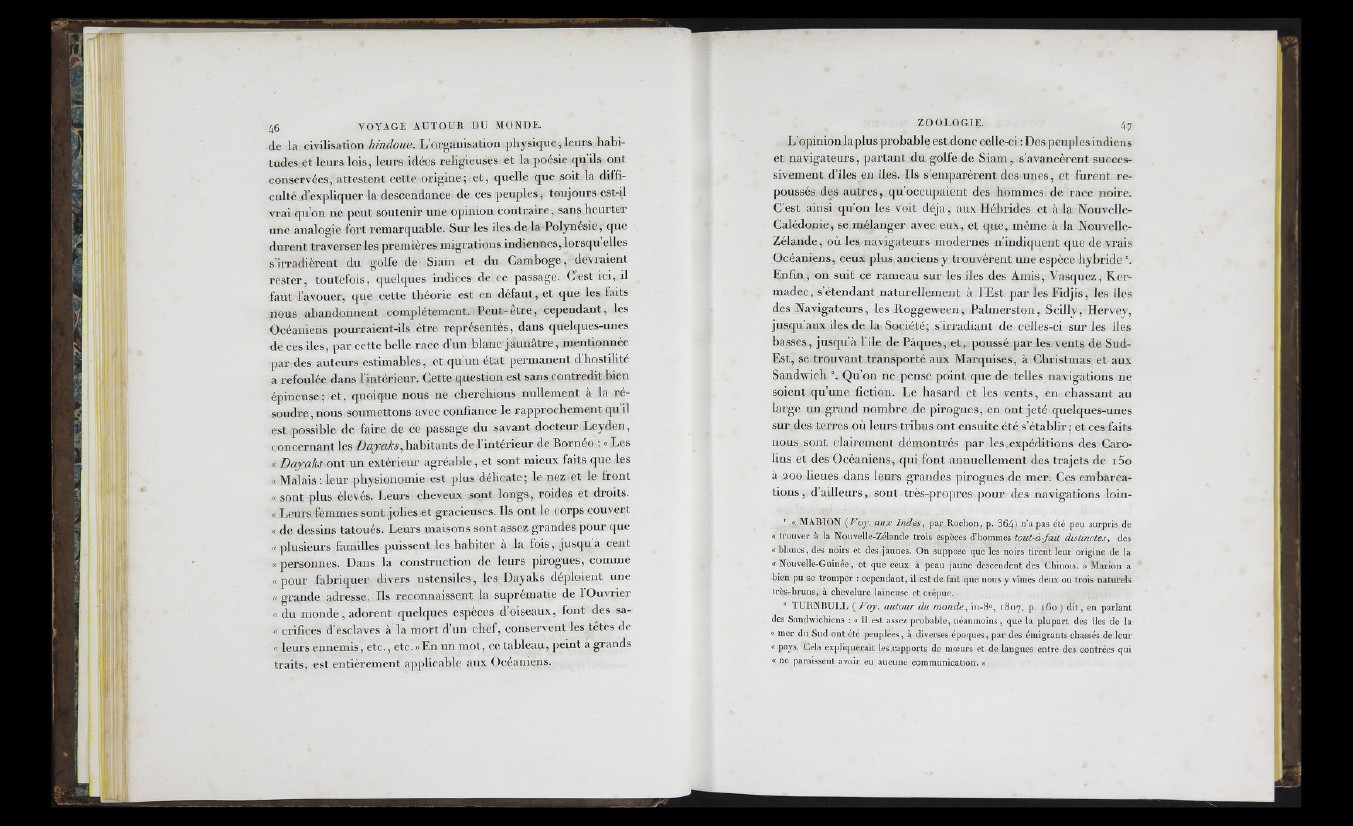
de la civilisation hindoue. L ’organisation jihysique, leurs habitudes
et leurs lois, leurs idées religieuses et la poésie quils ont
conservées, attestent cette origine; e t, quelle que soit la difficulté
d’expliquer la descendance de ces peuples, toujours est-il
vrai qu’on ne peut soutenir une opinion contraire, sans heurter
une analogie fort remarquable. Sur les îles de la Polynésie, que
durent traverser les premières migrations indiennes, lorsqii elles
s’irradièrent du golfe de Siam et du Camboge, devraient
rester, toutefois, quelques indices de ce passage. C est ici, il
faut l’avouer, que cette théorie est en défaut, et que les faits
nous abandonnent complètement. Peut-etre, cependant, les
Océaniens pourraient-ils être représentés, dans quelques-unes
de ces lies, par cette belle race d’un blanc jaunâtre, mentionnée
par des auteurs estimables, et qu’un état permanent d’hostilité
a refoulée dans l’intérieur. Cette question est sans contredit bien
épineuse; et, quoique nous ne cherchions nullement à la résoudre,
nous soumettons avec confiance le rapprochement qu’il
est possible de faire de ce passage du savant docteur Leyden,
concernant les D a y a fc , habitants de l’intérieur de Bornéo ; « Les
« Dayaks ont un extérieur agréable, et sont mieux faits que les
« Malais ; leur physionomie est plus délicate; le nez et le front
« sont plus élevés. I.eurs cheveux sont longs, roides et droits.
« Leurs femmes sont jolies et gracieuses. Ils ont le corps couvert
C< de dessins tatoués. Leurs maisons sont assez grandes pour que
« plusieurs familles puissent les habiter à la lois, jusqu à cent
« personnes. Dans la construction de leurs pirogues, comme
I pour fabriquer divers ustensiles, les Dayaks déploient une
<t grande adresse. Ils reconnaissent la suprématie de fOuvrier
cc du monde, adorent quelques espèces d’oiseaux, font des sa-
cc crifices d’esclaves à la mort d’un chef, conservent les tetes de
ce leurs ennemis, etc,, etc.»En un mot, ce tableau, peint à grands
traits, est entièrement applicable aux Océaniens,
L ’opinion la plus probable est donc celle-ci ; Des peujiles indiens
et navigateurs, partant du golfe de Siam, s’avancèrent successivement
d’iles en îles. Ils s’emparèrent des unes, et furent repoussés
des autres, qu’occupaient des hommes de race noire.
C’est ainsi qu’on les voit déjà, aux Hébrides et â la Nouvelle-
Calédonie, se mélanger avec eux, et que, même à la Nouvelle-
Zélande, où les navigateurs modernes n’indiquent que de vrais
Océaniens, ceux plus anciens y trouvèrent une espèce hybride *,
Enfin, on suit ce rameau sur les îles des Amis, Vasquez, Ker-
madec, s’étendant naturellement à l’Est par les Fidjis, les îles
des Navigateurs, les Roggeween, Palmerston, Scilly, Hervey,
jusqu’aux iles de la Société; s’irradiant de celles-ci sur les îles
basses, jusqu’.à l’ile de Pâques, et, poussé par les vents de Sud-
Est, se trouvant transporté aux Marquises, à Christmas et aux
Sandwich Qu’on ne pense point que de telles navigations ne
soient qu’une fiction. Le hasard et les vents, en chassant au
large uu grand nombre de pirogues, en ont jeté cpielques-unes
sur des terres où leurs tribus ont ensuite été s’établir ; et ces faits
nous sont clairement démontrés par les expéditions des Carolins
et des Océaniens, qui font annuellement des trajets de i 5o
à 200 lieues dans leurs grandes pirogues de mer. Ces embarcations
, d ailleurs, sont très-propres jiour des navigations loin-
' 'C M.A.RION { F o j . a u x In d e s , par Rochon, p. 364) n’a pas été peu surpri.s de
« trouver à la Nouvelle-Zélande trois espèces d’hommes tout-à-fait dis tin cte s , des
« blancs, des noirs ét des jaunes. On suppose que les noirs tirent leur origine de la
«Nouvelle-Guinée, et que ceux à peau jaune descendent des Chinois. » Marion a
bien pu se tromper : cependant, il est de fait que nous y vîmes deux ou trois naturels
très-bruns, à chevelure laineuse et crépue.
“ TU R N B U L L ( V oy. au tou r du m o n d e , iii-8°, 1807, p. 16 0 } d i t , en parlant
des Sandwichiens : « Il est assez probable, néanmoins, que la plupart des îles de la
« mer du Sud ont été peuplées, à diverses époques, par des émigrants chassés de leur
« pays. Cela expliquerait les rapports de moeurs et de langues entre des contrées qui
« ne paraissent avoir eu aucune communication. »