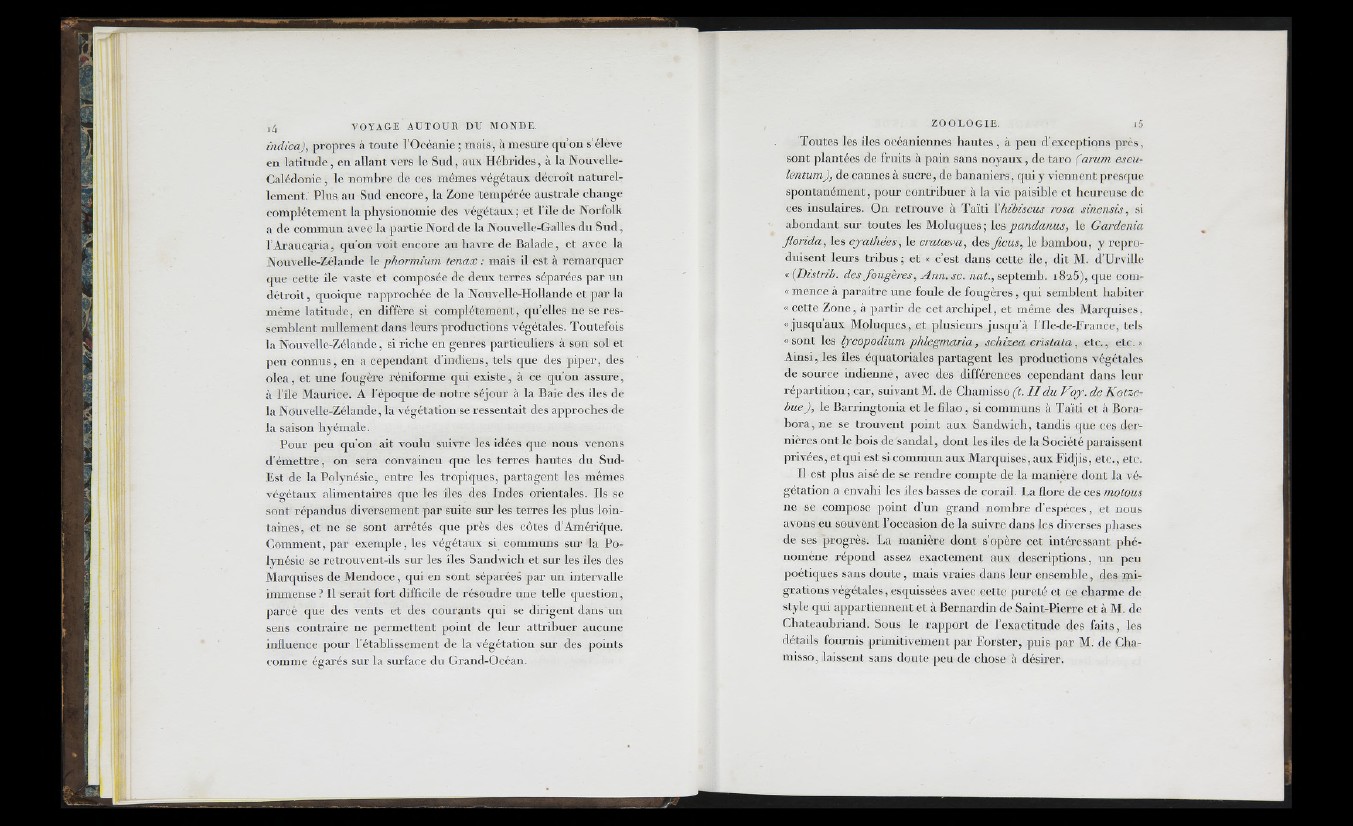
indica), propres à toute l’Océanie ; mais, à mesure qu’on s’élève
en latitude, en allant vers le Sud, aux Hébrides, à la Nouvelle-
Calédonie , le nombre de ces mêmes végétaux décroit naturellement.
Plus au Sud encore, la Zone tempérée australe change
complètement la physionomie des végétaux ; et l’ile de Norfolk
a de commun avec la partie Nord de la Nouvelle-Galles du Sud,
1 Araucaria, qu’on voit encore au havre de Balade, et avec la
Nouvelle-Zélande le phormium tenax : mais il est à remarquer
<|ue cette île vaste et composée de deux terres séparées par un
détroit, quoique rapprochée de la Nouvelle-Hollande et par la
même latitude, en diffère si complètement, qu’elles ne se ressemblent
nullement dans leurs productions végétales. Toutefois
la Nouvelle-Zélande, si riche en genres particuliers à son sol et
peu connus, en a cependant d’indiens, tels que des piper, des
olea , et une fougère réniforme qui existe, à ce qu’on assure,
à file Maurice. A l’époque de notre séjour à la Baie des iles de
la Nouvelle-Zélande, la végétation se ressentait des apjîroches de
la saison hyémale.
Pour peu qu’on ait voulu suivre les idées que nous venons
d’émettre, on sera convaincu que les terres hautes du Sud-
Est de la Polynésie, entre les tropiques, partagent les mêmes
végétaux alimentaires que les îles des Indes orientales. Ils se
sont répandus diversement par suite sur les terres les plus lointaines,
et ne se sont arrêtés que près des côtes d’Amérique.
Comment, par exemple, les végétaux si communs sur la Polynésie
se retrouvent-ils sur les îles Sandwich et sur les îles des
Marquises de Mcndoce, qui en sont séparées par un intervalle
immense? H serait fort difficile de résoudre une telle question,
|tarcé que des vents et des courants qui se dirigent dans un
sens contraire ne permettent point de leur attribuer aucune
influence pour l’établissement de la végétation sur des ]5oints
comme écarés sur la surface du Grand-Océan.
Toutes les iles océaniennes hautes, à peu d’exceptions près,
sont jflantées de fruits à pain sans noyaux, de taro (arum escu-
lentum), de cannes à sucre, de bananiers, ([ui y viennent pres([ue
spontanément, pour contribuer à la vie ]taisible et heureuse de
ces insulaires. On retrouve à Taiti l’hibiscus rosa sinensis, si
abondant sur toutes les Moluques ; les pandamis, le Gardenia
florida, les cjathées, le craloeva, des ficus, le bambou, y reproduisent
leurs tribus ; et « c’est dans cette île , dit M. d’Urville
« (Distrih. des fougères, Ann. sc. nat., septcmb. 1825), que com-
« mence à paraître une foule de fougères , qui semblent habiter
«cette Zone, à ])artir de cet archipel, et même des Marquises,
«jusqu’aux Moluques, et plusieurs jusqu’à l ’Ile-de-Erance, tels
«sont les lycopodium phlegmaria, schizea cristata, etc,, etc.»
Ainsi, les iles équatoriales partagent les productions végétales
de source indienne, avec des différences cependant dans leur
répartition ; car, suivant M. de Chamisso (t. I I du Voy. de K otzebue
) , le Barringtonia et le filao , si communs à Taiti et à Borabora,
ne se trouvent point aux Sandwich, tandis ((ue ces dernières
ont le bois de sandal, dont les îles de la Société paraissent
(trivées, et qui est si commun aux Marquises, aux Fidjis, etc., etc.
Il est plus aisé de se rendre compte de la manière dont la végétation
a envahi les îles basses de corail. La flore de ces motous
ne se compose point d’un grand nombre d’espèces, et nous
avons eu souvent l’occasion de la suivre dans les diverses phases
de ses progrès. La manière dont s’opère cet intéressant phénomène
répond assez exactement aux descriptions, un peu
poétiques sans doute, mais vraies dans leur ensemble, des migrations
végétales, esquissées avec cette pureté et ce charme de
style qui a|ipartiemient et à Bernardin de Saint-Pierre et à M. de
Chateaubriand. Sous le rapport de l’exactitude des faits, les
détails fournis primitivement par Forster, (mis par M. de Chamisso,
laissent sans doute peu de chose à désirer.