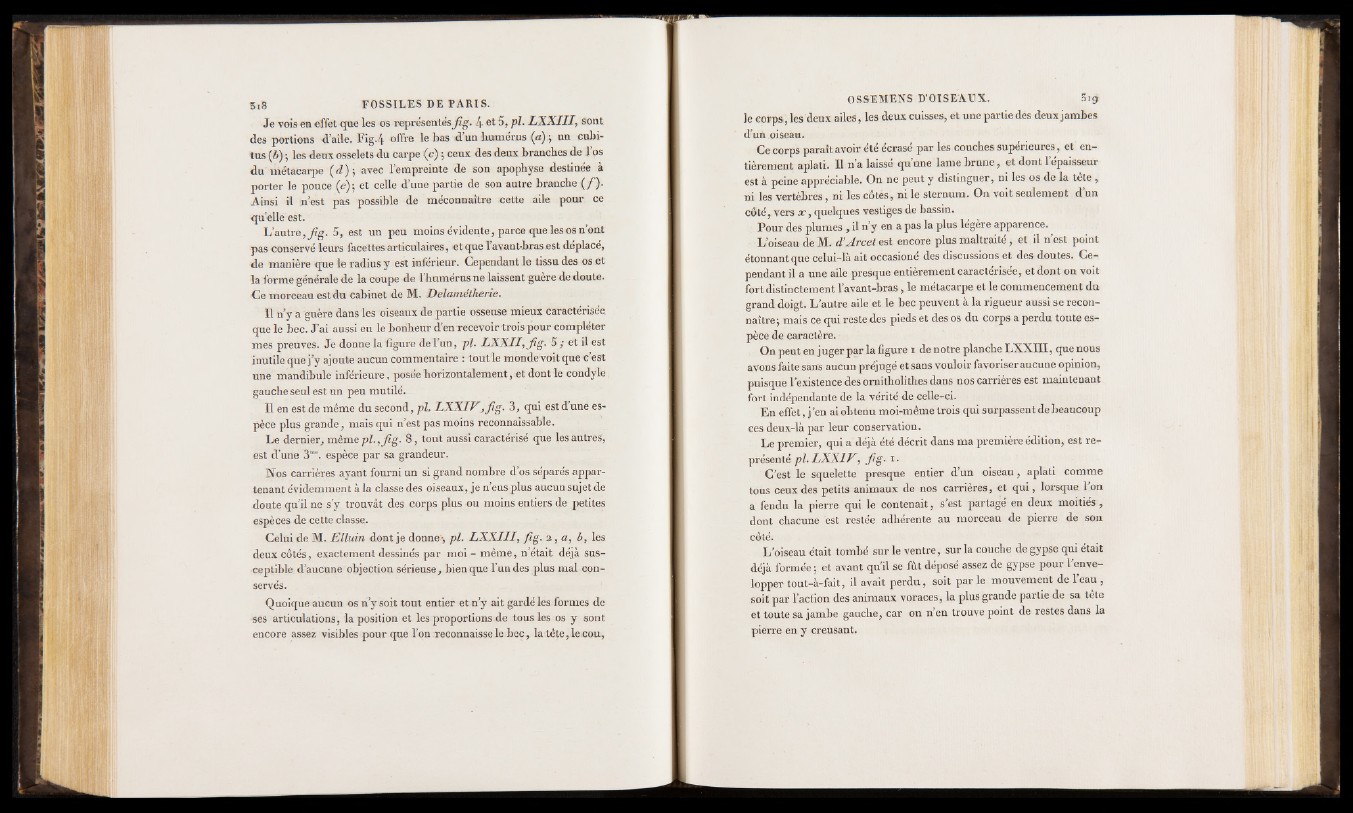
-T V i
Je vois en effet que les os représentés fig. L\ et 5, pl. LX X I I I, Sont
des portions <l aile. Fig.4 offre le bas d un humérus (a) ; un cubitus
(b) ; les deux osselets du carpe (c) ; ceux des deux branches de l ’os
du métacarpe (d ) ; avec l’empreinte de son apophyse destinée à
porter le pouce (e); et celle d’une partie de son autre branche (ƒ)•
Ainsi il n’est pas possible de méconnaître cette aile poilu' ce
quelle est.
L’autre, fig. 5, est un peu moins évidente, parce que les os n’ont
pas conservé leurs facettes articulaires, et que l’avant-bras est déplacé,
de manière que le radius y est inférieur. Cependant le tissu des os et
la forme générale de la coupe de l’humérus ne laissent guère de doute.
Ce morceau est du cabinet de M. Delainétherie.
Il n’y a guère dans les oiseaux de partie osseuse mieux caractérisée,
que le bec. J’ai aussi eu le bonheur d’en rece voir trois pour compléter
mes preuves. Je donne la figure de l’un, pl. LX X I I ,fig . 5 ; et il est
inutile que j’y ajoute aucun commentaire : tout le monde voit que c ’est
une mandibule inférieure, posée horizontalement, et dont le condyle
gauche seul est un peu mutilé.
Il en est de même du second, pl, L X X IV , f ig . 3, qui est d une espèce
plus grande, mais qui n’est pas moins reconnaissable.
Le dernier, même pl.,fig. 8, tout aussi caractérisé que les autres,
est d’une 3”'. espèce par sa grandeur,
Nos carrières ayant fourni un si grand nombre d’os séparés appartenant
évidemment à la classe des oiseaux, je n’eus plus aucun sujet de
doute qu’il ne s’y trouvât des corps plus ou moins entiers de petites
espèces de cette classe.
Celui de M. Elluin dont je donner pl. LX X I I I , fig. a , a, b, les
deux côtés, exactement dessinés par moi - même, n’était déjà susceptible
d’aucune objection sérieuse, bien que l’un des plus mal conservés.
Quoique aucun os n’y soit tout entier et n’y ait gardé les formes de
ses articulations, la position et les proportions de tous les os y sont
encore assez visibles pour que l’on reconnaisse le bec, la tête, le cou,
O S S E M E N S D’ O I S E A U X . 319:
le corps, les deux ailes, les deux cuisses, et une partie des deux jambes
(Tun oiseau.
Ce corps paraît avoir été écrasé par les couches supérieures, et entièrement
aplati. Il n a laisse quune lame brune , et dont 1 épaisseur
est à peine appréciable. On ne peut y distinguer, ni les os de la tete ,
ni les vertèbres, ni les côtes, ni le sternum. On voit seulement d un
côté, vers x , quelques vestiges de bassin.
Pour des plumes , il n’y en a pas la plus legere apparence.
L ’oiseau de M. d’Arcet est encore plus maltraité, et il n’est point
étonnant que celui-là ait occasione des discussions et des doutes. Cependant
il a une aile presque entièrement caractérisée, et dont on voit
fort distinctement l’avant-bras, le métacarpe et le commencement du
grand doigt. L’autre aile et le bec peuvent à la rigueur aussi se reconnaître
; mais ce qui reste des pieds et des os du corps a perdu toute espèce
de caractère.
On peut en j uger par la figure 1 de notre planche LX XIII, que nous
avons faite sans aucun préjugé et sans vouloir favoriser aucune opinion,
puisque l’existence des omitholithes dans nos carrières est maintenant
fort indépendante de la vérité de celle-ci.
En effet, j ’en ai obtenu moi-même trois qui surpassent de beaucoup
ces deux-là par leur conservation.
Le premier, qui a déjà été décrit dans ma première édition, est représenté
pl. L X X IV , fig. 1.
C ’est le squelette presque entier d’un oiseau, aplati comme
tous ceux des petits animaux de nos carrières, et qui, lorsque 1 on
a fendu la pierre qui le contenait, s’est partagé en deux moitiés,
dont chacune est restée adhérente au morceau de pierre de son
côté.
L ’oiseau était tombé sur le ventre, sur la couche de gypse qui était
déjà formée ; et avant qu’il se fût déposé assez de gypse pour 1 envelopper
tout-à-fait, il avait perdu, soit par le mouvement de 1 eau ,
soit par l’action des animaux voraces, la plus grande partie de sa tête
et toute sa jambe gauche, car on n’en trouve point de restes dans la
pierre en y creusant.