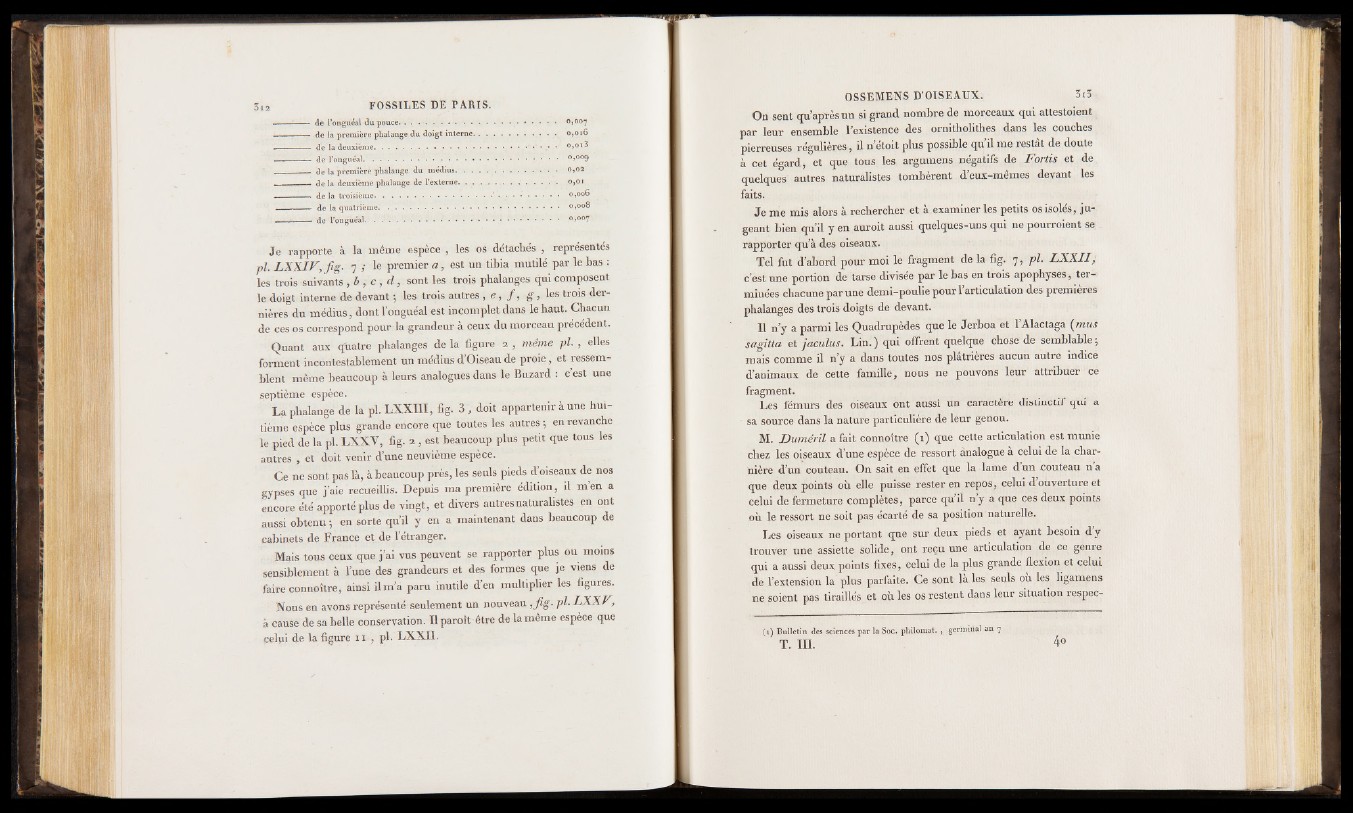
312 fossiles de pa r is .
- • de l’onguéal du pouce. ......................... ......................... ..................... 0,007
............— de la première phalange du doigt interne.................. ... 0,016
, de la deuxième. . . . .. . ...................................... ... o ,o i3
------------ de l’onguéal. . . . '. ............................................................’ •■ ••• °>009
’ - _— de la première phalange du médius..................................... 0,02
------------ de la deuxième phalange de l’externe. . ......................................... 0,01
— d,e la troisième..........................................0,006
----------- • de la quatrième. ...................................................... : ..................... 0,008
___:------ de l’onguéal. . ......................... ,0,007;
Je rapporte à la même espèce , les os détachés , représentés
ni. L X X IV , fig. 7 ; le premier a , est un tibia mutilé par le bas :
les trois suivants ,b , c , d , sont les trois phalanges qui composent
le doigt interne de devant ; les trois autres, e , ƒ , g , les trois dernières
du médius, dont l’onguéal est incomplet dans le haut. Chacun
de ces os correspond pour la grandeur à ceux du morceau précédent.
Quant aux quatre phalanges de la figure 2 , même pl. , elles
forment incontestablement un médius d’Oiseau de proie, et ressemblent
même beaucoup à leurs analogues dans le Buzard : c’est une
septième espèce.
La phalange de la pl. LXXIII, ûg. 3 , doit appartenir à une huitième
espèce plus grande encore que toutes les autres ; en revanche
le pied de la pl. LX X Y , fig. 2 , est beaucoup plus petit que tous les
autres , et doit venir d’une neuvième espèce.
Ce ne sont pas là, à beaucoup près, les seuls pieds d’oiseaux de nos
gypses que j’aie recueillis. Depuis ma première édition , il m’en a
encore été apporté plus de vingt, et divers autres naturalistes en ont
aussi obtenu ; en sorte qu’il y en a maintenant dans beaucoup de
cabinets de France et de l’étranger.
Mais tous ceux que j’ai vus peuvent se rapporter plus ou moins
sensiblement à l’une des grandeurs et des formes que je viens de
faire connoître, ainsi il m’a paru inutile d’en multiplier les figures.
Nous en avons représenté seulement un nouveau ,fig. pl- LX X V ,
à cause de sa belle conservation. Ilparoît être de la même espèce que
celui de la figure 11 , pl. LXXII.
On sent qu’aprèsun si grand nombre de morceaux qui attestoient
par leur ensemble l’existence des ornitholithes dans les couches
pierreuses régulières, il n’étoit plus possible qu’il me restât de doute
à cet égard, et que tous les argumens négatifs de Fortis et de
quelques autres naturalistes tombèrent d’eux-mêmes devant les
faits.
Je me mis alors à rechercher et à examiner les petits os isolés, jugeant
bien qu’il y en auroit aussi quelques-uns qui ne pourroient se
rapporter qu’à des oiseaux.
Tel fut d’abord pour moi le fragment de la fig. 7, pl. L X X I I y
c’est une portion de tarse divisée par le bas en trois apophyses, terminées
chacune par une demi-poulie pour 1 articulation des premières
phalanges des trois doigts de devant.
Il n’y a parmi les Quadrupèdes que le Jerboa et l’Alactaga {mus
sagitta et jaculus. Lin. ) qui offrent quelque chose de semblable,
mais comme il n’y a dans toutes nos platrieres aucun autre indice
d’animaux de cette famille, nous ne pouvons leur attribuer ce
fragment.
Les fémurs des oiseaux ont aussi un caractère distinctif qui a
sa source dans la nature particulière de leur genou.
M. Duméril a fait connoître (1) que cette articulation est munie
chez les oiseaux d’une espèce de ressort analogue a celui de la charnière
d’un couteau. On sait en effet que la lame d un couteau n a
que deux points ou elle puisse rester en repos, celui d ouverture et
celui de fermeture complètes, parce qu’il n’y a que ces deux points
oh le ressort ne soit pas écarté de sa position naturelle.
Les oiseaux ne portant que sur deux pieds et ayant besoin d y
trouver une assiette solide, ont reçu une articulation de ce genre
qui a aussi deux points fixes, celui de la plus grande flexion et celui
de l’extension la plus parfaite. Ce sont la les seuls ou les ligamens
ne soient pas tiraillés et oh les os restent dans leur situation respec-
(i) Bulletin des sciences par la Soc. philomat. , germinal an 9
t . m .