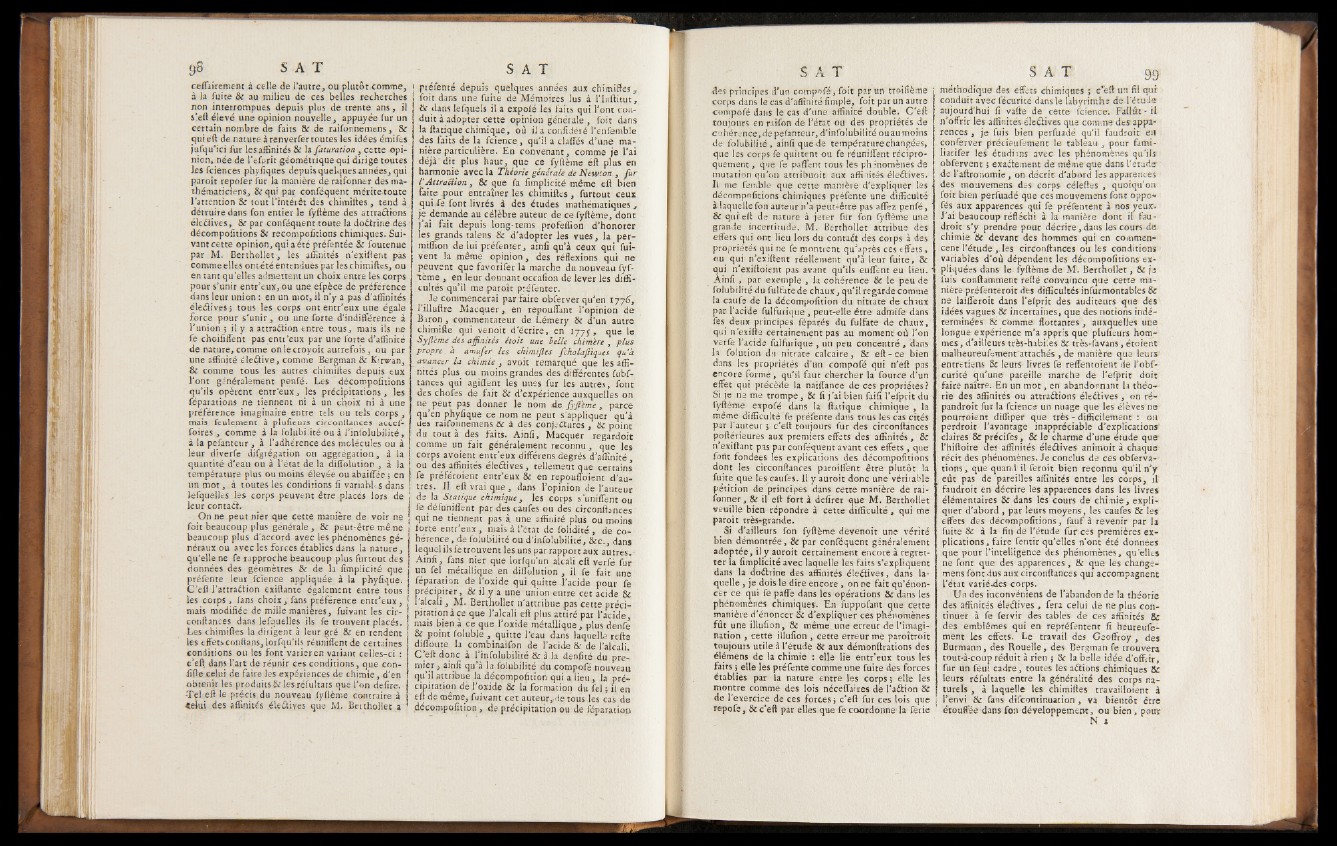
cefTairement à celle de l’autre, ou plutôt.comme,
à la fuite & au milieu de ces belles recherches
non interrompues depuis plus de trente ans, il
s’eft élevé une opinion nouvelle, appuyée fur un
certain nombre de faits & de raifonnemens, &
qui eft de nature à renverfer toutes les idées émifes
jufqu’ici fur les affinités & la faturation , cette opinion,
née de l’efprit géométrique qui dirige toutes
Jes fciences physiques depuis quelques années, qui
paroît repofer fur la manière de raifonner des mathématiciens,
& qui par conféquent mérite.toute
l'attention 8c tout l’intérêt des chimiftes, tend à
détruire dans fon entier le fyftème des attractions
électives, & par conféquent toute la doCtrine des
décompofitions & recompoiîtions chimiques. Suivant
cette opinion, qui a été préfentée & foucenue
par M. Berthollet, les affinités n’exiftent pas
comme elles ontété entendues par les chimiftes, ou
en tant quelles admettent un choix entre les corps
pour s’unir entr’eux, ou une efpèce de préférence
dans leur union : en un mot, il n’y a pas d’affinités
électives 5 tous les corps ont entr’eux une égale
force pour s’unir, ou une forte d’indifférence à
l’ union ; il y a attraction entre tous, mais ils ne
fe choififlent pas entr’eux par une forte d’affinité
de nature,comme onlecroyoic autrefois, ou par
une affinité éleÇiive, comme Bergman & Kirwan,
& comme tous les autres chimiftes depuis eux
l’ont généralement penfé. Les décompofitions
qu’ils opèrent entr'eux, les précipitations, les
réparations ne tiennent ni à un choix ni à une
préférence imaginaire entre tels ou tels corps ,
mais feulement à plufieurs circonftances accef-
foires ;, comme à la folubiiité ou à l’infolubilité,
à la pefanteur , à l’adhérence des molécules ou à
leur diverfe difgrégation ou aggrégation, à la
quantité d’eau ou à l ’état de la diffolution , à la
température plus ou moins élevée ou abaiflee > en
un mot, à toutes les conditions fi variables dans
lefquelles les corps peuvent être placés lors de
leur contaCh
On ne peut nier que cette manière de voir ne
foit beaucoup plus générale , & peut-être même
beaucoup plus d’accord avec les phénomènes généraux
ou avec les forces établies dans la nature,
qu’elle ne fe rapproche beaucoup plus furtout des
données des géomètres & de la fîmplicité que
préfente leur fcience appliquée à la phyfique.
C ’efl l ’attrattion exiftante également entre tous
les corps, fans choix, fans préférence entr’eux,
mais modifiée de mille manières, fuivant les cir-
conftances dans lefquelles ils fe trouvent placés.
Les chimiftes la dirigent à leur gré & en rendent
les effets confians,lorfqu’ils réunifient de certaines
conditions ou les font varier en variant celles-ci :
e’efl dans l’art de réunir ces conditions, que con-
fifie..celni de faire les expériences de chimie, d’en
obtenir les produits & les réfuîtats que l’on defire.
-Tel eft le précis du nouveau fyflème contraire à
<etui des affinités électives que M. Berthollet a
préfenté depuis quelques années aux chimiftes,
foit dans une fuite de Mémoires lus à l’Inftitut,
& dans Iefqueis il a expofé les faits qui l’ont conduit
à adopter cette opinion générale , foit dans
la ftacique chimique, où il a Confidéré l’enfemble
des faits de la fcience, qu'il a claffes d’une manière
particulière. En convenant, comme je l’ai
déjà dit plus haut, que ce fyftème éft plus en
harmonie avec la Théorie générale de Newton , fur
VAttraÜion, & que fa fîmplicité même eft bien
faire .pour entraîner les chimiftes , furtout ceux
qui fe font livrés à des études mathématiques ,
je demande au célèbre auteur de ce fyftème, dont
j’ai fait depuis long-tems profeflion d^onorer
les grands talens & d’adopter les vues, la per-
miffion de lui préfenter, ainfî qu’à ceux qui fui-
vent la même opinion, des réflexions qui ne
peuvent que favorifer la marche du nouveau fyftème
, en leur donnant occafion de lever les difficultés
qu’il me paroît préfenter.
Je commencerai par faire obferver qu’en 1776,
l'illuftre Macquer, en repouffant l’opinion de
Baron, commentateur de Lémery 8c d’un autre
chimifte qui venoit d’écrire, en 177/, que le
Syflème des affinités étoit une belle chimère , plus
propre a amufer les ckimijlcs fckolajitques qu’à
avancer la chimie , avoit remarqué que les affinités
plus ou moins grandes des différentes fubf-
tances qui agiffent les unes fur les autres, font
des choies de fait & d’expérience auxquelles on
ne peut pas donner le nom .de fyfième, parce
qu’en phyfique ce nom ne peut s appliquer qu’à
des raifonnemens & à des conje&ures , & point
du tout à des faits. Ainfî, Macquer regardoit
comme un fait généralement reconnu, que les
corps avoient entr’eux différens degrés d’affinité,
ou des affinités électives, tellement que certains
fe préféroienc entr’eux & en repoufioient d’autres.
II eft vrai que, dans l’opinion de l’auteur
de la Statique chimique, Jes corps s'unifient ou
fe cléfuniffent par des caufes ou des circonftances
qui ne tiennent pas à une affinité plus ou moins
forte entr’eux, mais à l’état de foiidicé, de cohérence
, de folubiiité ou d'infoiubiiité, & c ., dans
lequel ils fe trouvent les uns par rapport aux autres.
Ainfî, fans nier que lorfqu’un alcali eft verfé fur
un fel métallique en diffolution, il fe fait une
réparation de l’oxide qui quitte l ’acide pour fe
précipiter, & il y a une union entre cet acide &
l'alcali, M. Berthollet n'attribue pas cette précipitation
à ce que l’alcali eft plus attiré par l’acide,
mais bien.à ce que l’oxide métallique, plus denfe
& point foluble , quitte l’eau dans laquelle refte
difloute la combinaifon de l’acide & de l’alcali.
C ’eft donc à l’infolubilité & à la denfité du pre-
mier 3 ainfî qu a la folubiiité du compofé nouveau
qu’il attribue la décompofition qui a iieu, la précipitation
de l’oxide & la formation du fel j il en
eft de même, fuivant cet auteur,•de tous les cas de
décompofition, de précipitation ou de réparation
-des principes d’un compofé, foit par un troifième
corps dans le cas d’affinité fimple, foit par un autre
compofé dans le cas d’une affinité double. C ’eft
toujours en raifon de l’état ou des propriéte's de
cohérence, de pefanteur, d’infoîubilité ouau moins
de folubiiité, ainfî que de température changées,
que les corps fe quittent ou fe réunifient réciproquement,
que fe partent tous les phénomènes de
mutation qu'on ateribuoit aux affinités électives.
Il me femble que cette manière d’expliquer lès
décompofitions chimiques préfente une difficulté
à laquelle fon auteur n’a peut-être pas aflez penfé, ’
& qui eft de nature à jeter fur fon fyftème une
grande incertitude. M. Berthollet attribue des
effets qui ont lieu lors du contaét des corps à des
propriétés qui ne fe montrent qu’après ces effets ,
ou qui n’exiftent réellement qu’à leur fuite, 8c
qui n’exiftoient pas avant qu’ils euflent eu lieu. “
Ainfî , par exemple , la cohérence 8c le peu de
folubiiité du fulfate de chaux, qu’ il regarde comme
la caufe de la décompofition du nitrate de chaux
par l’acide fulfurique, peut-elle être admife dans
fes deux principes féparés du fulfate de chaux,
qui n'exifte certainement pas au moment où l’on
verfe l’acide fulfurique , un peu concentré, dans
h folution du nitrate calcaire, & e ft-c e bien
dans les propriétés d’un compofé qui n’eft pas
encore formé, qu’il faut chercher la fource d'un
effet qui précède la naiffanee de ces propriétés ?
Si je ne me trompe, & fi j'ai bien faifi l’efprit du
fyftème expofé dans la ftatique chimique , la
même difficulté fe préfente dans tous les cas cités
par l’auteur v c’eft toujours fur des circonftances
poftérieures aux premiers effets des affinités, &
n’exiftant pas par conféquent avant ces effets , que
font fondées les explications des décompofitions
dont les circonftances paroiifent être plutôt la
fuite que les caufes. Il y auroit donc une véritable
pétition de principes dans cette manière de raifonner,
& il eft fort à defirer que M. Berthollet
veuille bien répondre à cette difficulté, qui rtie
paroît très-^grande.
Si d’ailleurs fon fyftème devenoit une vérité
bien démontrée, & par conféquent généralement
adoptée, il y auroit certainement encore à regretter
la fîmplicité avec laquelle les faits s’expliquent
dans la doélrine des affinités électives, dans laquelle
, je dois le dire encore , on ne fait qu’énon-
cër ce qui fe pafle dans les opérations & dans les
phénomènes chimiques. En fuppofant que cette
manière d’énoncer & d’expliquer ces phénomènes
fût une illufîon, & même une erreur de l’imagination
, cette illufîon , cette erreur me paroîtroit
toujours utile à l’étude & aux démonftrations dés
élémens de la chimie : elle lie entr’eux tous les
faits J elle les préfente comme une fuite des forces
établies par la nature entre les corps î elle les
montre comme des lois néceffaires de l’adion &
de l’exercice de ces forces} c’ eft fur ces lois que 1
repofe, 8c c’eft par elles que fe coordonne1 la férié
méthodique des effets chimiques ; c’eft un fil qui'
conduit avec fécurité dans le labyrinthe de l'étude
aujourd’hui fi vafte de cette fcience. Fallût - il
n’offrir les affinités éledives que comme des apparences
, je fuis bien perfuadé qu’il faudroit eu
conferVer précieufement le tableau , pour fami-
liarifer les étudions avec les phénomènes qu'ils
obfervent > exadement de même que dans B étude
de l’aftronomie, on décrit d’abord les apparences
des mouvemens des corps céieftes , quoiqu’on
foit bien perfuadé que ces mouvemens font oppc-
fés aux apparences qui fe préfentent à nos yeux.
J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont il fau-
droic s’y prendre pour décrire, dans les cours de
chimie 8c devant des hommes qui en commencent
l’étude,, les circonftances ou les conditions
variables d’où dépendent les décompofitions expliquées
dans le fyftème de M. Berthollet, 8c js
fuis conftamment relié convaincu que cette manière
préfenteroit dés difficultés infurmontables &
ne laifferoit dans l’efprit des auditeurs <jue des
idées vagues & incertaines, que des notions indéterminées
& comme flottantes, auxquelles une
longue expérience m’a appris que plufieurs hommes,
d'ailleurs très-habiles & très-favans, étoienc
malheureufetnent'attachés , de manière que leurs
entretiens 8c leurs livres fe reffentoient de i’obf-
curité qu’une pareille marche de l’efprit doit
faire naître. En un mot, en abandonnant h théo~
rie des affinités ou attractions électives, on ré-
pandroit fur la fcience un nuage que les élèves ne
pourroient difliper que très - difficilement : ou
perdroic l’avantage inappréciable d’explications
claires 8c précifes, & le charme d’une étude que-
l’hiftoire des affinités électives animoit à chaque
récit des phénomènes. Je conclus de ces obferva-
tions, que quand il feroit bien reconnu qu’il n’y
eût pas de pareilles affinités entre les corps, il
faudroit en décrire les apparences dans les livres
élémentaires & dans les cours de chimie, expliquer
d’abord, par leurs moyens, les caufes & les
effets des décompofitions, fauf à revenir par la
fuite & à la fin de l’étude fur ces premières explications,
faire fentir qu'elles n’ont été données
que pour l’intelligence des phénomènes, qu elles
ne font que des apparences, & que lés change-
mens font dus aux circonftances qui accompagnent
l’état varié-des corps.
Un des inconvéniens de l’abandon de la théorie
des affinités électives , fera celui de ne plus continuer
à fe fervir des tables de ces affinités &
des emblèmes qui en repréfentenc fi heureufe-
ment les effets. Le travail des Geoffroy , des
Burmann, des Rouelle, des Bergman fe trouvera
tout-à-coup réduit à rien j 8c la belle idée d'offrir,
fur un feul cadre, toutes les aéliôns chimiques 8c
leurs réfuîtats entre la généralité des corps naturels
, à laquelle les chimiftes travailloient à
j l’envi 8c fans dtfeontinuation, va bientôt être
étouffée dans fon développement, ou bien, pour
N 1