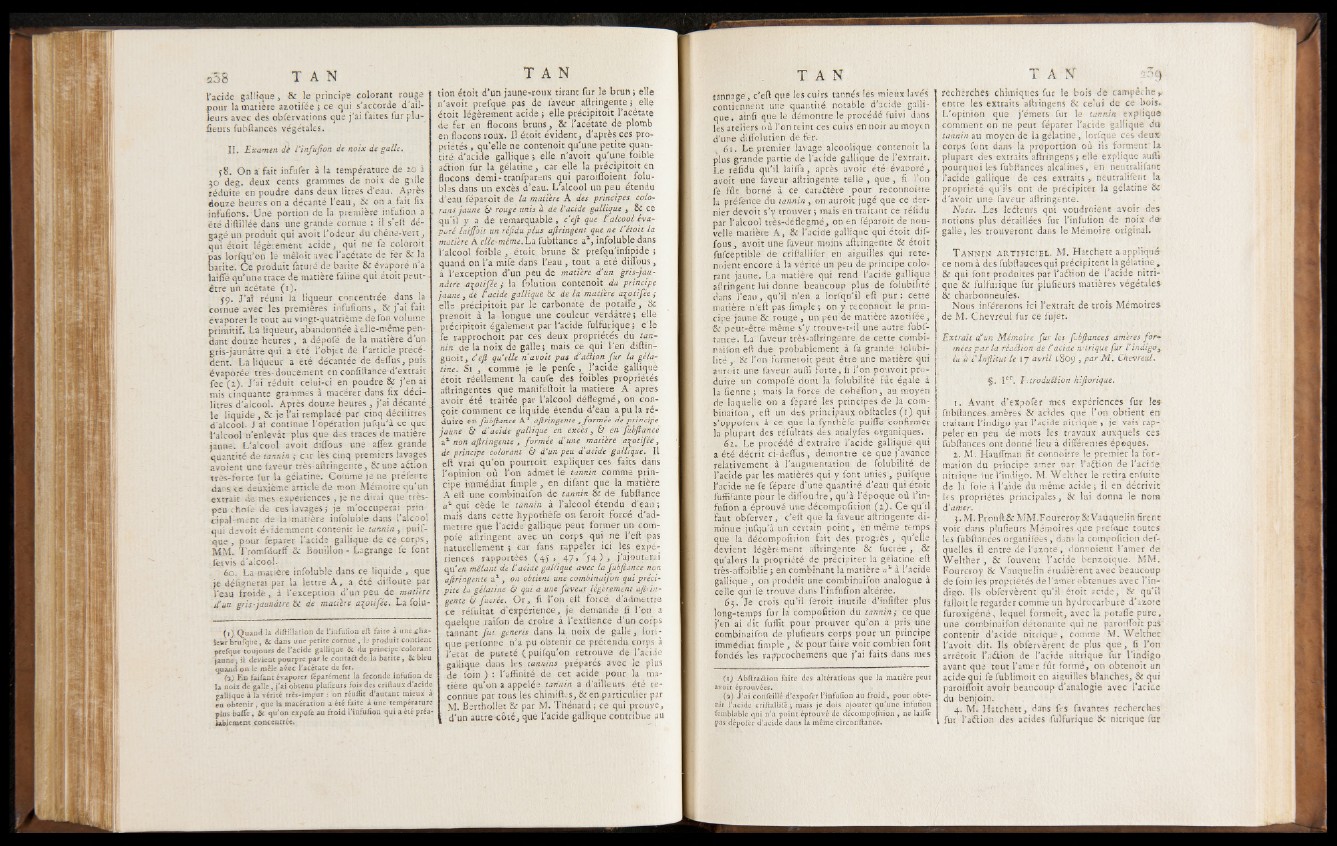
rapide gallique, & le principe colorant rouge
pour la matière azotifée $ ce qui Raccorde d’ailleurs
avec des obfervations que j'ai faites fur plu-
üeurs fubftances végétales.
II. Examen dè Pinfufion de noix de galle.
f8. On a'fait infufer à la température de 20 à
50 deg. deux cents grammes de noix de galle
réduite en poudre dans deux litres d’eau. Après
douze heures on a décanté l’eau, & on a fait fix
infufions. Une portion de la première infufion a
été diftillée dans une grande cornue : il s’eft dégagé
un produit qui avoit rôdeur du chêne-vert ,
qui étoit légèrement acide, qui ne fe coloroit.
pas lorfqu’on le mêloit avec l’acétate de fer & la
barite. Ce produit faturé de barite & évaporé n a
laide qu’une trace de matière faiine qui etoit peut*
être un acétate (î).
59. J’at réuni la liqueur concentrée dans la
cornue avec les premières infufions, & j’ai fait
évaporer le tout au vingt-quatrième defon volume
primitif. La liqueur, abandonnée à elle-même pendant
douze heures , a dépole de la matière d’un
gris-jaunâtre qui a été l’objet de l’article précédent.
La liqueur a été décantée de défiés, puis
évaporée très-doucement en confïftance d extrait
fec (2). J’ai réduit celui-ci en poudre & j’ en ai
mis cinquante grammes à macérer dans fïx décilitres
d’alcool. Après douze heures, j’ai décanté.
le liquide, & je l’ai remplacé par cinq décilitres
d’alcool. J'ai continué l’opération jufqu’ à ce que
l'alcool n’enlevât plus que des traces de matière
jaune. L’a’cool avoit diffous une affez grande
quantité de tannin ; cir les cinq premiers lavages
avoient une faveur très-aftringente, & une aétion
très-forte fur la gélatine. Comme je ne préfente
dans ce deuxième article de mon Mémoire qu’ un
extrait de mes expériences , je ne dirai que très-
peu chefs de ces lavages 5 je m’occuperai principal
r ment de la matière infoluble dans l'alcool
qui devoir évidemment contenir le tannin, puif-
q u e , pour féparer l’acide gallique de ce corps,
MM. Tromfdorff & Bouillon - Lagrange fe font
fervis d’alcool.
60. La matière infoluble dans ce liquide , que
je déiignerai par la lettre A , a été difloute par
l’eau froide, à l’exception d’un peu de matière
d‘un gris-jaunâtre & de matière azotifée. La folu-
(1) Quand la diftillauon de l’infufion eft faire à unexha-
icar brufque, & dans une petite cornue , le produit contient
prefque toujours de l’ acide gallique Ôc du principe colorant
jaune j il devient pourpre par le conta&de la ba rite, 8c bleu
qpand on le mêle avec l'acétate de fer.
(2) E n faifant évaporer féparément la fécondé infufion de
la noix de galle, j’ai obtenu plufieurs fois des criftaux d’acide
gallique à la vérité très-impur : on réulfit d’autant mieux a
en o bten ir, que la macération a été faite à une température
plus baffe, 8c qu’ on expofe au froid l'infufîon qui a étc préalablement
concentrée.
tion étoit d’un jaune-roux tirant fur le brun; elle
n'avoit prefque pas de laveur allringente ; elle
étoit légèrement acide ; elle précipitoit l’acétate
de fer en flocons bruns, & l’acétate de plomb
en flocons roux. Il étoit évident., d’après ces propriétés
, qu’elle ne contenoit qu’une petite quantité
d’acide gallique j elle n’avoit qu’une foible
aétion fur la gélatine, car elle la précipitoit en
flocons demi-tranfpareris qui paroiflbient folu-
bles dans un excès d’eau. L’alcool un peu étendu
d’eau féparoit de la matière A des principes colo-
rans jaune & rouge unis à de l’acide gallique , tk ce
qu'il y a de remarquable, c'eft que l ’alcool évaporé
laijfoit un rèfidu plus aftringent que ne l ’étoit la
matière À elle-même. La fubtfance a1, infoluble dans
l'alcool foible , étoit brune & prefqu’infipide ;
quand on l’a mife dans l’eau , tout a été diffous,
à l'exception d’un peu de matière d'un gris-jaunâtre
azotifée j la folution contenoit du principe
jaune, de l'acide gallique Oc de la matière attifée ;
elle précipitoit par le carbonate de potaffe, &
prenoit à la longue une couleur verdâtre ; elle
précipitoit également par l'acide fulfurique; e'ie
le rapprochoit par ces deux propriétés du tan-
\ nin de la noix de galle; mais ce qui l'en diftin-
! guoit, c’ eft quelle n’avoit pas d'action fur la gélatine.
Si j comme je le penfe , l’acide gallique
étoit réellement la caufe des foibles propriétés
aftringentes que manifeftoit la matière A après
avoir été traitée par l’alcool déflegmé.on conçoit
comment ce liquide étendu d’eau a pu la réduire
en fubftance A1 aftringente, formée de principe
jaune & d'acide gallique en excès, & en fubftance
a1 non aftringente , formée d’une matière azotifée,
de principe colorant & d’un peu d acide gallique. Il
ell vrai qu'on pourroit expliquer ces faits dans
l’opinion où l’on admet le tannin comme principe
immédiat Ample, en difant que la matière
A ell une combinaifon de tannin & de fubflance
ad“ qui cède le tannin à l’alcool étendu d'eau ;
mais dans cette hypothèfé on feroit forcé d’admettre
que l'acide gallique peut former un com-
pofe aflringent avec un corps qui ne l’eft pas
naturellement ; car fans rappeler ici les expériences
rapportées (45 , 4 7 ,'5 4 ) , .j’ajouterai
qu’ en mêlant dè l’acide gallique avec la fubftance non
aftringente a1 , on obtient une combinaifon qui précipice
la gélatine & qui a une faveur légèrement aft/ingrate
& fucrée. O r , fi l’on ell forcé d'admettre
ce réfultat d'expérience, je demande fi l ’on a
quelque laiton de croire à l’exitlence d’un corps
tannant fui generis dans la noix .de galle, lyrique
perforine n’ a pu obtenir ce prétendu corps à
l'etat de pureté (puifqu’on retrouve de l’acide
gallique dans les tannins préparés avec le plus
de loin ) : l’affinité de cet acide pour la matière
qu’on a appelée tannin a d'ailleurs été reconnue
par tous les chimiftes, & en particulier par
M. Berthollet & par M. Thénard ; ce qui prouve,
d’un autre côté, que l’acide gallique contribue au
tannage, c'eft que les cuirs tannés lés mieux lavés
contiennent une quantité notable d'acide gallique,
ainfï que le démontre le procédé fuivi dans
les ateliers où l’on teint ces cuirs en noir au moyt n
d'une dififolution de fer.
,v 6 1. Le premier lavage alcoolique contenoit la
plus grande partie de l'acide gallique de l’extrait.
Le réfidu qu'il lai (fa, après avoir été évaporé,.
avoit une faveur aftringente telle , que, fi l'on
fe fût borné à ce caractère pour reconnoïtre
k préfence du tannin, on auroit jugé que ce dernier
devoir s'y trouver 5 mais en traitant ce réiîdu
par l'alcool très-déflegmé, on en féparoit de nouvelle
matière A , & l'acide gallique qui étoit diffous,
avoit une faveur moins aftringente & étoit
fufceptible de criftallifer en aiguilles qui rete-
noient encore à la vérité un peu de principe colorant
jaune. La matière qui rend l'acide gallique
aftringent lui donne beaucoup plus de folubilité
dans l'eau, qu’il n'en a lorfqu'il eft pur : cette
matière n'eft pas fimple ; on y reconnon le principe
jaune & rouge , un peu de matière azotifée,
8c peut-être même s'y trouve-t-il une autre fubi-
tance. La faveur très-aftringente de cette combinaifon
eft due probablement à fa grande /olubi-
lité ,- & l’on formeroit peut être une matière qui
auroit une faveur auflï forte, fi l’on pouvoir produire
un compofé dont la folubilité fut égale à
la fienne j mais la force de cohéfion, au moyen
de laquelle on a féparé les principes de la com-
binailon , eft un des principaux obftacles (1) qui
s'oppoi’enc à ce que la fynthèfe puiffe confirmer
la plupart des réfultats des analyfes organiques.
61. Le procédé d’extraire i’acide gallique qui
a été décrit ci-deffus, démontre ce que j'avance
relativement à l’augmentation de folubilité de
l’acide par les matières qui y font unies, puifque
l'acide ne fe fépare d’une quantité d’eau qui étoit
fuffifante pour le diftoudre, qu’à l’époque où l’infufion
a éprouvé une décompofition (2). Ce qu’il
faut obferver, c'eft que la faveur aftringente diminue
jufqu’à un certain point, en même temps
que la décompofition fait des progrès, qu’elle
devient légèrement aftringente & fucrée, &
qu'alors la propriété de précipiter la gélatine eft
très-affoibüe 5 en combinant la matière av à l'acide
gallique , on produit une combinaifon analogue à
celle qui fe trouve dans l’infufion altérée.
63. Je crois qu’il feroit inutile d’infifter plus
long-temps fur la compofition du tannin ; ce que
j’en ai dit fuffit pour prouver qu’on a pris une
combinaifon de plufieurs corps pour un principe
immédiat fimple, 8c pour faire voir combien font
fondés les rapprochemens que j'ai faits dans mes
I I I Abftraûion faite des altérations que la matière peut
avoir éprouvées.
(a) J ’ai confeillé d’expofer l'infufîon au fro id , pour obtenir
l’acide criftallife ; mais je dois ajouter qu’ une infufion
femblablc qui n’ a point éprouvé de décompofition , ne laille
pas dépofer d’acide dans îa même circonftance.
recherches chimiques fur le bois de campêche y
entre les extraits aflringens & celui de ce bois.
L'opinion que j’émets fur le tannin explique
comment on ne peut féparer l'acide gallique du
tannin au moyen de la gélatine, lorfque ces deux
corps font dans la proportion où iis forment'la.
plupart des extraits aftringens j elle explique auftl
pourquoi les fubftances alcalines, en neutralifant
l'acide gallique de ces extraits,. neutralifent la
propriété qu'ils ont de précipiter la gélatine &
d’avoir une faveur aftringente.
Nota. .Les leéàeurs qui voudroient avoir des
notions plus détaillées fur i’infulïon de noix de-
galle , les trouveront dans le Mémoire original.
T annin a r t i f i c i e l . M. Hatchett a appliqué1
ce nom à des fubftasçes qui précipitent la gélatine»
& qui font produites par l'aétion de l’acide nitrique
& fulfurique fur plufieurs matières végétales
& charbonneufes.
Nous inférerons ici l'extrait de trois Mémoires
de M. Chevreul fur ce fujet.
Extrait d3un Mémoire, fur les fubftances amères formées
par la réaction de P acide nitrique fur P indigo y
lu âPlnftitut le 17 avril 1809 , par M. Chevreul.
§•. Ier. I itroduftion hiftorique.
1. Avant d’expofer mes expériences fur les
fubftances-amères & acides que l’on obtient en
traitant l'indigo par l'acide nitrique , je vais rap- '
peler en peu de mots les travaux auxquels ces
fubftances ont donné lieu à différentes époques.
2. M. HaulTman fit connoître le premier la formation
du principe amer par l’aêtion de l’acide,
nitrique fur l’indigo. M. Welther le retira enfuite
de la foie à l'aide du même acide ; il en décrivit
les propriétés principales, & lui donna le nom
d’afner.
$.M. Prouft& MM.Fcurcroy&Vauquelin firent
voir dans plufieurs Mémoires-que prefque toutes
les fubftances organifées, dans la compofition desquelles
il entre de l'azote, donnoient l'amer de
Welther, & fouvent l'acide benzoïque. MM.
Fourcroy & Vauquelin étudièrent avec beaucoup
de foin les propriétés de l'amer obtenues avec l’indigo.
Ils obfervèrent qu’il étoit acide, & qu'il
fallait le regarder comme un hydrocarbure d'azote
furoxigéné, lequel formoit, avec la potaflfe pure,
une combinaifon détonante qui ne paroi (Toit pas
contenir d’acide nitrique, comme M. Welther
l'ayoit dit. Ils obfervèrent de plus que, fi l'on
arrêtoic l'aétion de l’acide nitrique fur l ’indigo
avant que tout l’amer fût formé, on obtenoit un
acide qui fe fublimoit en aiguilles blanches, & qui
paroifloit avoir beaucoup d'analogie avec l'acicle
du benjoin.
4. M. Hstchetc, dans fes favantes recherches
fur l'a&ion des acides fulfurique & nitrique fur