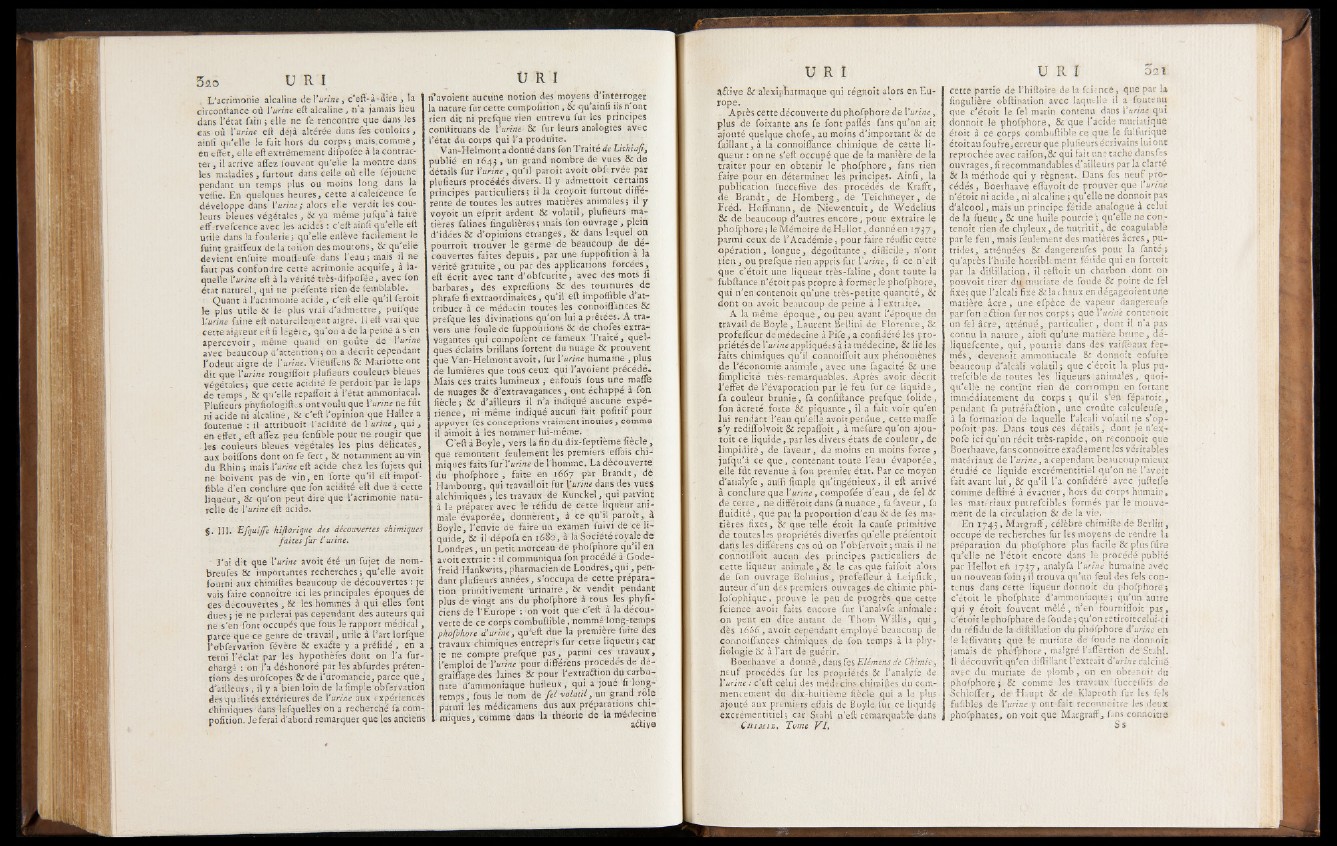
5ao U R I
, L’acrimonie alcaline der«mz*, c*eft-à-dire , la
circonttance où Y urine eft alcaline , n’a jamais lieu
dans l’état fai» ; elle ne fe rencontre que dans les
cas où Yurine eft déjà altérée dans fes couloirs,
aioli qu’elle le fait hors du corps; mais.comme,
en effet, elle eft extrêmement difpofée à la contracter,
il arrive affez fouvent qu’elle la montre dans
les maladies, furtout dans celle où elle féjourne
pendant un temps plus ou moins long dans la
veffie. En quelques heures,"cette atealefcence fe
développe dans l’urine y alors elle verdit les couleurs
bleues végétales, 8c va même jufqu’ à faire
eff-rvefcence avec les acides : c’eft ainfi qu’elle eft
utile dans la fou 1er ie; qu’elle enlève facilement le
fuint graiffeux de la toifon des moutons, 8c qu elle
devient enfuite mouffeufe dans l’eau; mais il ne
faut pas confondre cette acrimonie acquife, à laquelle
Yurine eft à la vérité très-difpofee, avec fon
état naturel, qui ne préfente rien de femblable.
; Quant à l’acrimonie acide, c’eft elle qu’il ferait
le plus utile & le plus vrai d’admettre, pu il que
Murine faine eft naturellement aigre. 11 eft vrai que
cette aigreur eft fi légère, qu’on a de la peine à s en
apercevoir, même quand on goûte dé Murine
avec beaucoup d’attention ; on a décrit cependant
l’odeur aigre de Y urine. Vieuffens 8c Mariotteont
dit que Y urine rougiffoic plufieurs couleurs bleues
végétales; que cette acidité fe perdoit 'par le laps
de temps, 8c qu’elle repaffoit à l’état ammoniacal.
Plufieurs phyfiologiftcs ont voulu que Yurine ne fût
ni acide ni alcaline, & c ’eft l’opinion que Haller a
foutenue : il attribuoit l’acidité de Y urine, qui ,
en effet, eft affez peu fenfible pour ne rougir que
les couleurs bleues végétales les plus délicates,
aux boiffons dont on fe fert, 8c notamment au vin
du Rhin ; mais Y urine eft acide chez les fujets qui
ne boivent pas de vin, en forte qu’il eftïmpof-
fible d’en conclure que fon acidité eft due à cette
liqueur, 8c qu’ on peut dire que l’acrimonie naturelle
de Yurine eft acide.
§. III. Efquijfe hiftorique des découvertes chimiques
faites fur L' urine.
• J’ai dit que Y urine avoit été lin fujet de nom-
breufes & importantes recherches ; qu’ elle avoit
fourni aux chimiftes beaucoup de découvertes : je
vais faire connoître ici les principales époques de
ces découvertes, Sc les hommes à qui elles font
dues; je ne parlerai pas cependant des auteurs qui
ne s ’en font occupés que fous le rapport médical,
parce que ce genre de-travail, utile à l’art lorfque
l’ obfervation févère & exaéte y a préfidé, en a
rerni l’éclat par les hypothèfes dont on l’a fur-
chargé : on l’a déshonoré par les abfurdes prétentions
des urofeopes & de l’ uromancie, parce que ,
d’ailleurs, il y a bien loin de la fimple obfervation
des qualités extérieures de Y urine aux expériences
chimiques dans lefquelles- on a recherché fa com-
poficion. Je ferai d’abord remarquer que les anciens
Ü R I
n’avoient aucune notion des moyens d’ interroger
la nature fur cette compofition, & qu’ainfi ils n’ont
rien dit ni prefque rien entrevu fur les principes
conftituans de Y urine 8c fur leurs analogies avec
l’état du corps qui l’a produite.
Van-Helmont a donné dans fon Traité de Lithiafi,
publié en 1643, un grand nombre de vues & de
détails fur Yurine , qu’il paroît avoit obff rvée par
plufieurs procédés divers. Il y admettoit certains
principes particuliers; il la croyoit furtout différente
de toutes les autres matières animales ; il y
voyoit un efprit ardent & volatil, plufieurs matières
falines fingulières ; mais fon ouvrage, plein
d’idées 8c d’opinions étranges, & dans lequel on
pourroit trouver le germe de beaucoup de découvertes
faites depuis, par une fuppofition a la
vérité gratuite, ou par des applications forcées,
eft écrit avec tant d’obfcurité, avec des mots fi
barbares, des expreflîons 8c des tournures de
phrafe fi extraordinaires, qu’il eft impoffible d attribuer
à ce médecin toutes les connoifiances 8c
prefque les divinations qu’on lui a prêtées. A travers
une foule de fuppoiitions 8c de chofes extravagantes
qui covnpofent ce fameux Traité, quelques
éclairs brillans fortent du nuage & prouvent
que Van-Helmont avoit, fur Y urine humaine, plus
de lumières que tous ceux qui l’avoient précédé.
Mais ces traits lumineux , enfouis fous une mafffe
de nuages & d’extravagances, ont échappé à fon
fiècle ; & d’ailleurs il n’a indiqué aucune expérience,
ni même indiqué aucun fait pofitif pour
appuyer fes conceptions vraiment inouïes, comme
il aimoit à les nommer lui-même. •
C ’eft à Boy le , vers la fin du dix-feptïème fiècle,
que remontent feulement les premiers effais chimiques
faits fur Y urine de l'homme. La découverte
du phofphore , faite en 1667 par Brandt, dè
Hambourg, qui travaiiloit fur Y urine dans des vues
alchimiques; les travaux de Kunckel, qui parvint
à le préparer avec le réfidu de cette liqueur animale
évaporée, donnèrent, à ce qu’il paroît, a
Boyle, l’envie de faire un examen fuivi de ce liquide,
& il dépofa en 1680, à la Société royale de
Londres, un petit morceau de phofphore qu’il en
avoit extrait : il communiqua fon procédé a Gode-
freid Hankwits, pharmacien de Londres, qui, pendant
plufieurs années, s’occupa de cette préparation
primitivement urinaire, & vendit pendant
plus de vingt ans du phofphore à tous les phyfi-
ciens de l’Europe : on voit que c’eft: à la découverte
de ce corps combuftible, nomme long-temps
phofphore d'urine, qu'eft due la première fuite des
travaux chimiques entrepris fur cette liqueur; car
je ne compte prefque pas, parmi ces travaux,
l’emploi de Yurine pour differèns procèdes de de-
graiffage des laines 8c pour i’extraétion du carbonate
d’ammoniaque huileux, qui a joué fi longtemps,
fous le nom de fel volatil,, un grand rôle
parmi les médicamens dus aux préparations chimiques,
comme dans la théorie de la médecine
active
U R I 0 2 1
active 8c àlexipnarmaque qui régnoit alors en Europe.
Après cette découverte du phofphore de Yurine,
plus de foixante ans fe font paffés fans qu’on ait
ajouté quelque chofe, au moins d’important & de
Caillant, à la connoiffance chimique de cette liqueur
: on ne s’eft occupé que de la manière de la
traiter pour en obtenir le phofphore, fans rien
faire pour en déterminer les principes. Ainfi, la
publication fucceflive des procédés de Krafft,
de Brandt, de Homberg, de Teichmeyer, de
Fréd. Hoffmann, de Niewentuit, de Wedelius
8c de beaucoup d’autres encore, pour extraire le
phofphore; le Mémoire de Hellotj donné en 1737,
parmi ceux de l’Académie, pour faire réuffir cette
opération, longue, dégoûtante, difficile, n’ont
rien, ou prefque rien appris fur Yurine, fi ce n’ eft
que c’étoit une liqueur très-faline, dont toute la
fubftance n’étoit pas propre à former le phofphore,
qui n’en contenoic qu’une très-petite quantité, 8c
dont oa avoit beaucoup de peine à f extraire.
A la même époque, ou peu avant l’époque du
travail de Boyle, Laurent Bellini de Florence, 8c
profeffeur de médecine à Pife, a confidété les propriétés
de Yurine appliquées à la médecine, & lié les
faits chimiques qu’il connoiffoit aux phénomènes
de l’économie animale, avec une fagacité 8c une
Simplicité très-remarquables. Après avoir décrit
l ’effet de l’ évaporation par le feu fur ce liquide,
fa couleur brunie, fa confiftance prefque folide,
fon âcreté.forte 8c piquante, il a fait voir qu’en
lui rendant l'eau qu’elle avoitperdue, cette maffe
s ’y rediffolvoit 8c repaffoit, à mefure qu’on ajou-
toit ce liquide ,.par les divers états de couleur, de
limpidité, de faveur, de moins en moins fo rte,
jufqu’à ce que, contenant toute l'eau évaporée,
elle fût revenue à fon premier état. Par ce moyen
d’analyfe, auffi fimple qu’ ingénieux, il eft arrivé
à conclure que Yurine, compofée d’eau , de fel 8c
de terre, ne différoit dans fa nuance, fa faveur, fa
fluidité , que par la proportion d'eau 8c de fes matières
fixes, 8c que telle éroit la caufe primitive
dè toutes les propriétés diverfes qu’elle préientoit
dans les différens cas où on i’obfervoit ; mais il ne
connoiffoit aucun des principes particuliers de
cette liqueur animale, & le cas que faifoit alors
de fon ouvrage Bohnius , profeffeur à Leipfick,
auteur d’un des premiers ouvrages de chimie phi-
lofophique, prouve le peu de progrès que cette
fcience avoit faits encore fur l’analvfe .animale :
on peut en dire autant de Thom Willis, qui,
dès 1666, avoit cependant employé beaucoup de
connoiffances chimiques de fon temps à la phy-
fiologie & à l’art de guérir.
Boerhaave' a donné, dans.fes Elémens de Chimie,
neuf procédés fur les propriétés & I’ analyfe de
Murine : c’eft celui des méde cins chimiftes du commencement
du dix-huitième fiècle qui a le plus
ajouté aux premiers effais de Boyle fur ce liquide
excrëmentitiel; car Stahl n’eft remarquable dans
Ch imie , Tome VI.
U R I
cette partie de I’hiftoire de la fciencé, que par la
fingulière obftination avec laquelle il a foutenu
que c’ étoit le fel marin contenu dans Yurine^ qui
donnoit le phofphore, & que l’acide muriatique
étoit à ce corps combuftible ce que le fulfurique
étoit au fou fre, erreur que plufieurs écrivains luionc
reprochée avec rai fon, 8c qui fait une tache dans fes
ouvrages, fi recommandables d’ailleurs par la clarté
8c la méthode qui y régnent.. Dans fes neuf procédés
, Boerhaavç effayoit de prouver que Yurine
n’étoit ni acide, ni alcaline ; qu’elle ne donnoit pas
d’alcool, mais un principe fétide analogue à celui
de la fue.ur, & une huile pourrie > qu’elle ne con-
tenoit rien de chyleux, de nutritif, de coagulable
parle feu, mais feulement des matières âcres, putrides,
atténuées 8c dangereufes pour la fan té ;
qu’après l’huile horriblement fétide qui en fortoit
par la diftiilation, il reftoit un charbon dont op
pouvoit tirer dqprnuriate de fonde 8c point de fel
fixe; que l’alcali fixe & la c h aux en dégageoient une
matière âcre, une efpèce de vapeur dangereufe
par fon aéfcion fur nos corps ; que Y urine contenoic
un Tel âcre, atténué, particulier, dont il n’a pas
connu la nature, ainfi qu’une matière brune, dé-
liquefcente, qui, pourrie dans des vaiffeaux fermés,
devenoit ammoniacale 8c donnoit enfuite
beaucoup d’alcàli volatil ; que c’ étoit la plus pu-
trefeibie de toutes les liqueurs animales, quoiqu’elle
ne contînt rien de corrompu en fortant
immédiatement du corps ; qu’ il s en féparoic ,
pendant fa putréradiion, une croûte calculeufe ,
à la formation de laquelle l’alcali volatil ne s’op-
pofoit pas. Dans tous ces détails, dont je n’ex-
pofe ici qu’un récit très-rapide, on reconnoît que
Boerhaave, fans connoître exactement les véritables
matériaux de Yurine, a cependant beaucoup mieux
étudié ce liquide excrémentitiel qu’on ne l’avoit
fait avant lui, 8c qu’il l’a confidéré avec jufteffe
comme deftiné à évacuer, hors du corps humain,
les matériaux putrefeibtes formés par le mouvement
de la circulation &: de la vie.
En 1743, Margraff, célèbre chimifte de Berlin,
occupé de recherches fur les moyens de rendre la
préparation du phofphore plus facile 8c plus fûre
qu’elle ne l’étoic encore dans le procédé publié
par Hellot eh 1737, analyfa Yurine humaine avec
un nouveau foin ; il trouva qu’un feul des fels contenus
dans cette liqueur donnoit du phofphore;
c’étoit le phofphate d’ammoniaque ; qu’un autre
qui y étoit fouvent mêlé, n’en fourniffoit pas,
c’étoit le phofphate de Coude ; qu’on re droit celui-ci
du réfidu de la diftiilation du phofphore d'urine en
le leffivant; que le muriate de Coude ne donnoit
jamais de phofphore, maigre l’affertion de Stahl.
11 découvrit qù’en diftillant l’extrait d'urine calciné
avec du muriate de plomb, on en obtenoit du
phofphore ; 8c comme les travaux fücceffifs de
-Schloffer, de 'Haupt 8c dé. Klaproth fur les fels
fufîbles; de Yurine y ont fait reconncître les deux
phofphates, on voit que Margraff, fans connoître