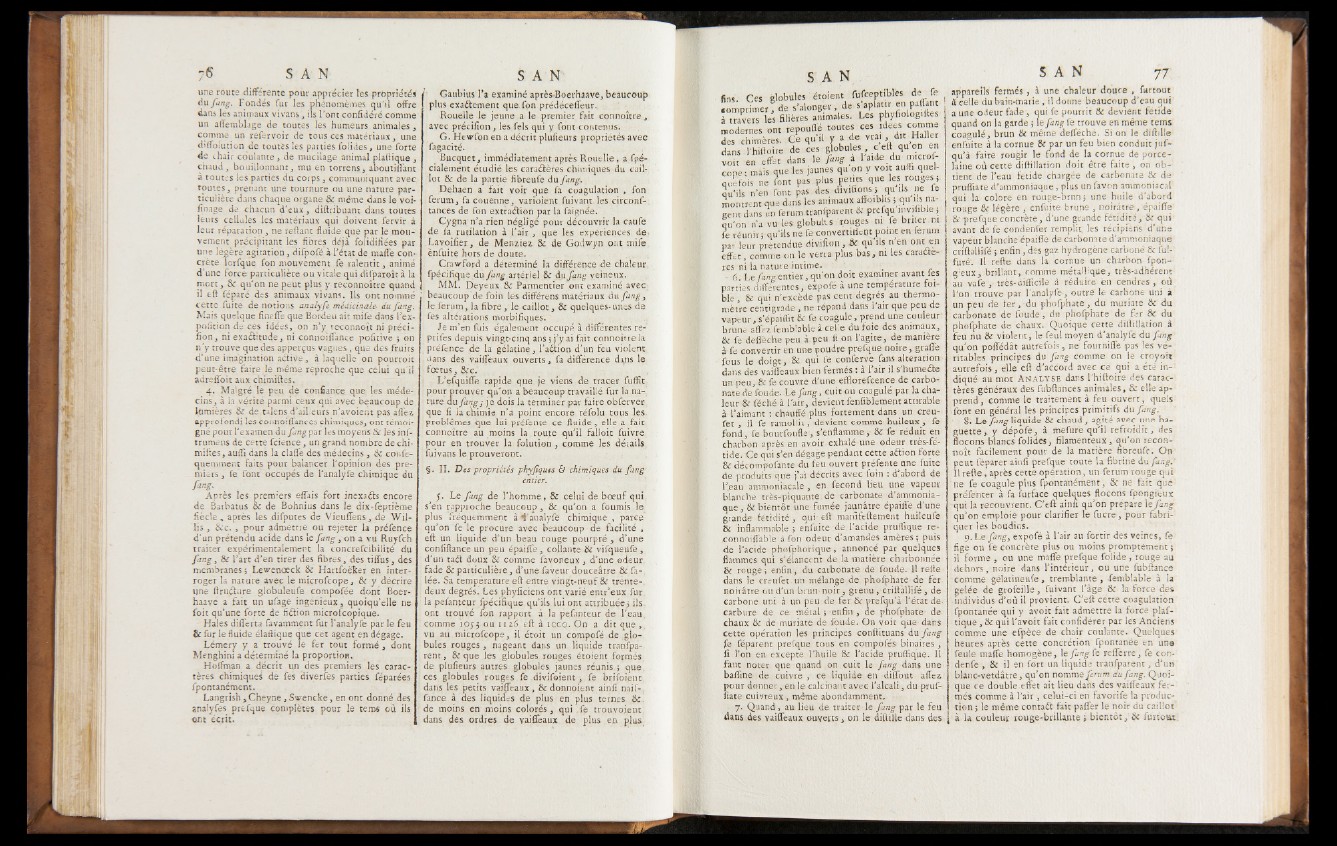
une route différente pour apprécier les propriétés
àu fang. Fondés fur les pnënomèmes qu'il offre
dans les animaux vivans t ils l ’ont confîdéré comme
un alïemblage de toutes les humeurs animales 3
comme un réfervoir de tous ces matériaux une
ddfolution de toutes les parties folides, une forte
de chair coulante 3 de mucilage animal plaflique 3
chaud, bouillonnant, mu en torrens, aboutilfant
à toutes les parties du corps, communiquant avec
toutes, prenant une tournure ou une nature particulière
dans chaque organe & même dans le voi-
fînage de chacun d’eux , diftribuant dans toutes
leurs cellules les matériaux qui doivent fervir à
leur réparation, ne refiant fluide que par le mouvement
précipitant les fibres déjà folidifiées par
une légère agitation, difpofé à Tétât de maffe concrète
lorfque fon mouvement fe ralentit, animé
d’une force particulière ou vitale qui difparoîc à la
mort, & qu’on ne peut plus y reconnoître quand
il eft féparé des animaux vivans. Ils ont nommé
cette fuite de notions analyfe médicinale• du fane.
Mais quelque finefle que Bordeu ait mife dans l’expo
fi ci on de ces idées, on n’y reconnoît ni préci-
fion, ni exactitude, ni connoiffance pofitive > on
n’y trouve que des apperçus vagues, que des fruits
d’une imagination aètive, à laquelle on pourroit
peut-être faire le même reproche que celui qu'il
adreffoit aux chimïftes.
4. Malgré le peu de confiance que les médecins,
à la vérité parmi ceux qui avec beaucoup de
lumières & de talens d’ail'eurs n’avoient pas aftez
approfondi les connoiffances chimiques, ont témoigné
pour l’examen du fang par les moyens & les inf-
trumens de cette fcience , un grand nombre de chi-
miftes, aufïi dans la claffe des médecins, & confe-
quemment faits pour balancer l’opinion des premiers,
fe font occupés de l’analyfe chimique du
Apres les. premiers eftais fort inexacts encore
de Barbatus & de Bohnius dans le dix-feptième
fiècle, après les difputes de Vieuffens, de Wil-
lis , & c . , pour admettre ou rejeter la préfence
d’un prétendu acide dans le fang, on a vu Ruyfch
traiter expérimentalement la concrefcibilité du
fa n g 3 & l’art d’en tirer des fibres, des tiffus, des
membranes 5 Lewenoeck & HartfoëRer en interroger
la nature avec le microfcope, & y décrire
une ftrucuire globuleufe compofée dont Boer-
haave a fait un ufage ingénieux, quoiqu’elle ne
foit qu’une forte de fiCtion microfcopique.
Haies differta favamment fur l’analyfe par le feu
& fur le fluide élaftique que cet agent en dégage.
Lémery y a trouvé le fer tout formé , dont
Menghini a déterminé la proportion.
Hoffman a décrit un des premiers les caractères
chimique^ de fes diverfes parties feparées
fpontanément.
Langrish,Cheyne,Swencke, en ont donné des
analyfes prefque complètes pour le tems où ils
ont écrit.
Gaubius l*a examiné après-Boerhaave, beaucoup
plus exactement que. fon prédéceffeur.
Rouelle le jeune a le premier fait connoître,
avec précifion , les fels qui y font contenus.
G. Hewfon en a décrit plufieuis propriétés avec
fagacité.
Bucquet, immédiatement après Rouelle, a spécialement
étudié les caractères chimiques du caillot
& de la partie fibreufe du fang.
Dehaen a fait voir que fa coagulation , fon
ferum, fa couenne, varioient fuivant les circonf-,
tances de fon extraction par la faignee.
Cygna n’a rien négligé pour découvrir la caufe
de fa rutilation à l’air , que les expériences de*
Lavoifîer, de Menziez & de Godvryn ont mife
ènfuite hors de doute.
Cravrford a déterminé la différence de chaleur
fpécifique du fang artériel & du fang veineux.
MM. Deyeux & Parmentier ont examiné avec
beaucoup de foin les différens matériaux du fang y
le ferum, la fibre, le caillot, & quelques-unes de
fes altérations morbifiques.
Je m’en fuis également occupé à différentes re-'
prifes depuis vingt-cinq ans $ j’ y ai fait connoître la
préfence de la gélatine, Faction d’un feu violent
uans des vaiffeaux ouverts, fa différence d^ns le
foetus, &c. ,
L’efquiffe rapide que je viens de tracer fufïit
pour prouver qu’on a beaucoup travaillé fur la na-;
ture du fang; je dois la terminer par faire obferver
que fi la chimie n’a point encore réfolu tous les.
problèmes que lui préfente ce fluide, elle a fait
connoître au moins la route qu’il falloit Suivre
pour en trouver la folution , comme les détails,
fuivans le prouveront.
§. II. Des propriétés phyfiquts & chimiques du fang
'■ entier.
y. Le fang de l’homme, & celui de boeuf qui
s’en rapproche beaucoup, & qu’on a fournis le
plus fréquemment à «Tanalyfe chimique , parce
qu’on fe le procure avec beaucoup de facilité ,
eft un liquide d’ un beau rouge pourpré , d’u.ne
confiftance un peu épaiffe, collante & vifqueufe,
d’un taCt doux & comme favoneux , d’une odèur
fade & particulière, d’une faveur douceâtre & fa-,
lée. Sa température eft entre vingt-neuf & trente-
deux degrés. Les phyficiens ont varié entr’eux fur.
la pefanteur fpécifique qu’ils lui ont attribuée_> ils.
ont trouvé fon rapport à la pefanteur de l’eau,
comme 1053 ou 1 116 ëft à icco. On a dit que,,
vu ail microfcope, il étroit un compofé de globules
rouges, nageant dans un liquide tranfpa-
rent, & que les globules rouges étoient formés,
de plufieurs autres glqbules jaunes réunis.5 que.
ces globules rouges fe divifoient, fe brifoient
dans les petits vaiffeaux, & donnoient ainfi naif-,
fance à des liquides de plus en plus ternes & .
de moins en moins colorés, qui .fe trouvoient
dans des ordres de vaiffeaux de plus en plus
fins. Ces globules étoient fufceptibles de ft
«omprimer, de s’alonger, de-s’aplatir en paffant
à travers les filières animales. Les phyfiolog.lles
modernes ont repouflé toutes ces . t e »
des chimères. Ce qu il y a de vrai, dit Haller
dans l’hiftoire de ces globules , c eft qu on en
voit en effet dans le fang a laide du microfcope
• mais que des jaunes qu on y volt auffi quelquefois
ne font pas plus petits que les rouges ;.
qu’ils n’en font pas des divifions ; quilsme fe
montrent que dans les animaux affaiblis ; qu ils na-
gent dans un ferum ttanfpaventSe prefqu invilible ;
qu’on n’a vu les globuhs rouges ni fe brfter m
fe réunir; qu’ils ne fe convertiticqt point en ferum
par leur prétendue div.ifion, & qu ils n en ont:en
effet, comme on. le verra plus bas , ni les caractères
ni la nature intime. ' - : . 1
6. Le/(mg-.entier, qu’on doit examiner avant les
parties différentes, expofé à une température faible,
8c qui n’excède pas cent degrés au thermomètre
centigrade, ne répand dans 1 air que peu de
vapeur, s’épaiffit & fe coagule, prend une couleur
brune affez femblable à celle du foie des animaux,
& fe deffèche peu à,peu li on l'agite, de manière
à fe convertir en une poudre prefque noire, grade
fous le doigt , 8c qui fe conferve fans alteration
dans des vaiffeaux bien fermés t a 1 air il s humeite
un peu, & fe couvre d’une efflorefcence de carbonate
de foude, Le fang, cuit ou coagulé parla chaleur
& féché à l’air, devient fenfiblement attirable
à l’aimant : chauffé plus fortement dans un creu-
f e t , il fe ramollit, devient comme huileux, fe
fond, fe bourfoufle, s’enflamme, &. fe réduit en
charbon après en avoir-exhalé-une odeur très-fétide.
Ce qui s’en dégage pendant cette aélion forte
8c décompofa'nte du feu ouvert préfente^nne fuite
de produits que j*ai décrits avec foin : d abord de
l’eau ammoniacale, en fécond lieu une vapeur
blanche très-piquante de carbonate d’ammoniaque,
8c bientôt une fumée jaunâtre épaiffe d'une
grande fétidité , qui-eft manîfeftement huileufe
& inflammable ; enfuite de l'acide pruffique re-
.connoiffable à fon odeur d’amandes amères ; puis
de l'acide phofphorique , annoncé par quelques
flammes qui s’élancent de la matière charbonnée
& rougei enfin, du carbonate de foude. 11 relie
dans le creufet un mélange de phofphate de fer
noirâtre ou d’un brun-noir, grenu, crittailifé, de
carbone uni à un peu de fer & prefqu’à l’état de
carburé de ce métal ; -enfin, de phofphate de
chaux & fie muriate de foude. On voit que dans
cette opération les principes conftituans du fang
fe féparent prefque tous en compofés binaires,
fi l’on en excepte l’huile 8e l’acide pruflîque. Il
faut noter que quand on cuit le fang dans une
baffine de cuivre, ce liquide en diffout affez
pour donner, en le calcinant avec l’alcali, du pruf-
fiate cuivreux, même abondamment.
■ 7. Quand, au lieu de traiter le fang par le feu
dans des vaiffeaux ouverts, on le diftille dans des
appareils fermés , à une chaleur douce , furtout
& celle du bain-marie, il donne beaucoup d’eau qui
a une odeur fade , qui fe pourrit & devient fétide
quand on la garde ; le fang fe trouve en même tems
coagulé, brun & même defféché. Si on le diftille
enfuite à la cornue 8c par un feu bien conduit juf-
qu’à faire rougir le fond de la cornue de porcelaine
où cette diftiilation doit être faite , on obtient
de l’eau fétide chargée de carbonate 8c de
pruffiate d'ammoniaque , plus un favon ammoniacal
qui la colore en rouge-brnn ; une huile d’abord
rouge 8c légère , enfuite brune , noirâtre, épaiffe
8cprefque concrète, d’une grande fétidité, 8c qui
avant de fe condenfer remplit, les récipisns d'une
vapeur blanche épaiffe de carbonate d’ammoniaque
criftallifé ; enfin, des gaz hydrogène carboné 8c fui-'
futé. Il telle dans la cornue un charbon fpon-
g:eux, brillant,.comme métallique, très-adhérent
au vafe, très-difficile à réduire en cendres, où
l ’on trouve par l’analyfe-, outre le carbone uni à
un peu de fer, du phofphate, du muriate 8c du
carbonate de foude, du phofphate de fer 8c du
phofphate de chaux. Quoique cette diftiilation â
feu nu 8c violent, le feu! moyen d’analyfe du fang
qu'on poffédât autrefois, ne fourniffe pas les véritables
principes du fang comme on le croyoit
autrefois, elle eft d’accord avec ce qui a été indiqué
au mot A n a l y s e dans l'hiftoire des caractères
généraux des fubftances animales, 8c elle apprend,
comme le traitement à feu ouvert, quels
-font en général les principes primitifs du fang.
8. Le fang liquide 8c chaud, agité avec une baguette,,
y dépofe, à mefure qu’il refroidit, des
flocons blancs folides, filamenteux, qu’on recoa-
noît facilement pour de la matière hbreUfe. On
peut féparer ainfi prefque toute la fibrine du fang."
Il refte, après cette opération , un ferum rouge qui
ne fe coagule plus fpontanément, 8c ne fait que
préfenter à fa futface quelques flocons fpongieux
qui la recouvrent. C’eft ainfi qu'on prépare le fang
qu’on emploie pour clarifier le fucre, pour fabriquer
les boudins.
9. Le fang, expofé à l ’air au fortir des veines, fe
fige ou fe concrète plus ou moins promptement ;
il forme , ou une maffe prefque folide, rouge au
dehors, noire dans l’ intérieur, ou une fubftance
comme gélatineufe, tremblante , -femblable à la
gelée de gtofeille, fuivant l’âge 8c la force des
-individus d’où il provient. C ’eft cette coagulation
fpontahée qui y avoit fait admettre la force piaf-
tique, 8c qui l’avoit fait confidérer par les Anciens
comme une efpèce de chair coulante. Quelques
heures après cette concrétion fpontanée en une
feule maffe homogène, le fang fe reffevre, fe con-
denfe , 8c il en fort un liquide tranfparent, d’ un
blanc-vetdâtre, qu’on nomme ferum du fang. Quoique
ce double effet ait lieu dans des vaiffeaux fermés
comme à l’air, celui-ci en favorife la production;
le même contait fait paffer le noir du caillot
j à la couleur rouge-brillante; bientôt, 8c furtout.