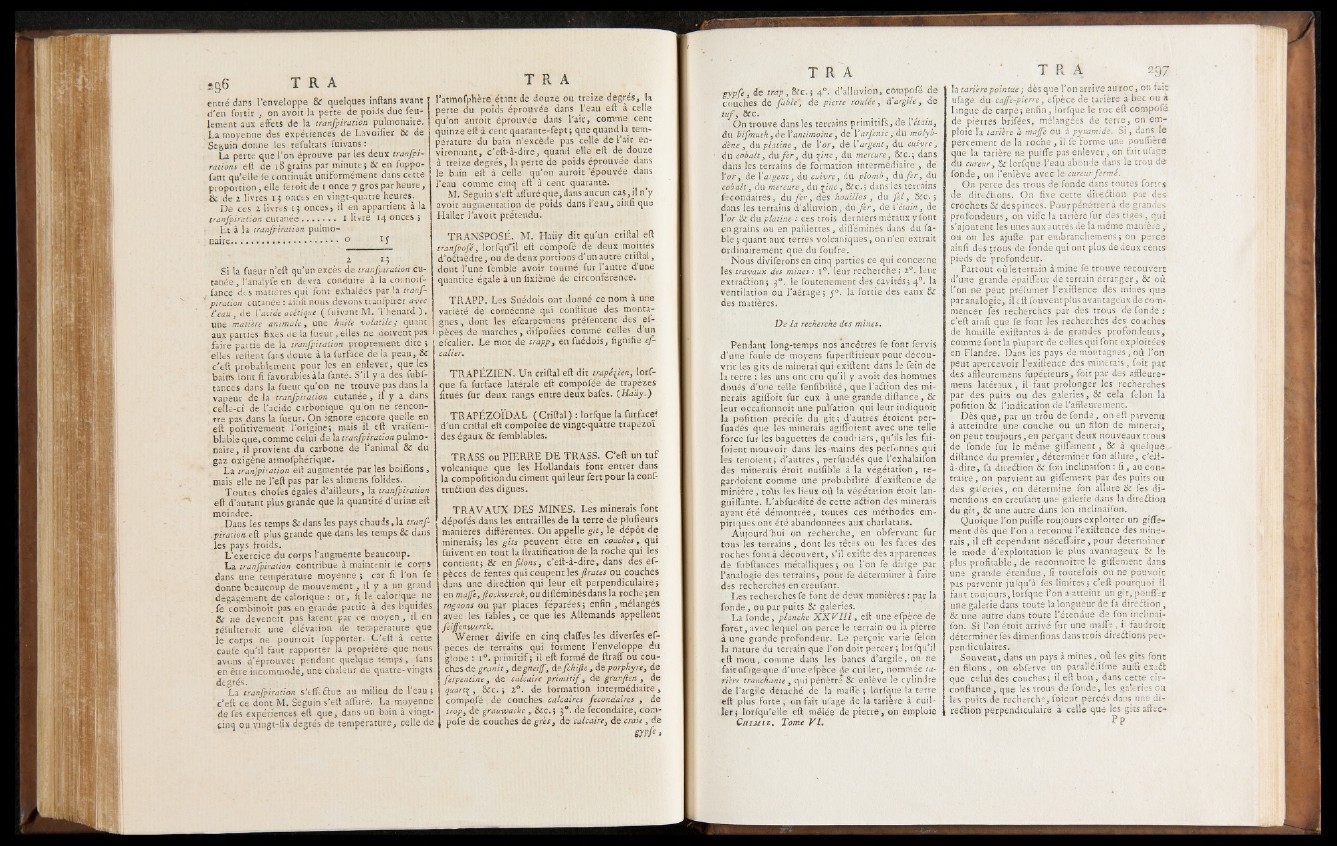
entré dans l ’enveloppe & quelques inftans avant 1
d'en fortir , on avoit la perte de poids due feulement
aux effets de la tranfpiration pulmonaire.
La moyenne des expériences de Lavoifier & de
Seguin donne les réfultats fuivans :
La perte que l’on éprouve par les deux tranfpi-
rations eft de 18 grains par minute} & eniuppo-
fant qu'elle le continuât uniformément dans cette
proportion, elle feroitde i once 7 gros par heure,
& de 2 livres 13 onces en vingt-quatre heures.
De ces 2 livres 13 onces, il en appartient à la
tranfpiration cutanée............. I livre 14 onces }
E,t à la tranfpiration pulmonaire........
............................. • • 0
2 I3> . .
Si la fueur n’eft qu’un excès de tranfpiration cutanée,
l'analyfe en devra conduire à la connolf-
. fan ce des matières qui font exhalées par la tranf-
' piration cutanée : ainfi nous devons tranfpirer avec
, F eau, de l ’acide acétique ( fuivant M. Thénard ) ,
une matière animale , une huile volatile y quant ,
aux parties fixes de la fueur, elles ne doivent pas
faire partis de la tranfpiration proprement dite }
elles relient fans doute à la furface de la peau, &
c’eft probablement pour les en enlever, que les
bains font fi favorables à la fanté. S'il y a des fubl-
tances dans la fueur qu'on ne trouve pas dans la
vapeur de la tranfpiration cutanée, il y a dans
celle-ci de l’acide carbonique quon ne rencontre
pas dans la fueur. On ignore encore quelle en
eft pofitivement l’origine; mais il eft vraifem-
blable que, comme celui de la tranfpiration pulmonaire,
il provient du carbone de l'animal & du
ratmofphère" étant de douze ou treize degrés, la
perte du poids éprouvée dans l'eau eft à celle
qu’on auroit éprouvée dans l'air, comme cent
quinze eft à cent quarante-fept; que quand la température
gaz oxigène atmofphérique.
La tranfpiration eft augmentée pat les boiffons,
mais elle ne i’eft pas par les alimens folides.
Toutes chofes égales d'ailleurs, la tranfpiration
eft d’autant plus grande que la quantité d’urine eft
moindre. _
„Dans les temps & dans les pays chauds, la tranf~_
.piration eft plus grande que dans les temps & dans
Tes pays froids.
L’exercice du corps l'augmente beaucoup.
La tranfpiration contribue à maintenir le corps
dans une température moyenne } car fi l’on fe
donne beaucoup de mouvement , il y a un grand
dégagement de calorique : or, fi le calorique ne
fe combinoit pas en grande partie a. des liquides
& ne devenoit pas latent par ce moyen, il en
réfulteroit une élévation de température que
le corps ne pourroit fupporter. C ’eft à cette
caufe qu’il faut rapporter la propriété que nous
avons d’éprouver pendant quelque temps, fans
en être incommodé, une chaleur de quatre-vingts
degrés.
La tranfpiration s’effectue au milieu de l'eau}
c’eft ce dont M. Seguin s’ eft affûté. La moyenne
de fes expériences eft que, dans un bain à vingt-
cinq ou vingt-fix degrés de température, celle de
du bain n’excède pas celle de l’air environnant,
c’ eft-à-dire, quand elle eft de douze
à treize degrés, la perte de poids éprouvée dans
le bain eft à celle qu’on auroit epouvée dans
l’eau comme cinq eft à cent quarante.
M. Seguin s’e ft alluré que,dans aucun cas,il n y
avoit augmentation de poids dans l’eau, ainfi que
Haller l’avoit prétendu.
TRANSPOSÉ. M. Haüy dit qu'un criftal eft
tranfpofé, lorfqù’il eft compofé de deux moitiés
î d’oCtaèdre, ou de deux portions d'un autre criftal,
dont l’une femble avoir tourné fur l’autre d’une
quantité égale à un fixième de circonférence.
TRAPP. Les Suédois ont donné ce nom à une
variété de cornéenne qui conftitue des montagnes,
dont les elcarpemens préfentent des el-
pèces de marches, difpofées comme celles d’un
efcalier. Le mot de trapp, en fuédois, lignifie ef-
c alier.
TRAPÉZIEN. Un criftal eft dit trapéfen, lorsque
fa furface latérale eft compofée de trapèzes
fitués fur deux rangs entre deux bafes. {Haüy.)
TRAPÉZOÏDAL (Criftal) : lorfque la furface*
! d’un criftal eft compofée de vingt-quatre trapézoï
des égaux & femblables.
TRASS ou PIERRE DE TRASS. C ’eft un tuf
volcanique que les Hollandais font entrer dans
la compofition du ciment qui leur fert pour la conf-
truCtion des digues.
TRAVAUX DES MINES. Les minerais font
dépofés dans les entrailles de la terre de plufieurs
manières différentes. On appelle git, le dépôt de
minerais} les gits peuvent êcre en couches, qui
| fuivent en tout la ftratification de la roche qui les
contient} & en filons, c’eft-à-dire, dans des ef-
pèces de fentes qui coupent les firates ou couches
dans une direction qui leur eft perpendiculaire;
en maffe yftockwerck,oudifféminésdansla rochesen
rognons ou par places féparees} enfin , mélangés
avec les fables, ce que les Allemands appellent
feijfeniyerck.
Werner divife en cinq claffes les diverfes espèces
de terrains qui forment l’enveloppe du
globe : i°. primitif} il eft formé de ftralf ou couches
de granit, degneif, de fckifte , de porphyre, de
ferpentine, de calcaire primitifs de grunfien , de
quarts, & c .} 2°. de formation intermédiaire,
compofé de couches calcaires fecondaires , de
trop, de grauwackc, Ôcc.j 30. de fecondaire, compofé
de couches de grès, de calcaire, de craie , de
eypfc >
T R A
gypfe, de trap, &e.} 40. d'alluvion, compofé de
couches de fable\ de pierre roulée, d’argile, de
tuf 3 ôrc.
On trouve dans les terrains primitifs, de l’étain,
du Bifmuth, de Xantimoine, de Xarfenic, du molybdène
y du platine, de l’or, de Xargent, du cuivre,
du cobalt, du fer y du fine 3 du mercure, &c.; dans
dans les terrains de formation intermédiaire , dé
l’or, de X argent, du eu ivre, du plomb , du fer3 du
cobalt, du mercure, du ft te , &c.j dans les terrains
fecondaires, du fe r , des houilles , du fe l, Scc. ;
dans les terrains d’alluvion, du fer, de X étain, de
l’or & du platine- : ces trois derniers métaux y font
en grains, ou en paillettes, difféminés dans du fable}
quant aux terres volcaniques, on n’en extrait
ordinairement que du foufre.
Nous diviferonsen cinq parties ce qui concerne
les travaux des mines: i°. leur recherche} 20. leur
extradion} 30. le foutenement des cavités} 40. la
ventilation ou l’aérage j y0, la fortie des eaux &
des matières.
De la recherche des mines.
Pendant long-temps nos ancêtres fe font fervis
d’une foule de moyens fuperftitieux pour découvrir
les gits de minerai qui exiftent dans le fein de
la terre : les uns ont cru qu’il y avoit des hommes
doués d’une telle fenfibilité, que l’aêcion de$ minerais
agilfoit fur eux à une grande diftance, &
leur occafionnoit une pulfation qui leur indiquoit
la pofition précife du git} d’autres étoient per-
fuadés que les minerais agiffoient avec une telle
force fur les baguettes de coudriers, qu’ils les fai-
foienc mouvoir dans les mains des perfonnes qui
les tenoientj d’autres, perfuadés que l’exhalaifon
des minerais étoic nuifible à la végétation, re-
gardoient comme une probabilité d’exiftence de
minière, to\is les lieux où la végétation étoit lan-
guilfante. L’abfurdité de cette aCtion des minerais
ayant été démontrée, toutes ces méthodes empiriques
onc été abandonnées aux charlatans.
Aujourd’hui on recherche, en obfervant fur
tous les terrains , dont les têtes ou les faces des
roches font à découvert, s’ il exifte des apparences
de fubftances métalliques} ou l'on fe dirige par
l’analogie des terrains, pour fe déterminer à faire
des recherches en creufant.
Les recherches fe font de deux manières : par la
fonde, ou par puits & galeries.
La fonde, planche X X V I I I , eft une efpèce de
foret, avec lequel on perce le terrain ou la pierre
à une grande profondeur. Le perçoir varie félon
la nature du terrain que l’on doit percer; lorfqu’il
eft mou, comme dans les bancs d’argile, on ne
fait ufage-que d’une efpèce de cuiller, nommée tarière
tranchante, qui pénètre & enlève lé cylindre
de l’argile détaché de la maffe} lorfque la terre
eft plus forte, on fait ufage de la tarière à cuiller}
lorfqu’elle eft mêlée de pierre, on emploie
Chimie, Tome VI,
T R A 297
la tarière pointue ; dès que l’on arrive au roc, on fait
ufage du cajfe-pierre, efpèce de tarière à bec ou a
langue de carpe; enfin, lorfque le roc eft compofé
de pierres brifées, mélangées de terre, on emploie
1 à tarière a maffe OU à pyramide. S i, dans le
percement de la roche , il fe forme une pouffière
que la tarière ne puiffe pas enlever, on fait ufage
du cureur, & lorfque l’eau abonde dans le trou de
fonde, on l’enlève avec le cureur fermé.
On perce des trous de fonde dans toutes fortes
de directions. On fixe cette direction par des
crochets & despinces. Pour pénétrer à de grandes
profondeurs, on viffe la tarière fur des tiges, qui
s’ ajoutent les unes aux autres de la même manière,
ou on les ajufte par embranchemens ; on perce
ainfi des trous de fonde qui ont plus de deux cents
pieds de profondeur.
Partout où le terrain à mine fe trouve recouvert
d’une grande épaiffeur de terrain étranger, & où
l’on ne peut préfumer l’exiftence des mines que
par analogie, il t ft fouvent plus avantageux de commencer
les recherches par des trous dé fonde :
c’eft ainfi que fe font les recherches des couches
de houille exiftantes à- de grandes profondeurs,
comme font la plupart de celles qui font exploitées
en Flandre. Dans les pays de montagnes, où l’on
peut apercevoir l’exiftence des minerais, foit par
des affleuremens fupérieurs, foit par des affleure -
mens latéraux, il faut prolonger les recherches
par des puits ou des galeries, & cela félon la
pofition & l’indication de l’affleurement.
Dès que, par un trou de fonde, on eft parvenu
à atteindre une couche ou un filon de minerai,
on peut toujours, en perçant deux nouveaux trous
de fonde fur le même gilfement, & à quelque
diftance du premier, déterminer fon allure, c’eil-
à-dire, fa direction & fon inclinaifon: fi, au contraire,
on parvient au gilfement par des puits ou
des galeries, on détermine fon allure & fes di-
menfions en creufant une galerie dans la direction
du git, & une autre dans fon inclinaifon.
Quoique l’on puiffe toujours exploiter un giffe-
ment dès que l’on a reconnu l’exiftence des minerais
, il eft cependant néceffaire, pour déterminer
le mode d’exploitation le plus avantageux & le
plus profitable, de reconnoître le gilfement dans
une grande étendue, fi toutefois on ne pouvoic
pas parvenir jufqu’à fes limites; c’eft pourquoi il
faut toujours, lorfque l’on a atteint un git, pouffer
une galerie dans toute la longueur de fa direction ,
& une autre dans toute l’étendue de fon inclinaifon.
Si l’on étoit arrivé fur une maffe, i faudroit
déterminer fes dimenfions dans trois directions perpendiculaires.
Souvent, dans un pays à mines, où les gits font
en filons, on obferve tin paralléiifme aufti exaCfc
que celui des couches; il eft bon , dans cette cir-
conftance, que les trous de fonde, les galeries ou
les puits de recherche, foient percés dans une direction
perpendiculaire à celle que les gits affee-*