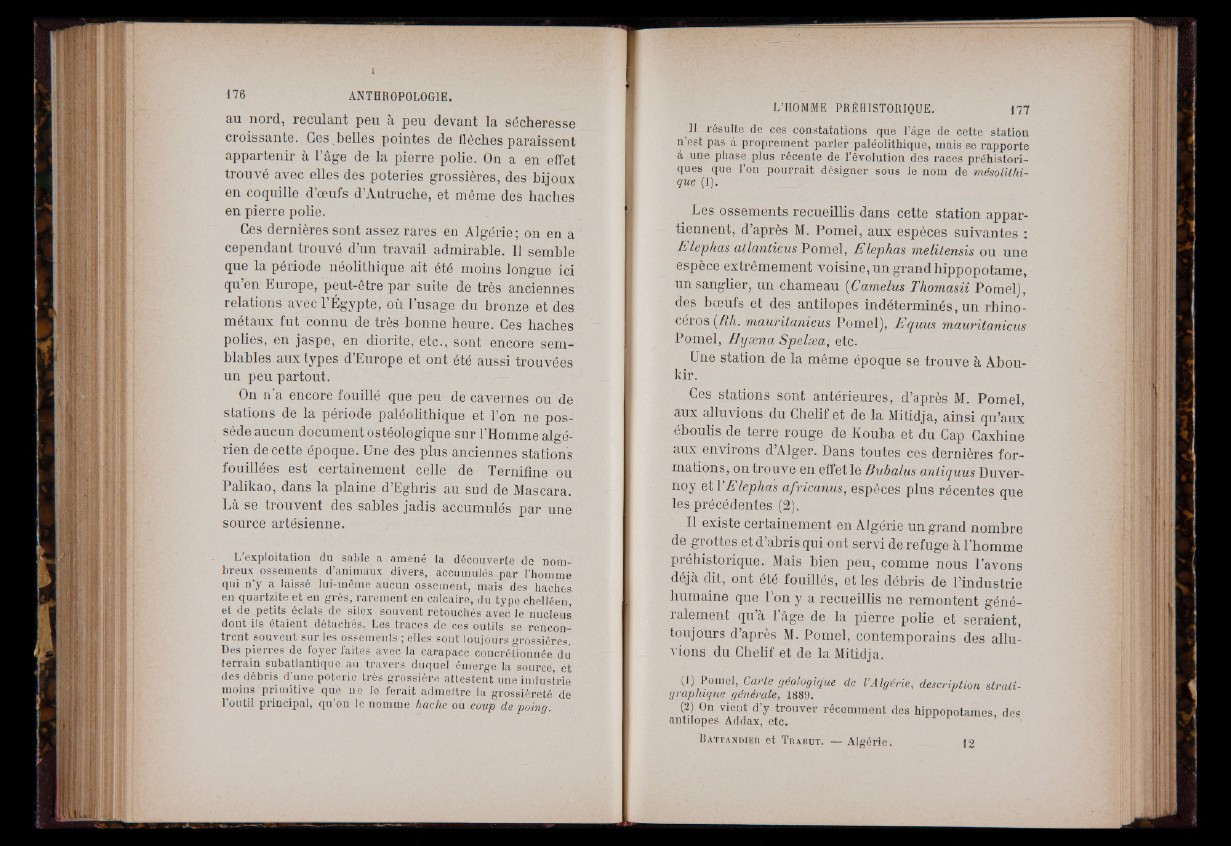
au nord, reculant peu à peu devant la sécheresse
croissante. Ces belles pointes de flèches paraissent
appartenir à l’âge de la pierre polie. On a en effet
trouvé avec elles des poteries grossières, des bijoux
en coquille d’oeufs d’Autruche, et même des haches
en pierre polie.
Ces dernières sont assez rares en Algérie; on en a
cependant trouvé d’un travail admirable. Il semble
que la période néolithique ait été moins longue ici
qu’en Europe, peut-être par suite de très anciennes
relations avec l’Égypte, où l’usage du bronze et des
métaux fut connu de très bonne heure. Ces haches
polies, en jaspe, en diorite, etc., sont encore semblables
aux types d’Europe et ont été aussi trouvées
un peu partout.
On n’a encore fouillé que peu de cavernes ou de
stations de la période paléolithique et l’on ne possède
aucun document ostéologique sur l’Homme algérien
de cette époque. Une des plus anciennes stations
fouillées est certainement celle de Ternifine ou
Palikao, dans la plaine d’Eghris au sud de Mascara.
Là se trouvent des sables jadis accumulés par une
source artésienne.
L exploitation du sable a amené la découverte de nombreux
ossements d’animaux divers, accumulés par l'homme
qui n'y a laissé lui-même aucun ossement, mais des haches
eu quartzite et en grès, rarement en calcaire, du type chelléen,
et de.petits éclats de silex souvent retouchés avec le nucléus
dont ils étaient détachésf Les traces de ces outils se rencontrent
souvent sur les ossements , elles sont toujours grossières
Des pierres de foyer faites avec la carapace concrétionnée du
terrain subatlantique au travers duquel émerge la source et
des débris d’une poterie très grossière attestent une industrie
moins primitive que ne Je ferait admeltre la grossièreté de
l’outil principal, qu’on le nomme hache ou coup de poing.
II résulte de ces constatations que l’âge de cette station
n est pas à proprement parler paléolithique, mais se rapporte
à une phase plus récente de l’évolution des races préhistoriques
que l’on pourrait désigner sous le nom de mésolithique
(1).
Les ossements recueillis dans cette station appartiennent,
d’après M. Pomel, aux espèces suivantes :
Elephas atlanticus Pomel, Elephas melitensis ou une
espèce extrêmement voisine, un grand hippopotame,
un sanglier, un chameau (Camelus Thomasii Pomel),
des bæùfs et des antilopes indéterminés, un rhino-
céios (,/?/j. mauritanicus Pomel), Equus maut'itcinicus
Pomel, Hyæna Spelæa, etc.
Une station de la même époque se trouve à Abou-
kir.
Ces stations sont antérieures, d’après M. Pomel,
aux alluvions du Chelif et de la Mitidja, ainsi qu’aux
éboulis de terre rouge de Kouba et du Cap Caxhine
aux environs d’Alger. Dans toutes ces dernières formations,
on trouve en effet le Bubalus antiquus Duver-
noy et Y Elephas africanus, espèces plus récentes que
les précédentes (2).
Il existe certainement en Algérie un grand nombre
de giottes et d abris qui ont servi de refuge à l’homme
préhistorique. Mais bien peu, comme nous Pavons
déjà dit, ont été fouillés, et les débris de l’industrie
humaine que I on y a recueillis ne remontent généralement
qu’à l’âge de la pierre polie et seraient,
toujours d’après M. Pomel, contemporains des alluvions
du Chelif et de la Mitidja.
(1) Pomel, Carte géologique de l'Algérie, description s tra ti-
graphique générale, 1889.
(2) On vient d’y trouver récemment des hippopotames, des
antilopes Addax, etc.
Battandier et Trabdt. — Algérie. 1 g