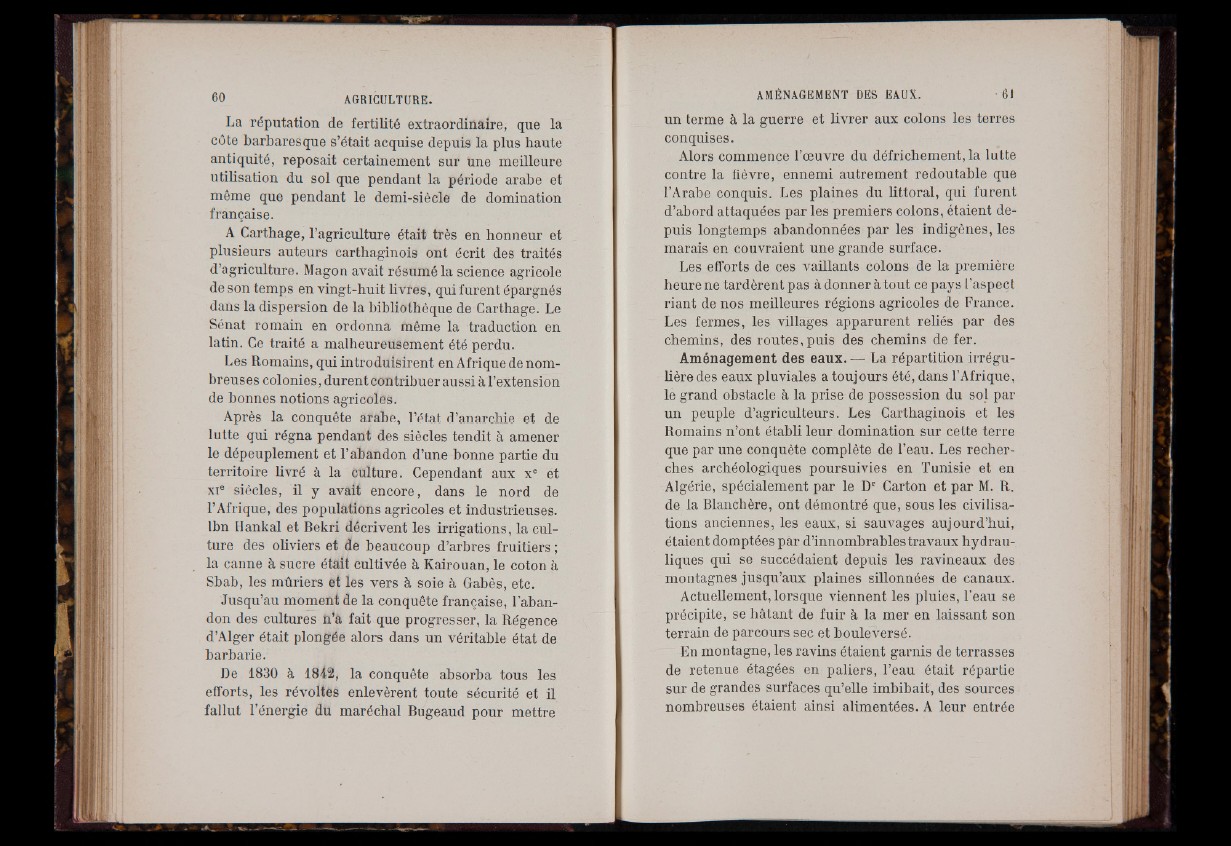
La réputation de fertilité extraordinaire, que la
côte barbaresque s’était acquise depuis la plus haute
antiquité, reposait certainement sur une meilleure
utilisation du sol que pendant la période arabe et
même que pendant le demi-siêcle de domination
française.
A Carthage, l’agriculture était très en honneur et
plusieurs auteurs carthaginois ont écrit des traités
d’agriculture. Magon avait résumé la science agricole
de son temps en vingt-huit livres, qui furent épargnés
dans la dispersion de la bibliothèque de Carthage. Le
Sénat romain en ordonna même la traduction en
latin. Ce traité a malheureusement été perdu.
Les Romains, qui introduisirent en Afrique de nombreuses
colonies, durent contribuer aussi à l’extension
de bonnes notions agricoles.
Après la. conquête arabe, l’état d’anarchie et de
lutte qui régna pendant des siècles tendit à amener
le dépeuplement et l ’abandon d’une bonne partie du
territoire livré à la culture. Cependant aux xe et
xi® siècles, il y avait encore, dans le nord de
l’Afrique, des populations agricoles et industrieuses,
lbn Hankal et Bekri décrivent les irrigations, la culture
des oliviers et de beaucoup d’arbres fruitiers ;
la canne à sucre était cultivée à Kairouan, le coton à
Sbab, les mûriers et les vers à soie à Gabès, etc.
Jusqu’au moment de la conquête française, l’abandon
des cultures h’a fait que progresser, la Régence
d’Alger était plongée alors dans un véritable état de
barbarie.
De 1830 à 1842, la conquête absorba tous les
efforts, les révoltes enlevèrent toute sécurité et il
fallut l’énergie du maréchal Bugeaud pour mettre
un terme à la guerre et livrer aux colons les terres
conquises.
Alors commence l’oeuvre du défrichement, la lutte
contre la fièvre, ennemi autrement redoutable que
l’Arabe conquis. Les plaines du littoral, qui furent
d’abord attaquées par les premiers colons, étaient depuis
longtemps abandonnées par les indigènes, les
marais en couvraient une grande surface.
Les efforts de ces vaillants colons de la première
heure ne tardèrent pas à donner à tout ce pays l’aspect
riant de nos meilleures régions agricoles de France.
Les fermes, les villages apparurent reliés par des
chemins, des routes,puis des chemins de fer.
Aménagement des eaux. — La répartition irrégulière
des eaux pluviales a toujours été, dans l’Afrique,
le grand obstacle à la prise de possession du sol par
un peuple d’agriculteurs. Les Carthaginois et les
Romains n ’ont établi leur domination sur cette terre
que par une conquête complète de l’eau. Les recherches
archéologiques poursuivies en Tunisie et en
Algérie, spécialement par le Dr Carton et par M. R.
de la Blanchère, ont démontré que, sous les civilisations
anciennes, les eaux, si sauvages aujourd’hui,
étaient domptées par d’innombrables travaux hydrauliques
qui se succédaient depuis les ravineaux des
montagnes jusqu’aux plaines sillonnées de canaux.
Actuellement, lorsque viennent les pluies, l’eau se
précipite, se hâtant de fuir à la mer en laissant son
terrain de parcours sec et bouleversé.
En montagne, les ravins étaient garnis de terrasses
de retenue étagées en paliers, l’eau était répartie
sur de grandes surfaces qu’elle imbibait, des sources
nombreuses étaient ainsi alimentées. A leur entrée