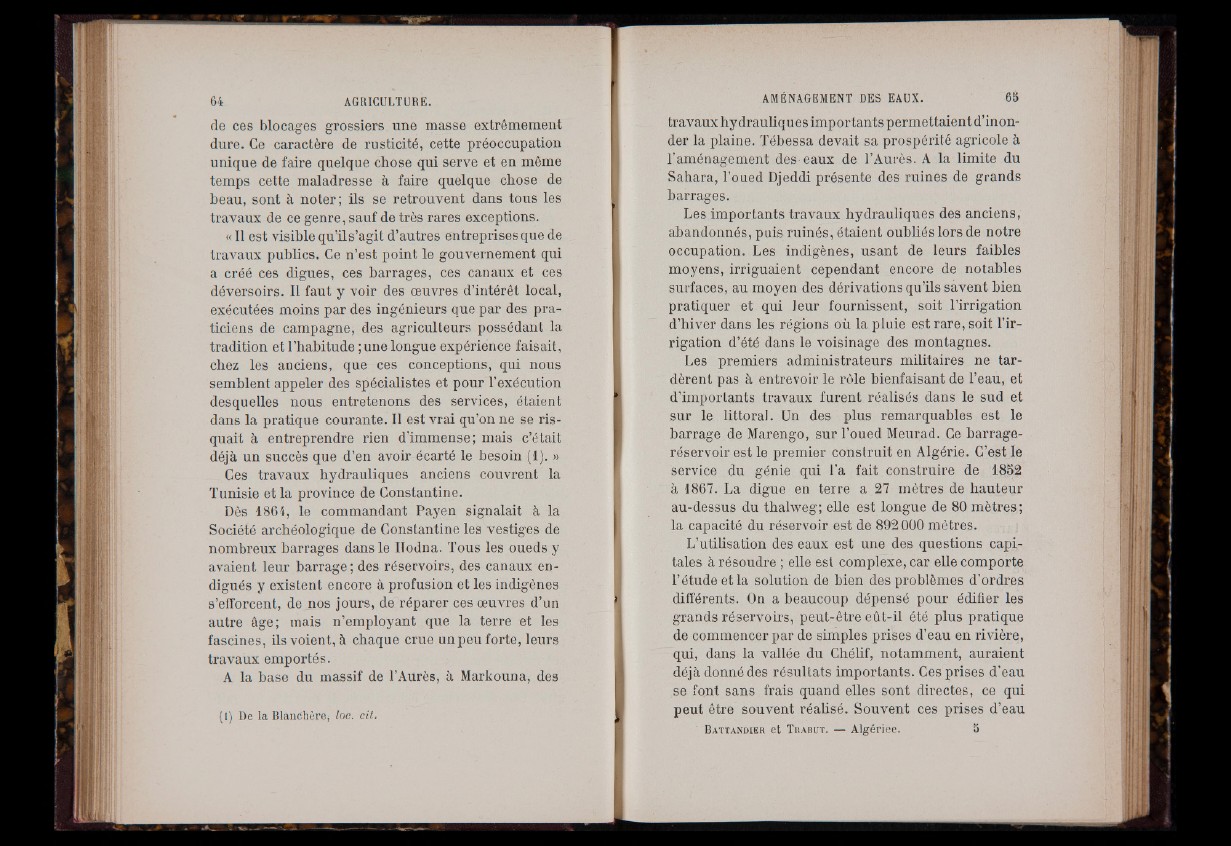
de ces blocages grossiers une masse extrêmement
dure. Ce caractère de rusticité, cette préoccupation
unique de faire quelque chose qui serve et en même
temps cette maladresse à faire quelque chose de
beau, sont à noter; ils se retrouvent dans tous les
travaux de ce genre, sauf de très rares exceptions.
« Il est visible qu’ils ’agit d’autres entreprises que de
travaux publics. Ce n’est point le gouvernement qui
a créé ces digues, ces barrages, ces canaux et ces
déversoirs. Il faut y voir des oeuvres d’intérêt local,
exécutées moins par des ingénieurs que par des praticiens
de campagne, des agriculteurs possédant la
tradition et l ’habitude ; une longue expérience faisait,
chez les anciens, que ces conceptions, qui nous
semblent appeler des spécialistes et pour l’exécution
desquelles nous entretenons des services, étaient
dans la pratique courante. Il est vrai qu’on ne se risquait
à entreprendre rien d’immense; mais c’était
déjà un succès que d’en avoir écarté le besoin (1). »
Ces travaux hydrauliques anciens couvrent la
Tunisie et la province de Constantine.
Dès 1864, le commandant Payen signalait à la
Société archéologique de Constantine les vestiges de
nombreux barrages dans le ITodna. Tous les oueds y
avaient leur barrage; des réservoirs, des canaux endigués
y existent encore à profusion et les indigènes
s’efforcent, de nos jours, de réparer ces oeuvres d’un
autre âge; mais n’employant que la terre et les
fascines, ils voient, à chaque crue un peu forte, leurs
travaux emportés.
A la base du massif de l’Aürès, à Markouna, des
(1) De la BlanChèrej loc. cit.
travaux hy draubques importants permettaient d’inonder
la plaine. Tébessa devait sa prospérité agricole à
l ’aménagement des eaux de l’Aurès. A la limite du
Sahara, l’oued Djeddi présente des ruines de grands
barrages.
Les importants travaux hydrauliques des anciens,
abandonnés, puis ruinés, étaient oubbéslors de notre
occupation. Les indigènes, usant de leurs faibles
moyens, irriguaient cependant encore de notables
surfaces, au moyen des dérivations qu’ils savent bien
pratiquer et qui leur fournissent, soit l’irrigation
d’hiver dans les régions où la pluie est rare, soit l’irrigation
d’été dans le voisinage des montagnes.
Les premiers administrateurs militaires ne tardèrent
pas à entrevoir le rôle bienfaisant de l’eau, et
d’importants travaux furent réalisés dans le sud et
sur le littoral. Un des plus remarquables est le
barrage de Marengo, sur l’oued Meurad. Ce barrage-
réservoir est le premier construit en Algérie. C’est le
service du génie qui l’a fait construire de 1852
à 1867. La digue en terre a 27 mètres de hauteur
au-dessus du thalweg; elle est longue de 80 mètres;
la capacité du réservoir est de 892000 mètres.
L’utilisation des eaux est une des questions capitales
à résoudre ; elle est complexe, car elle comporte
l’étude et la solution de bien des problèmes d’ordres
différents. On a beaucoup dépensé pour édifier les
grands réservoirs, peut-être eût-il été plus pratique
de commencer par de simples prises d’eau en rivière,
qui, dans la vallée du Chébf, notamment, auraient
déjà donné des résultats importants. Ces prises d’eau
se font sans frais quand elles sont directes, ce qui
peut être souvent réabsé. Souvent ces prises d’eau
B a t t a n d i e r et T r a b ü t . — Algériee. 5