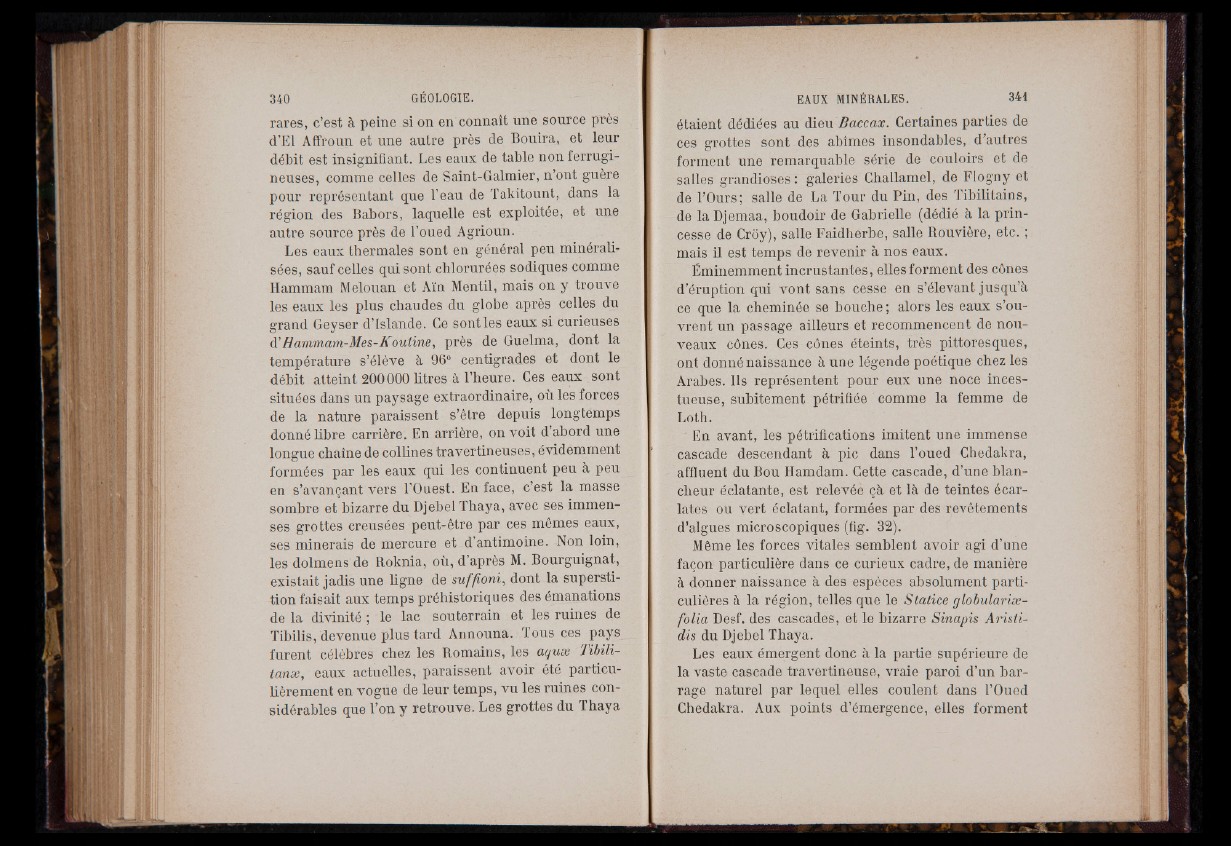
rares, c’est à peine si on en connaît une source près
d’El Aflroun et une autre près de Bouira, et leur
débit est insignifiant. Les eaux de table non ferrugineuses,
comme celles de Saint-Galmier, n’ont guère
pour représentant que l’eau de Takitount, dans la
région des Babors, laquelle est exploitée, et une
autre source près de l’oued Agrioun.
Les eaux thermales sont en général peu minéralisées,
sauf celles qui sont chlorurées sodiques comme
Hammam Melouan et Aïn Mentil, mais on y trouve
les eaux les plus chaudes du globe après celles du
grand Geyser d’Islande. Ce sont les eaux si curieuses
d’Hammam-Mes-Koutine, près de Guelma, dont la
température s’élève à 96° centigrades et dont le
débit atteint 200000 litres à l’heure. Ces eaux sont
situées dans un paysage extraordinaire, où les forces
de la nature paraissent s’être depuis longtemps
donné libre carrière. En arrière, on voit d’abord une
longue chaîne de collines travertineuses, évidemment
formées par les eaux qui les continuent peu à peu
en s’avançant vers l’Ouest. En face, c’est la masse
sombre et bizarre du Djebel Thaya, avec ses immenses
grottes creusées peut-être par ces mêmes eaux,
ses minerais de mercure et d’antimoine. Non loin,
les dolmens de Roknia, où, d’après M. Bourguignat,
existait jadis une ligne de suffioni, dont la superstition
faisait aux temps préhistoriques des émanations
de la divinité ; le lac souterrain et les ruines de
Tibilis, devenue plus tard Announa. Tous ces pays
furent célèbres chez les Romains, les aquse Tibili-
tanæ, eaux actuelles, paraissent avoir été particulièrement
en vogue de leur temps, vu les ruines considérables
que l’on y retrouve. Les grottes du Thaya
étaient dédiées au dieu Baccax. Certaines parties de
ces grottes sont des abîmes insondables, d’autres
forment une remarquable série de couloirs et de
salles grandioses : galeries Challamel, de Flogny et
de l’Ours; salle de La Tour du Pin, des Tibilitains,
de la Djemaa, boudoir de Gabrielle (dédié à la princesse
de Crôy), salle Faidherbe, salle Rouvière, etc. ;
mais il est temps de revenir à nos eaux.
Éminemment incrustantes, elles forment des cônes
d’éruption qui vont sans cesse en s’élevant jusqu’à
ce que la cheminée se bouche ; alors les eaux s’ou-
vrent un passage ailleurs et recommencent de nouveaux
cônes. Ces cônes éteints, très pittoresques,
ont donné naissance à une légende poétique chez les
Arabes. Ils représentent pour eux une noce incestueuse,
subitement pétrifiée comme la femme de
Loth.
En avant, les pétrifications imitent une immense
cascade descendant à pic dans l’oued Chedakra,
affluent du Bou Hamdam. Cette cascade, d’une blancheur
éclatante, est relevée çà et là de teintes écarlates
ou vert éclatant, formées par des revêtements
d’algues microscopiques (fig. 32).
Même les forces vitales semblent avoir agi d’une
façon particulière dans ce curieux cadre, de manière
à donner, naissance à des espèces absolument particulières
à la région, telles que le Statice globulariæ-
folia Desf. des cascades, et le bizarre Sinapis Aristi-
dis du Djebel Thaya.
Les eaux émergent donc à la partie supérieure de
la vaste cascade travertin eus e, vraie paroi d’un barrage
naturel par lequel elles coulent dans l’Oued
Chedakra. Aux points d’émergence, elles forment